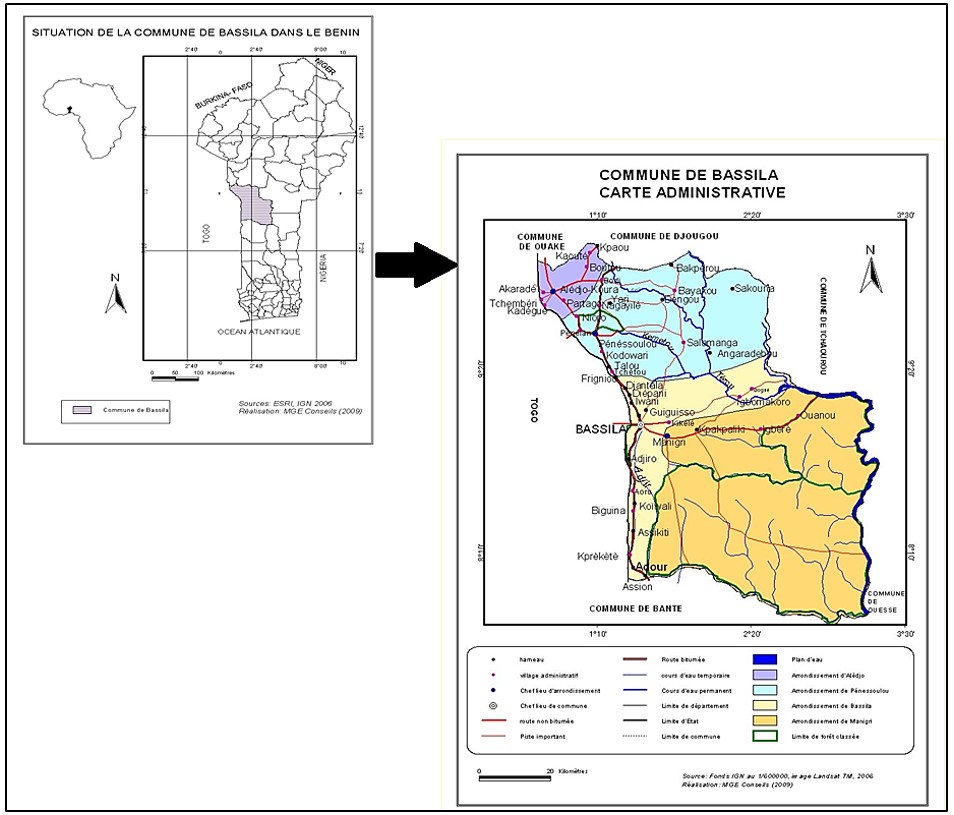16 |La phytothérapie des infections somatiques humaines courantes à Bassila au Nord-Bénin
Phytotherapy of common human somatic infections in Bassila, North-B
Mots-clés:
Thérapeutique| plante médicinale| feuille| racine| écorce| Bassila| Bénin|Résumé
En dépit des progrès de la pharmacologie, l’usage thérapeutique des plantes médicinales est très présent dans certaines régions du Bénin. L’objectif de cette étude est de présenter les savoirs endogènes et les usages thérapeutiques des plantes dans la commune de Bassila au Nord-Ouest du Bénin. Les données ont été collectées par des entretiens individuels semi-structurés, des entretiens de groupe, des observations directes et des recherches documentaires en général par internet. Elles ont été analysées manuellement aux moyens des textes transcrits, des images prises. Les résultats montrent une commune où l’offre biomédicale manque à prendre en compte entièrement la quête de soins des populations. Une part assez importante des problèmes de santé est résolue par des vertus végétales connues et exploitées depuis longtemps. Ces végétaux exploités le sont par la feuille, l’écorce ou la racine pour traiter des maladies dont les manifestations sont soit internes, soit externes. Certaines fonctions thérapeutiques sont garanties par des convocations mystiques complémentaires.
Introduction
Les savoirs expérientiels endogènes sur les propriétés thérapeutiques des plantes environnantes sont repérables presque partout au monde. Les plus âgés ou les spécialistes peuvent toujours indiquer les usages thérapeutiques de telle ou telle plante en lien avec les maladies courantes. Le corps chaud, le mal de tête, le rhume, la grippe, la diarrhée, le vomissement, etc., qui sont des symptômes de pathologies connues dans la biologie médicale, sont souvent traités au village avec des plantes. Un travail scientifique sur ses plantes médicinales a commencé à la période précoloniale en Afrique, avec l’Institut de Recherches pour le Développement (ex- ORSTOM) par exemple. Les travaux abordent plusieurs aspects, comme les principes actifs, les modes d’extraction, les usages thérapeutiques et les dimensions mystiques ou magico-religieuses (A. Blama et F. Mamine, 2013, p. 3-5; C. Valadeau et G. Bourdy, 2015, p. 71-93; M. Debray, 1975, p. 75; C. Joret, 1888, p. 345; J. Kerharo·, 1975, p. 24; J. Kerharo, A. Bouquet et M. Debray, 1975, p. 19; J. Kerharo, 1970, p. 360). Ces travaux, maintenant plus ou moins anciens ont tenté sans le réussir de favoriser la collaboration réelle entre les médecines traditionnelle et moderne (J. Benoist, 2004, p. 280). Dans l’objectif d’améliorer l’offre de soins dans la commune de Bassila, les autorités sanitaires, religieuses et politiques ont voulu savoir si la médecine dite traditionnelle peut apporter une contribution dans la prise en charge des maladies courantes. Cette interrogation est partie de quelques constats : le grand nombre de tradithérapeutes qui revendiquent chacun un spécialité, le recours tardif des malades aux centres de santé qui s’expliquent par la fréquentation préalable des tradithérapeutes, l’autoréférence de certains patients vers les tradithérapeutes, la profusion de traitements à base de plantes en vente dans les marchés locaux et plus généralement la classification des maladies en maladies de l’hôpital et maladies de spécialistes de plantes et autres savoirs endogènes. Quelles sont les maladies ou les infections qui sont plus traitées par les tradithérapeutes locaux ? Avec quelles plantes les traitent-ils ? De quelle façon extraient-ils les propriétés thérapeutiques à l’œuvre ? Cet article présente les différentes infections somatiques humaines courantes que les praticiens de la médecine traditionnelle traitent dans la commune de Bassila. Il présente les plantes et les procédés de préparation et d’administration des traitements aux patients. Il vise à faire une liste indicative des plantes associées à des infections humaines et à décrire les procédés de traitements déployés.
Une enquête dans cette zone de Bassila a été menée, comme décrit dans la section suivante, pour identifier ces plantes utilisées couramment dans le traitement des maladies à microbes, en général. Ces plantes ont été observées et décrites avec des praticiens et des usagers parmi les populations.
L’article présente les contraintes éprouvées par l’offre médicale moderne, le type de pathologies soignées avec les plantes et les convocations métaphysiques complémentaires au fonctionnement des traitements phytothérapeutiques.
Méthodologie
1. Méthodologie
Pour être clair, la méthodologie est détaillée en cinq points autour du site de l’enquête, de la population, de l’échantillonnage et des méthodes de collecte et d’analyse des données.
1.1. Site de l’enquête : la commune de Bassila au Bénin
La commune de Bassila compte 4 arrondissements et 30 villages et quartiers de villes. Elle est une des quatre communes du département de la Donga, au Nord-Ouest du Bénin. Elle est frontalière au Togo à l’Ouest, aux communes de Djougou et de Ouaké au Nord, à la commune de Bantè au Sud et à la commune de Tchaourou à l’Est. La carte n°1 présente la position de cette commune au Bénin et ses différentes subdivisions.
Sur le plan sanitaire, elle souffre, comme la plupart des communes du Bénin, d’un manque d’agents qualifiés, de l’insuffisance de matériels de travail adéquat, de l’indisponibilité ou l’instabilité de l’énergie, des pratiques professionnels peu déontologiques, etc.
Carte n°1 : Carte administrative de la commune de Bassila
1.2. Population d’enquête
La population d’étude était composée des chefs des arrondissements de Bassila centre, de Penessoulou et de Manigri, des tradithérapeutes de ces arrondissements, des usagés femmes et hommes. Parmi les tradithérapeutes, les entretiens se sont déroulés avec les responsables des bureaux des associations au niveau des arrondissements et de ceux qui ont été signalés comme des spécialistes de quelques infections courantes. Aussi, tous les sujets de l’étude étaient rassurés quant à l’anonymat et à la confidentialité des informations à collecter. Sur le terrain, le consentement éclairé et l’avis favorable verbal ou écrit des sujets étaient obtenus en premier lieu avant toute opération d’entretien.
1.3. Échantillonnage de la population enquête
La technique d’échantillonnage à choix raisonné a été utilisée, avec la méthode de la boule de neige. En effet, dans chaque arrondissement, les premières personnes rencontrées ont été les chefs des arrondissements et les responsables des bureaux des associations. Ceux-ci indiquaient par la suite les spécialistes d’infections à rencontrer. Ces spécialistes à leur tour indiquaient les usagers qu’ils ont une fois traités. Selon le cas (distance, nature de l’infection, disponibilité, etc.) ces usagers étaient enfin rencontrés pour les entretiens.
1.4. Méthodes de collecte des données
L’étude documentaire (sur la médecine traditionnelle, la phytothérapie et la commune de Bassila), l’observation directe (des plantes signalées par les enquêtés) et les entretiens semi-directifs (pour décrire les préparations, les posologies et les infections concernées) ont été effectués du 1er Janvier au 31 septembre 2018. C’est une approche essentiellement qualitative. Elle accorde une importance fondamentale à l’univers des significations auxquelles les participants se référent. Les outils ont été le guide d’entretien, la grille d’observation, les mots clés et les moteurs de recherche (isidorescience, google scholar, etc.), les appareils d’enregistrement (magnétophones) des conversations et les appareils photo pour les prises de vues.
1.5. Méthodes de traitement des données collectées
La transcription des entretiens enregistrés a conduit au traitement et à l’analyse des données sur les procédés de préparation et de traitement et sur les infections connues à la fois par les traitants et les traités. Elle a duré 5 mois, du 16 mai au 15 septembre 2018. Pour les données transcrites par tradithérapeute et par infection citée, elles ont été classées à l’aide du logiciel Word.
Résultats
2. Résultats
Quatre paramètres nous ont semblé intéressants à décrire pour le compte de ces résultats : la capacité technique et matérielle de l’offre biomédicale à prendre en charge les problèmes de santé des populations dans la commune de Bassila, la situation de l’offre traditionnelle de soins, le type de maladies que cette dernière vise, les caractéristiques thérapeutiques des plantes utilisées contre ces maladies et les dimensions mystiques convoquées dans les usages.
2.1. L’ampleur de l’offre phytothérapeutique à Bassila
Un état des lieux du Ministère de la Santé (2017) révèle l’existence de 520 tradithérapeutes pour l’ensemble du département de la Donga dans lequel se trouve la commune de Bassila. Tous les Praticiens de la Médecine Traditionnelle (PMT) de la commune de Bassila n’ont pas adhéré à l’association instituée par le ministère pour les régir, par crainte, par manque d’intérêts ou pour des convenances personnelles. En effet, certains estiment qu’il s’agit de creusets pour espionner et connaître les recettes de guérison des tradithérapeutes. D’autres par contre, se sont retirés de l’association. D’après ces derniers, les diverses dépenses liées aux déplacements lors des réunions de l’association seraient aussi un motif de retrait.
Du point de vue des compétences, les PMT se classent en deux groupes : les généralistes et les spécialistes. Les généralistes estiment avoir les connaissances et les compétences pour soigner toutes les maladies courantes rencontrées : démence, épilepsie, rhumatisme, fractures osseuses, etc. Mais cette prétention des généralistes à la maîtrise et au traitement de toutes les maladies jette, dans bien de situations, un discrédit sur les praticiens. Elle met en place ainsi une limite à la collaboration avec la médecine moderne à Bassila. Les généralistes retiennent parfois des patients en référence institutionnelle vers les centres de santé. En plus, elle influence négativement les représentations des agents de santé vis-à-vis des tradithérapeutes. Les spécialistes, quant à eux, se focalisent dans le traitement d’une seule maladie : fractures osseuses, accouchements difficiles, morsures de serpent, etc.
Afin de faciliter la recherche d’essences végétales rares, les diverses associations de PMT au niveau des arrondissements ont installé des jardins botaniques. Celui de l’arrondissement central de Bassila fait un hectare et celui de Manigri quatre hectares. Les jardins sont entretenus et utilisés pour l’extraction de plantes en fonction des besoins. La plupart des plantes dont les photos sont présentées à la section 2.3 sont de ces jardins, elles ont poussé naturellement ou ont été plantées. Elles seront présentées dans la section suivante d’abord par types de pathologies traitées et ensuite suivant la partie utilisée pour le traitement.
2.2. Plantes médicinales par type de maladies
Les données collectées montrent que les plantes soignent deux grandes catégories de pathologies : celles qui se manifestent à l’extérieur du corps et celles qui se manifestent à l’intérieur du corps. Entre les deux, il y a naturellement des passerelles, avec celles qui se manifestent aux deux espaces du corps que sont l’intérieur (ventre, sang, cœur, foie, poumon, utérus, etc.) et l’extérieur (peau, oreille, yeux, etc.).
L’une des faiblesses fondamentales de la phytothérapie reste la qualité et la précision du diagnostic. Cela pose alors le sérieux problème du rapport à la pathologie infectieuse traitée. Par exemple, comment faire la différence entre la typhoïde et le paludisme dans un cadre purement traditionnel ? Il y a donc assez de tâtonnements malgré les fortes convictions à l’œuvre dans les déclarations des soignants.
2.2.1. Les maladies physiques ou externes
Ces sont les maladies dont les manifestations sont visibles à l’œil nu. On voit les symptômes. Le tableau n°1 récapitule les plantes avec les maladies qu’elles servent à traiter.
Tableau n°1 : Plantes médicinales et maladies de manifestations externes traitées
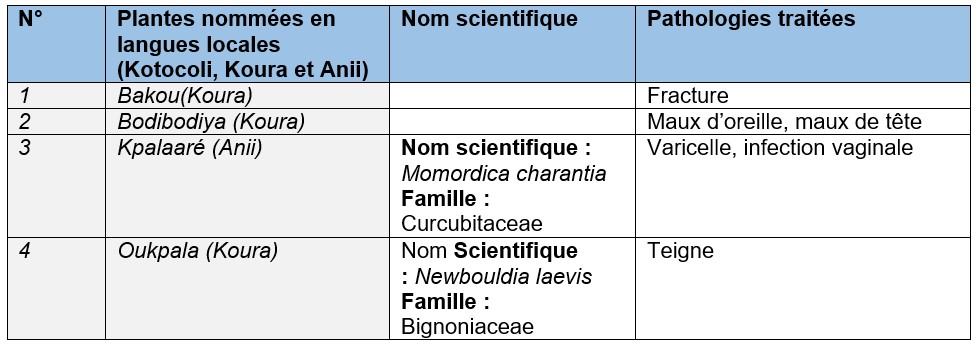 Source: Nos enquêtes de terrain, 2018
Source: Nos enquêtes de terrain, 2018
La liste de ces pathologies laisse comprendre trois choses : l’extériorité physique de leurs manifestations pathogènes, leur marginalité dans le ciblage thérapeutique des formations sanitaires modernes et leur simplicité thérapeutique (à l’exception de la fracture). Le diagnostic de ces pathologies est fait sur la base des manifestations corporelles et des plaintes du patient. Les agents qui les soignent essaient souvent de prescrire des médicaments pour tenter de guérir. En général, on pense que leurs traitements n’existent pas à l’hôpital.
2.2.2. Les maladies intra-organiques
Les maladies répertoriées ici ne se manifestent pas souvent à l’extérieur du corps. Le tableau n°2 récapitule les plantes avec les pathologies qu’elles servent à traiter.
Tableau n°2 : Plantes et maladies intra-organique traitées
 Source : Nos enquêtes de terrain, 2018
Source : Nos enquêtes de terrain, 2018
2.3. Habitat, traitement, indications et posologies de plantes médicinales
Les connaissances et les usages thérapeutiques des plantes partent de leurs habitats traditionnels. Chacune est exploitée par des procédés divers pour produire le traitement à administrer aux patients. Elles sont ainsi utilisées pour des pathologies spécifiques et selon des posologies bien claires. Nous les classons ici suivant la partie à l’œuvre dans le traitement (feuille, écorce, racine ou la plante entière). Nous retenons de présenter celles dont nous avons pu trouver le nom scientifique.
2.3.1. Les transformations basées sur la feuille
La plupart des plantes du tableau n°3 ci-dessous sont utilisées pour leurs feuilles.
Tableau n°3 : plantes à substances actives extraites des feuilles
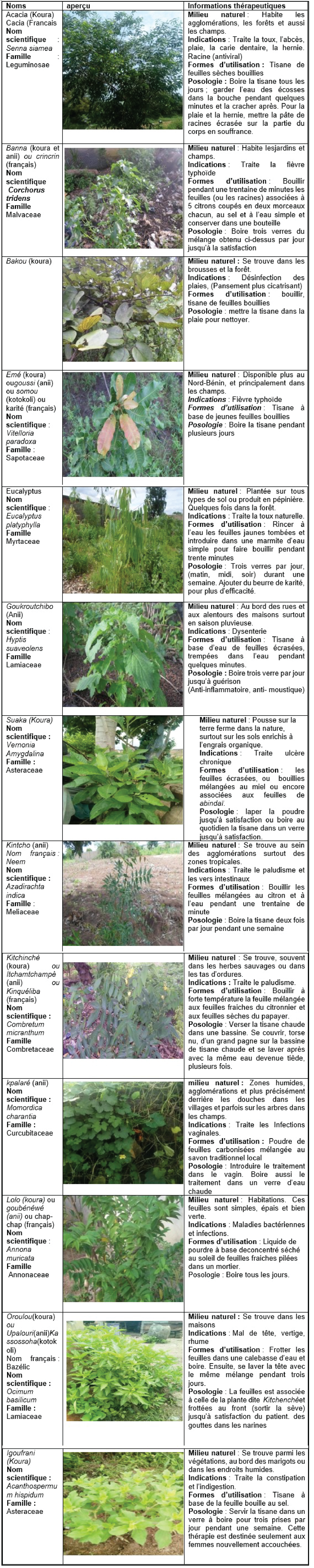 Source : Nos enquêtes de terrain, 2018
Source : Nos enquêtes de terrain, 2018
Ces plantes, de différentes familles, sont la plupart disponible dans l’environnement des habitations. Cette disponibilité pourrait avoir favorisé la découverte de leurs vertus thérapeutiques.
2.3.2. Les transformations basées sur les écorces
Certaines plantes, présentées dans le tableau n°4 sont utilisées par leurs écorces pour traiter les mêmes ou d’autres infections courantes humaines.
Tableau n°4 : plantes à substances actives extraites des écorces
 Source : Nos enquêtes de terrain, 2018
Source : Nos enquêtes de terrain, 2018
2.3.3. Les transformations basées sur les racines
Les racines des plantes du tableau n°5 sont exploitées dans un grand nombre de cas pour fabriquer des traitements. Les préparations peuvent différer parfois comme le montre la description de la troisième colonne du tableau.
Tableau n°5 : Plantes à substances actives extraites des racines
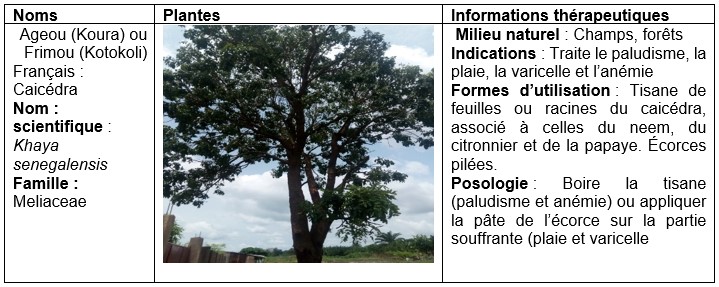 Source : Nos enquêtes de terrain, 2018
Source : Nos enquêtes de terrain, 2018
Plusieurs autres plantes relèvent de ce tableau normalement. Mais n’ayant pas pu avoir leurs noms scientifiques, nous avons estimé inutile de les laisser par ici. Le khaya senegalensis dont nous avons ce nom est aussi disponible dans l’environnement des habitations. C’est un grand arbre dont les différentes parties ont des utilisations humaines et animales en général.
2.4. Les considérations mystiques dans les procédés de transformations et de traitements
Des croyances sont attachées aux différentes plantes en général pour leur efficacité. Ces croyances s’expriment dans les techniques et considérations diverses liées à la façon et au moment indiqué pour cueillir les feuilles, creuser les racines ou enlever l’écorce. Elles s’appliquent aussi à la préparation ou à la consommation du traitement. Ces différentes techniques témoignent d’une certaine croyance à un certain esprit des plantes(C. Valadeau et G.Bourdy, 2015 p. 91).
2.4.1. Les convocations mystiques dans les préparations des traitements
Dans les descriptions ci-dessus liées aux différentes plantes, nous n’avons pas décrit les procédés préparatoires : bouillir, carboniser, écraser, etc. les feuilles ou les écorces dans des contenants en aluminium ou en poterie, à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison.
La personne qui applique la technique préparatoire est soit le tradithérapeute (qui connaît la feuille) ou le patient (ou ses parents) auquel la feuille et le procédé préparatoire sont indiqués.
Le temps de la préparation varie entre la nuit, le matin très tôt, la fin de la matinée ou le soir juste avant le crépuscule. En général, la préparation intervient le matin juste après la collecte des dérivés de la plante (racine, feuille, écorce, etc.). Mais, les autres moments de la journée ou de la nuit peuvent être indiqués selon les thérapies et les pathologies. D’après les données d’enquête, le matin est conseillé pour cueillir les feuilles avant d’avoir rencontré et parlé avec des personnes de son environnement. L’absence de contact serait une mesure de sécurité contre l’impureté et la « malchance » pour celui qui part à la récolte des éléments naturels de la thérapie.
Toutes les mesures techniques de collecte et de préparation des traitements ne sont cependant toujours pas de l’ordre du mystique. Elles reposent parfois sur des connaissances ethnomédicinales non livrées comme telles aux spécialistes par les prédécesseurs formateurs. En effet, des scientifiques évoquent des concepts comme l’«esprit » des plantes mais aussi leur intelligence(R. Boyd, A. Fournier et N. Saïbou, 2012, p. 174; N.N. Malo et R. Roy, 1996, p. 16).
2.4.2. Les convocations mystiques dans les traitements
La responsabilité de l’individu malade en quête de soins et de guérison est permanente dans la qualité de ses rapports avec la société d’une et avec le praticien de médecine traditionnelle d’autre part. S’il est atteint par un mal à cause de son comportement, être soigné et être guéri dépendent de sa discipline dans ses rôles de profane ou de partenaire dans les traitements.
Ainsi, des tradithérapeutes introduisent dans les traitements des procédés pratiques matérielles ou verbales pour corriger la faute, prévenir les attaques de leurs pairs ou des ennemis du malade contre les soins et renforcer le dispositif psychosocial de ce patient pour une recouvrance de la santé. Pour cela, des incantations sont permanentes dans certains traitements en fonction des pathologies traitées et des traitants. A Pénéssoulou, un tradithérapeute insiste sur le fait que la guérison dépend du patient, de son observance thérapeutique (qui prend en compte tous les aspects). Il demande que le patient frotte ses côtes contre le mur de l’entrée principale de la concession en disant « que ce mal sorte de mon corps ». On voit bien l’analogie faite entre la maison et le patient dans l’entrée et la sortie de la maladie (D. Bonnet, 1986, p. 169; F. Laplantine, 2002, p. 31). La plupart des traitements ou presque l’ensemble des traitements convoquent une efficacité mystique qui se traduit par les incantations, les interdits et les actes à poser à des moments et endroits bien choisis.
Conclusion
Conclusion
Il existe une relation fonctionnelle entre les plantes, les guérisseurs traditionnels et la population elle-même dans le traitement des maladies. La plupart des connaissances endogènes des modes et formes de traitements des maladies infectieuses émanent de l’héritage ancestral. D’où la difficulté pour les praticiens de pouvoir expliquer les principes actifs et thérapeutiques. Parfois, on note des contradictions entre guérisseurs traditionnels, sur des réponses données à certaines questions.
Pour les tradithérapeutes, la guérison d’un malade est parfois l’œuvre des divinités (ancêtre). Donc pour eux, l’usage des plantes à des fins thérapeutiques est évidemment une question de croyance. Les différents ingrédients (sel, piment de guinée, tête de margouillat, etc.), qu’on associe aux plantes dépendent du degré de malignité de la maladie dans le corps du patient. L’usage des racines, des écorces ou des feuilles dans le traitement dépend de la partie active de chaque plante vis-à-vis de la pathologie donnée.
Le défi majeur dans l’adéquation du traitement et de la maladie reste la technique ou la technologie du diagnostic. C’est encore et toujours par tâtonnement et savoirs empiriques que les maladies sont diagnostiquées.
Cette étude rentre dans une tradition de recherches botaniques et anthropologiques. Son intérêt est dans la mise à jour continuelle de la nécessité de renforcer la valorisation des plantes et des savoirs thérapeutiques locaux pour une meilleure prise en charge des patients. Le défi reste la mise en œuvre réelle de la collaboration tant évoquée aux niveaux international et national des politiques sanitaires.
Remerciements
Nous tenons à remercier l’Académie de Recherche et de l’Enseignement Supérieur Belge pour le financement de notre enquête. A travers elle nous remercions particulièrement les enseignants béninois et belges qui ont initié le programme de Renforcement des potentialités de valorisation de plantes utilisées en médecine traditionnelle contre les infections (VALTRAMED). Il s’agit des professeurs Fernand Ahokanou Gbaguidi (Bénin) et Joëlle Leclerc (Belgique). Nous remercions aussi les tradithérapeutes de Bassila qui ont bien accepté de répondre à nos questions et de nous conduire dans leurs laboratoires.
Références
Références bibliographiques
AKOTO Eliwo Mandjale, SONGUE Paulette Béat, LAMLENN Samson, KEMAJOU JacquesPokam Wadja et GRUENAISMarc.-Eric, 2006, « Infirmiers privés, tradipraticiens, accoucheuses traditionnelles à la campagne et à la ville », Le bulletin de l’APAD, (21), p. 1?14.
BENOIST Jean, 2004, « Rencontres de médecines?: s’opposer ou s’ajuster ». L’Autre, 5(2), p. 277-286.
BLAMA Aïcha et MAMINE Fateh, 2013, Etude ethnobotanique des plantes médicinales et aromatiques dans le sud algérien?: le Touat et le Tidikelt. Le 5ème Symposium International des Plantes Aromatiques et Médicinales (SIPAM 2013) Marrakech (Maroc), du 14 au 16 Novembre 2013.
BONNET Doris, 1986, « Fainzang Sylvie « L’intérieur des choses ». Maladie, divination et reproduction sociale chez les Bisa du Burkina", Journal des africanistes, 56(2), p. 167-170.
BOYD Raymond, FOURNIER Anneet SAÏBOU Nigan, 2012, « Une base de données informatisée transdisciplinaire de la flore chez les Seme du Burkina Faso?: un outil pour l’étude du lien nature-société ». In Colloque de Ouagadougou sur Regards scientifiques croisés sur le changement golbal et le développement. Langue, environnement, culture, p. 165-238.
de ROSNY Eric, 1981, Les yeux de ma chèvre. Sur les pas des maîtres de la nuit en pays douala (Cameroun), Paris, Plon.
DEBRAY Maurice,1975, « Médecine et pharmacopée traditionnelles a Madagascar ». Études médicales, (1), p. 69-85.
DILHUYDY, Jean-Marie, 2003, « L’attrait pour les médecines complémentaires et alternatives en cancérologie?: une réalité que les médecins ne peuvent ni ignorer, ni réfuter ». Bulletin Cancer, 90(7), p. 623-628.
GRUENAIS, Marc-Eric, (dir. (2002). «Un système de santé en mutation. Le cas du Cameroun ». Critique de la santé publique. Une approche anthropologique. Jean Pierre Dozon et Didier Fassin (Dir.) Paris, Balland (coll. Voix et regards), 2001, ISBN 2715813767, 362 p.
JORET Charles, 1888, «Les incantations botaniques des manuscrits f. 277 de la bibliotheque de l’école de médecine de Montpellier et f. 19 de la bibliothèque académique de Breslau. Romania, 17(67), 337?354. https://doi.org/10.3406/roma.1888.6014
KERHARO Joseph, 1975, La médecine et la pharmacopée traditionnelle sénégalaise ». Etudes médicales, 1, p. 7-54.
KERHARO Joseph, BOUQUET Armand et DEBRAY Maurice, 1975, «Médecines et pharmacopées traditionnelles du Sénégal, du Congo et de Madagascar ». Etudes médicales, p. 1?90.
KERHARO Joseph, 1970, «Pharmacognosie du Rauwolfia vomitoria Afz. Grand Médicament africain ». Journal d’agriculture tropicale et de botanique appliquée, 17(10), p. 353?367. https://doi.org/10.3406/jatba.1970.3079
KERHARO Joseph etADAM Jacques-Georges, 1964, «Plantes médicinales et toxiques des Peul et des Toucouleur du Sénégal ». Journal d’agriculture tropicale et de botanique appliquée, 11(12), p. 543?599. https://doi.org/10.3406/jatba.1964.2795
KERHARO Joseph et BOUQUET Armand, 1949, «Sur quatre Diospyros africains utilisés dans la pharmacopée indigène de la Côte d’Ivoire (Haute-Volta) ». Revue internationale de botanique appliquée et d’agriculture tropicale, 29(325), p. 601?605. https://doi.org/10.3406/jatba.1949.6710
KERHARO Joseph et PACCIONIJean- Paul, 1974, «Considérations d’actualité sur un vieux remède sénégalais tombé dans l’oubli: le remède de Joal (« garab u djoala » ou « garab diafan »). Journal d’agriculture tropicale et de botanique appliquée, 21(10?12), p. 345?350.
LAPLANTINE François, 2002, «Pour une ethnopsychiatrie critique ». VST - Vie sociale et traitements, 1(73), p. 28?33. https://doi.org/10.3917/vst.073.0028
MALO Nianga Nicephore etROY Roger, 1996, «La médecine traditionnelle et les plantes médicinales ont-elles encore une place dans la médecine moderne ». La biodiversité Mondiale, 6(3), p. 16-18.
VALADEAU Céline et BOURDY Geneviève, 2015,Le corps de l’homme, l’esprit des plantes?: soigner chez les Yanesha en Haute Amazonie péruvienne, Marseille, IRD.
Downloads
Publié
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
Copyright (c) 2023 LAFIA Amoussatou, SIDI Jacob et SAMBIENI N