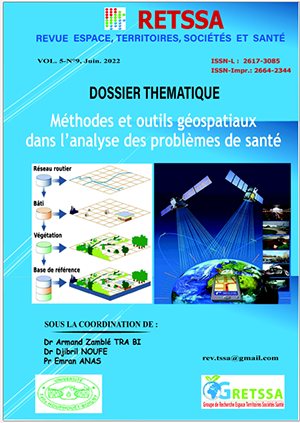9 |LES MALADIES INFECTIEUSES A L’ORIGINE DE L’INFERTILITE ET DE LA MORTALITE INFANTO-JUVENILE AU CAMEROUN
INFECTIOUS DISEASES AT THE ORIGIN OF INFERTILITY AND INFANT-JUVENILE MORTALITY IN CAMEROON
Mots-clés:
maladie| infertilité| infections| grossesse| mort-nés|Résumé
La symbolique de l’eau est à l’origine des problématiques anthropologiques les plus diverses. Face à l’infertilité et à la mortalité infanto-juvénile auxquelles les individus sont confrontés dans leur vie conjugale, les explications des professionnels de santé ne rassurent plus. Une catégorie d’eau « sale » « infectée » et « vampirisée » ou rendue impure par un vampire serait à l’origine de l’infertilité et de la mortalité infanto-juvénile au sein des couples. Il est pourtant reconnu que les infections sexuellement transmissibles non traitées sont des facteurs de risque d’infertilité et de mortalité infantile. On assiste pour ainsi dire à un fossé entre les discours des professionnels de la santé et des thérapeutes traditionnels sur les causes de l’infertilité et de la mort fœtale. Les professionnels de santé tiennent un discours peu ou presque pas convainquant pour expliquer les causes répétitives de la mortalité infanto-juvénile auxquelles sont confrontées les femmes tandis que les thérapeutes traditionnels tiennent un discours construit autour des valeurs culturelles comme la dot ou de la transgression des interdits alimentaires liées à la grossesse. Les méthodes de recherches propres aux sciences sociales ont aidé à la réalisation de cette étude. Cet article tente de comprendre la maladie à l’origine de l’infertilité et de la mortalité infanto-juvénile dont les individus et les couples sont victimes. Les représentations, les prénotions et les idées reçues autour de ces maladies engendrent des conflits familiaux inutiles qu’on pourrait éviter. Faute de soins médicaux efficaces et en raison d’une construction ou une invention sociale de la cause, les populations attribuent une origine mystique au mal et tentent en vain de l’éloigner par les plantes médicinales et les rites thérapeutiques.
Introduction
Les infections sexuellement transmissibles sont à l’origine des drames humains insoupçonnables. Dans un rapport OMS (2021), plus d’un million de personnes contractent une infection sexuellement transmissible (IST) et asymptomatique dans la majorité des cas. Dans le même rapport, il est indiqué que chaque année, 374 millions de personnes contractent l’une des quatre IST suivantes : chlamydiose, gonorrhée, syphilis ou trichomase. D’après les estimations, plus de 500 millions de personnes âgées de 15 à 49 ans ont une infection génitale par le virus Herpès simplex (HSV) et l’infection à papillomavirus humain (PVH) était à l’origine de 570 000 cas de cancer du col de l’utérus en 2018, et cause causée plus de 311 000 décès liée au cancer du col de l’utérus chaque année. Plus loin dans le même rapport, près d’un million de femmes enceintes étaient infectées par la syphilis en 2016, ce qui a entrainé lors de l’accouchement plus de 350.000issues défavorables, dont 200 000 mortinaissance et décès néonatals. Au Cameroun, l’enquête démographique et de santé et à indicateurs multiples (2011 :253) indique que, parmi les femmes ayant déclaré avoir une IST ou des symptômes, 62% se sont rendues dans un établissement sanitaire ou ont consulté un professionnel de santé pour obtenir un traitement ou un conseil. Chez les hommes, cette proportion est de 58%. A l’opposé, 26% des femmes et 19% des hommes n’ont pris aucune mesure pour traiter leur IST. Bruno Halioua et Françoise Lunel-Fabiani (2002) disent qu’on a cru dans les années 70 que, grâce à l’arsenal thérapeutique dont la médecine disposait, les maladies sexuellement transmissibles pouvaient être éradiquées à un niveau mondial. Cette période d’allégresse n’a pas duré longtemps. Très vite les médecins ont dû faire face à des infections de plus en plus résistantes aux antibiotiques et très contagieuses tels les condylomes ano-génitaux, les herpès génitaux ou les hépatites virales. Les maladies infectieuses sont multiples et contaminent les couples qui désirent avoir un enfant. Ces infections contaminent aussi le fœtus (transmission mère-enfant) qui meurt dans le ventre avant terme (mortalité fœtale) ou post-terme (mortalité post-natale). Les infections sont devenues résistantes à la panoplie des médicaments que les professionnels de la santé disposent et proposent pour soigner les patients. En l’absence de résultats efficaces, le doute et l’insatisfaction ont propulsé des patients vers les traitements par les plantes médicinales. Dans le cadre de cette étude, la théorie de la maladie telle que proposée par Georges Foster and Gillian Anderson (1978) a été mobilisé. En contexte Béti, les populations désignent la majorité des infections sous le vocal «ndiba» quand la maladie est grave et «edip» quand elle est chronique, chez des personnes ayant une souche infectieuse résistante. Les infections sont à l’origine des drames humains irréversibles. Elles sont à l’origine de la majorité des accidents de la procréation et mettent la santé de la mère et de l’enfant en péril, provoquent des fausses couches et des mort-nés. Ces infections ont pris une importance croissante et sont devenues fréquentes, posant ainsi des problèmes majeurs de prévention et de traitement. Elles sont devenues des problèmes de santé publique préoccupants. Comment comprendre les représentations que les populations se font des maladies sexuellement transmissibles ? Comment les couples qui n’arrivent pas à faire un enfant ou qui en perdent à la naissance se comportent-ils ?
Méthodologie
1. Méthodologie
1.1. Le contexte de l’étude et la justification
Lors de la Conférence internationale pour la population et le développement (CIPD) tenue au Caire, en 1994, Raimi Fassassi et (al) (2010) relèvent que les intervenants ont abordé la question de la santé de reproduction étendue sur la relation mère-enfant. Cette relation s’étendait en plus sur les questions de naissance, de l’adolescence, de la procréation, de l’accès aux soins de santé de la reproduction. Toutes ces préoccupations étaient au centre des discussions en lien avec les droits fondamentaux de la personne. En outre, la Conférence de Beijing sur les femmes, tenues en 1995, réaffirmait le droit à toutes les femmes d’accéder aux services de santé de la reproduction, confortant pour ainsi dire les acquis de la CIPD. En 2000, les Etats membres des nations unies, en vue de lutter contre la pauvreté, convenaient de huit Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) à atteindre dont trois sont directement liés à la santé de la reproduction. Dans le rapport de Marie Gisèle Guigma (2012) 3,7 millions de nouveau-nés meurent dans les 24 premières heures de leur existence. Au Cameroun, selon une enquête démographique et de santé à indicateurs multiples (EDS) réalisée en 2011, toutes les 5 heures 8 nouveau-nés meurent. Sur 1000 naissances vivantes, 28 meurent avant 1 mois de vie, 65 meurent avant leur premier anniversaire et 129 meurent avant leur cinquième anniversaire. Les causes des décès maternels et infanto juvénile liées aux infections est de 23%. Les maladies infectieuses sont la conséquence de l’agression d’un organisme vivant par un ou plusieurs micro-organismes. Ces derniers sont disséminés dans l’environnement tel que l’air, le sol, l’eau mais ils peuvent également être retrouvés dans les réservoirs tels que les aliments, les animaux ou les humains, porteurs sains ou infectés. La transmission s’effectue soit par contact direct avec l’un de ces réservoirs, soit par contact indirect par le biais d’un vecteur vivant ou non. Ces micro-organismes infectants, appelés aussi agents infectieux sont les virus, les parasites et les champignons. Dans le cadre de cette étude, nous nous appesantirons sur les infections d’origine bactérienne. Les Sciences Sociales et particulièrement l’anthropologie s’imposent ainsi dans les sciences biomédicales pour aider à comprendre les comportements des patients face aux maladies et les démarchent qu’elles entreprennent pour les soins.
1.2. Matériels et les méthodes
Les données qualitatives de cette étude ont été collectées en 2015 dans le cadre d’une recherche sur le paludisme dans le département de la Mefou et Afamba, particulièrement dans les localités de Mfou et de Soa, région du Centre. Les informations sont issues des dépouillements des données de cette étude. Au cours de cette enquête, nous avons interrogé 52 personnes à partir d’un sondage par grappe. Nous avons mené quelques entretiens approfondis particulièrement sur les termes «ndiba» et «edip». La technique de boule de neige nous a permis de rencontrer les femmes reconnues et spécialisées dans le traitement de cette maladie, puis de trouver des patient(e)s qui venaient en consultation ou pour des traitements. Nous les avons interrogées pour comprendre le sens que les populations donnent aux maladies infectieuses ainsi que les démarches thérapeutiques qu’elles déploient pour essayer de résoudre leur problème d’infertilité et de mortalité infanto-juvéniles que les infections ont causé. Les récits de vie des patients à propos de cette maladie étaient nombreux, nous avons analysé quelques-uns. Nous avons observé le conditionnement des médicaments traditionnels pour soigner ces maladies et participé aux pratiques qui accompagnent les soins.
Résultats
2. Résultats
2.1. Les sens de la maladie dans la culture
Le peuple Beti est composé de plusieurs de groupes ethniques parmi lesquels les Bane, Bulu, Eton, Kolo ou Ewondo, Ntumu, Fong, Mvele, Manguissa, Etenga entre autres. Ces groupes partagent une même culture : «la culture Beti». Cependant, on note quelques dissemblances qui permettent de les distinguer les uns aux autres. Ces exceptions se lisent par exemple sur l’accent linguistique, les manières de tables, les rites et rituels relatifs au mariage et à l’enfantement. Sur le plan alimentaire, les «Bulu» on a par exemple du «mendzip mezong + ntuba ékon» (bouillon d’aubergine) comme plat traditionnel de base, chez les Bane et les Eton, on trouvera par contre le «kpem avué, nnam owondo aï mbong», et l’«okok+ndeng» respectivement. La maladie étudiée ne concerne pas seulement ce groupe ethnique, elle touche à toutes les couches sociales. La langue «ewondo» ne propose pas de nosographie complexe des maladies. La maladie se dit «okoan» et la santé se dit «mvoâ». En «ewondo», certains troubles sont désignés par l’organe affecté. Ce principe fondamental de dénomination des troubles pathologiques est connu dans plusieurs langues. Il s’agit là d’une métonymie de l’organe affecté pour l’affection. Ainsi donc, un lexème peut souvent désigner des troubles différents dans des langues différentes. Certains désordres pathologiques sont aussi souvent nommés par des termes désignant des manifestations symptomatiques localement perçues. Par exemple, «froid» pour désigner la fièvre ou le paludisme, «chaud» ou «chaleur» pour la fièvre chaude des nourrissons, la grossesse pour désigner le paludisme d’une femme enceinte «mbubun ou iminga ane abum». Ils peuvent encore désigner la cause ou l’origine présumée, «tsit» (animal) pour la langue «ewondo». Les explications que donnent les populations enquêtées à ce sujet relèvent que cette identification de la maladie viendrait du fait qu’elle provoquerait souvent des amaigrissements chez leurs victimes et donnerait l’impression que des parties de leurs corps seraient «mangées» au cours de la maladie, exactement comme pourrait être la viande d’un animal. Le terme «bididi» est employé pour désigner l’insecte «ossun» qui «mange» ou «charançonne» tout le corps après sa piqûre.
Dans le système de croyance Ewondo, on parle de maladie simple lorsqu’elle est connue et peut facilement se soigner par la médecine conventionnelle. On parle aussi de maladie grave lorsqu’elle dépasse le niveau de compétence médicale et dont il faut faire recours à un guérisseur traditionnel. Les populations ne font plus trop confiance à la médecine moderne, même en allant au centre de santé, un parent passe d’abord chez un guérisseur voir s’il n’y a pas la mainmise du malin dans la maladie en question. A cet égard, la maladie proviendrait de la sorcellerie «evu» et relève de la compétence d’un guérisseur. Soit la maladie est naturelle, soit elle est interpersonnelle.
Ces deux catégories causales distinguent donc les maladies attribuables à un agent extérieur aux maladies dont les causes sont,-soit humaine (le sorcier),-soit naturelle (le froid, la chaleur). Dans la première catégorie causale, les maladies de conception prosécutive apparaissent plus dangereuses que les autres quant au pronostic vital du patient. Une maladie qui survient brutalement a souvent pour causalité principale l’action d’un sorcier «evu». L’agent pathogène est alors le principe vital d’un sorcier qui se dédouble et se métamorphose pour transmettre la maladie. Manga Essomba, 49 ans, informateur à Soa dit d’ailleurs à ce sujet que : «le moustique en soit même ne transmet pas le paludisme, mais que c’est le sorcier malfaiteur qui se métamorphose en moustique pour sucer le sang d’une personne la nuit pendant le sommeil».
La nuit, le sorcier devenu moustique par métamorphose arrive et commence par la violence, l’agression et le malade s’agite, se bat, se défend en disant par exemple qu’il n’a rien fait de mauvais, qu’on le laisse, et qu’on arrête les murs de la maison qui veulent tomber sur lui. Cette agression provoque une altération des composés anthropologiques (le corps, l’esprit et l’âme) du malade qui a pour effet une détérioration des fonctions corporelles. Vue de cette façon, le sorcier est responsable de la maladie. Or, les symptômes d’un paludisme grave ou neuropaludisme montrent que le malade peut avoir des crises et des convulsions qui le mettent dans un état d’hallucination. Une hallucination auditive va faire entendre au malade des voix étranges dans un monde paradisiaque et une hallucination visuelle le fera voir des hommes à la queue, des femmes aux cornes, des musiciens en concerts, des agresseurs aux armes les plus sophistiquées etc. Les professionnels de santé n’évoquent pas le plus souvent la prise en charge psychologique des malades dans la lutte contre le paludisme, maladie redoutable qui serait responsable dans une large mesure de la mortalité infanto-juvénile.
En contexte «Ewondo», les motivations de l’agresseur sont nombreuses. Il peut alors décider de tuer un de ses descendants en ligne agnatique par simple jalousie. Par exemple, si votre fils a réussi à l’école et que le sien n’a pas pu, on le tue par jalousie. Un aspect où intervient régulièrement la sorcellerie est l’héritage en lien avec le foncier. Les règles de succession et de l’héritage chez les « Ewondo » sont contrôlées et vont de générations en générations. Les conflits dégénèrent et passent par la maladie lorsqu’un héritier veut s’approprier sans partager les espaces terriens laissés à la disposition de la famille. Le rapport entre la maladie et la situation pathogène est effectué par la famille sous l’effet des représentations et parfois reporté chez le devin du village. Plusieurs mythes témoignent de l’existence des maladies, de leurs origines, des pratiques médicales et des représentations qui en découlent.
On comprend donc que la sorcellerie est une catégorie causale des maladies à interprétation persécutive. On peut alors distinguer la sorcellerie spirituelle des «ewondo» – où le sorcier «attaque» le principe vital d’une personne en passant par une maladie, de la sorcellerie instrumentale qui nécessite des recours matériels divers (plantes dangereuses, fétiches, poisons) et qui agresse directement le corps humain. La première vise la destruction, la mort de la personne humaine tandis que la seconde cherche surtout à obtenir la mise en échec d’un adversaire pour avoir la main mise sur sa volonté. Les «ewondo» se plaignent de ces pratiques de sorcellerie qui n’aident pas à construire, à développer, mais qui contribuent uniquement à faire du mal.
En langue « ewondo » de la région du Centre, «mvoâ» et «okoân» sont deux termes génériques pour désigner respectivement la santé et la maladie. La localisation de la maladie sur le corps viendra se greffer au mot «okoân» pour spécifier le mal. Par exemple «okoan a boum» veut dire le mal de ventre. L’«edip» justement occasionne des bourdonnements de ventre et le patient se sent mal. Lorsque la maladie a un nom spécifique, on ne le désigne plus par le terme «okoân», mais par elle-même. Certaines maladies sont aussi désignées par l’organe atteint, à l’exemple de «okoanésseuk»; «ésseuk» qui veut dire foie et «okoân» maladie. Littéralement, «okoânésseuk» veut dire la maladie du foie et désigne l’hépatite.
Les idiomes culturels de la santé et de la maladie donnent souvent sens à la compréhension de ces concepts dans une socioculture quelconque. Dans une étude réalisée par Peguy Ndonko 2009 chez les Bangangté de l’Ouest Cameroun, la santé en langue «medumba» se dit «Ntswê’me bwó» (être bien assis, bien-portant). Être bien assis est la position idéale de l’homme en santé par opposition à l’homme couché, alité, malade qui ne peut se tenir débout. Dans cette même culture, être couché ou alité en journée est synonyme de « mauvaise santé » par rapport à la nuit qui correspond au temps de repos «fite» et du sommeil «miag’louh». Certes, il a existé des sociétés humaines où être couché ou alité était synonyme de mourir. Au moment de dormir, les populations s’accrochaient sur un troc d’arbre et serraient leur corps contre l’arbre à l’aide d’une corde.
L’état de santé de l’individu se lit aussi sur son attitude et son aptitude physique. En langue «médúmbå», la maladie est désignée sous le vocable de «ngou’kád». L’essai d’analyse ethnolinguistique de ce concept montre que ce terme est composé de deux mots. Le mot «ngou» qui signifie d’une part «l’appartenance à» et d’autre part, sert aussi de dénomination dans le nom d’éloge comme «ngou’ntse» (la fille de l’eau, le poisson). On retrouve ce mot dans l’expression «ngou coè», nom d’éloge qui signifie dans cette même langue la fille de la guerre, «ncoè» désigne la guerre. Le mot «kad» est un diminutif du verbe pronominal «kadte» signifiant se promener. Si le verbe «kadte» perd son «e» final, il devient «kad» et signifie se prostituer. Dans un autre sens, «ngou kád» signifie la fille qui se promène, qui se prostitue et s’expose aux maladies sexuellement transmissibles par l’entretien dans rapports sexuels avec de multiples partenaires. L’expression «ngou kád» désigne donc la maladie, ce que l’on attrape en se promenant ou mieux en se prostituant. Le malade ou le porteur de la maladie est alors dit «nga.ngou’kád». Vu dans la perspective des maladies, presque tout le monde dans cette culture est un malade qui s’ignore peut-être. Mais il existe aussi des expressions génériques pour désigner l’état de santé d’une personne. On parle alors de «wud’kébwó» pour désigner le corps qui n’est pas bon, le mauvais corps. L’expression «wud’kébwó» désigne l’état de santé du corps alors que «ngoukád» renvoie à la maladie. On peut encore désigner la maladie par la douleur en indiquant la partie du corps affectée. Ainsi, on parlera de «yatu» pour désigner la douleur de la tête ou les céphalées. La maladie peut également être désignée simplement par la partie du corps affecté.
2.2. Les manifestations de la maladie dite «edip» ou «ndiba»
Les personnes interrogées définissent l’«edip» comme la forme évolutive du «ndiba» et la compare surtout à un piège qui attraperait, tuerait les fœtus dans le ventre de façon à ce que les femmes accouchent des mort-nés. En effet, Mimbé Solange, 37 ans, Soa, dit que Le «ndiba» est la maladie qui tue les enfants dans le ventre et même après la naissance. La maladie se propage dans tout le corps de la femme, puis dans le corps de l’enfant dans le ventre, le fœtus vit, grandit et à un moment, il est rongé par la maladie, il manque d’oxygène, il se bat et la femme trouve que son enfant a beaucoup bougé aujourd’hui, demain, il ne bouge plus, elle pense que son enfant dort. Ce sommeil est définitif, l’enfant vient de rendre l’âme, une semaine après, la femme commence à ressentir des douleurs au bas ventre, une fois arrivée à l’hôpital, on lui apprendra que son enfant ne vit plus… L’ « edip » est une mauvaise maladie ». Les manifestations de la maladie dépendent de la constitution individuelle de tout un chacun. Les femmes se plaignent des démangeaisons au niveau des seins, d’autres sur les parties génitales. L’ «edip» se manifeste par les démangeaisons sur la peau, en particulier les aisselles, les avant-bras, les seins et les parties intimes. Elles s’érigent en blessures lorsque les soins ne suivent pas. Les jambes grattent et les femmes ont des pertes blanches continues tandis que l’homme éprouve une éjaculation précoce, une impuissance (incapacité pour un homme d’obtenir ou de maintenir une érection), une faiblesse sexuelle (érection difficile) et du pus dans le sperme, parfois des blessures ou des boutons sur le pénis et la bourse. Chez les enfants, les démangeaisons se transforment en furoncles et ils se grattent sans cesse. Les gerçures (tâches noires) sont visibles au niveau des aisselles, des cuisses et des seins chez les femmes. Les parties génitales sont atteintes par des boutons que ce soit chez l’homme ou chez la femme comme déclarent la majorité de nos informateurs.
2.3. L’«edip» et le «ndiba» : une cause de l’infertilité humaine
L’infertilité selon Larousse Médicale (2007) est l’incapacité pour un couple de concevoir un enfant. Elle se définie par les populations comme la recherche infructueuse de mettre au monde au enfant vivant. Les patients qui consultent pour des problèmes de procréation dans les formations sanitaires et qui ne trouvent pas une solution idoine à leur mal ont le plus souvent recours aux tradithérapeutes spécialistes du traitement de l’ «edip» et du «Ndiba». Ces maladies sont à l’origine de l’infertilité et de la stérilité chez beaucoup de personnes. Certains traditherapeutes construisent ou inventent une cause à cette infertilité et laissent entendre que les couples qui sont victimes de ce mal seraient confrontés à la question de la dot. C’est ce qui ressort du témoignage de Didier, 36 ans, Yaoundé : « Au départ, on nous a dit que c’est un problème de dot, on a fait la dot, maintenant rien n’a changé, ensuite on a dit qu’est c’est les mauvais esprits, on nous a soigné contre les mauvais esprits, rien! On ne sait plus à quel saint se vouer ». La maladie, considérée dans cette perspective, interpelle les individus qui prennent les femmes sans dot à retourner vers cette pratique qui assure et garantie les liens de mariage. Il est aussi fréquent d’entendre que la mort du fœtus est liée à la colère des ancêtres et il faut les apaiser à tout prix pour que cela n’arrive plus. Odile Journet(1990) relève dans la société casamançaise le cas d’une femme qui a perdu consécutivement quatre enfants en bas-âge, tout en faisant allusion au long rituel que cette dernière doit entreprendre pour conjurer cette douloureuse répétition. Dans la majorité des zones enquêtes dans cette étude, le rituel du met de pistache conjure cette fréquence.
Les hommes atteints de cette maladie présentent des troubles de leur sexualité. Une faiblesse sexuelle caractérisée, la baisse de la libido, une liquéfaction totale ou partielle du sperme, des douleurs dans les testicules, une inflammation d’un ou des deux testicules, la perte de l’envie sexuelle. L’analyse du spermogramme des patients de cette maladie n’augure aucun lendemain meilleur pour les patients. Les personnes qui recourent aux soins connaissent des résultats probants comme nous l’affirme Jean Paul, 49 ans : «Apres tant d’année de prostitution médicale, j’ai finalement compris que le «Ndiba» est une mauvaise maladie pour les gens qui cherchent à avoir un enfant. Quand nous avons été soignés, ma femme a conçu 2 mois après et au moment où je vous parle, elle est enceinte de 6 semaines 3 jours ».
2.4. Le rite et le bain de siège pour soigner le «ndziba»
Marie-Paule (de) The (1970), Jeanne-Françoise Vincent (1976), Theodore Tsala (1958) reconnaissent les rites réservés aux femmes désireuses de devenir mères et qui pensent qu’une souillure «olanda» personnelle ou héréditaire (inceste, abattage clandestin d’un animal domestique, enterrement d’un cadavre humain par une femme, etc.) les rend stériles. Parfois, toute la famille y participe. Le médicament du «ndziba» soigne non seulement la femme stérile mais encore la femme enceinte, celle qui vient d’accoucher, et même tout homme, femme et enfant ayant des pustules ou des bulles immunologiques sur les parties génitales ou sur une autre partie du corps. On a observé chez d’autres patients des bulles immunologiques sur le nombril et dans la bouche voire sur tout le corps. Pendant le rite qui accompagne le traitement, le patient s’assied sur un tronc de bois sec. Le thérapeute debout devant le (ou les) patient tient dans la main gauche un cornet en feuilles de «mian», et de la droite un pot de médicaments. Présentant son pot au malade, il lui crie par trois fois : «ndziba» ; puis il lui verse dans la bouche le médicament par le petit cornet. La femme enceinte se fait ensuite un cataplasme de tous les ingrédients. Le guérisseur remet ensuite une marmite qui contient des écorces, des feuilles et des oignons sauvages «medzun» pilés, ainsi que du poivre de Guinée «ndong», le tout délayé par le guérisseur dans du vin de palme. «Ndzibu» vient peut-être du verbe «ndzi» qui signifie transpercer. L’ingurgitation du médicament par un petit cornet illustrerait cette action. Ceux qui ont de l’eczéma ou des pustules sont enduits de liquide sur les parties malades par un homme ; ils frottent ensuite eux-mêmes ce produit sur leurs plaies pour laver le «ndziba» et purifient, fortifient le sang, ôtant ainsi les maux de ventre.
2.5. Les femmes entre mort fœtale et fausses couches
Questionner les femmes enceintes et leurs enfants au Cameroun, c’est chercher à améliorer l’accès aux soins et l’observance des traitements auxquels elles sont soumises. Pour atteindre cet objectif, il faut comprendre et analyser les systèmes d’interprétation populaire de la maladie en question. A travers la littérature, on se rend à l’évidence que dans de nombreux contextes, des études d’anthropologie, de sociologie, de psychologie clinique, de sociolinguistique essayent d’expliquer les représentations profanes des symptômes évoquant les maladies et à comprendre comment une langue, et la culture qu’elle reflète et détermine, décomposent selon des traits spécifiques le malheur.
Cette approche paraît utile dans la mesure où elle permet à la longue de constituer un lexique de pathologies existant en mettant en relation des termes de la langue avec des symptômes qui, d’un point de vue médical, par exemple, peuvent évoquer le paludisme. Sinon, comment dialoguer et conduire un entretien clinique sans se comprendre ? Voilà encore une des spécificités auxquelles les actions de santé destinées aux populations, pour être efficaces, doivent tenir compte. Les soignants du secteur biomédical reconnaissent à travers les entretiens réalisés auprès d’eux que les patients qui viennent en consultation relèvent d’horizons culturels très variés et sont confrontés à des enjeux de valeurs fondamentales de justice sociale et d’altruisme. La rencontre de ces usages avec des organisations sanitaires de plus en plus complexes, cloisonnées et spécialisées peut être source d’incompréhension dans la mise en place d’accompagnement ou de soins.
Les représentations sociales contribuent à l’orientation des conduites et des rapports sociaux. Elles servent d’outil de communication entre les membres d’un même groupe et constituent en même temps un code pour les échanges entre l’individu d’un groupe social donné sur l’objet de la représentation. Dans le cas du «ndiba» et de l’ «edip», les langues locales du pays en tant que indicateurs linguistiques permettent de dénommer les troubles pathologiques. La prise en compte de la dimension syntagmatique (contexte linguistique où chaque terme apparaît), présente dans les collocations et la phraséologie de chaque langue, peut renseigner sur la gravité présumée d’un trouble pathologique, sa cause, son issue et éventuellement sur d’autres traits culturels. Savoir comment le chlamydiae est désigné dans une langue locale peut contribuer sur la perception de la maladie et, parfois, sur les pratiques du groupe social locuteur de la langue vis-à-vis de cette pathologie. Comment comprendre cette maladie et ces enjeux ?
2.6. Les femmes et la perte de leurs nouveau-nés
La maternité est un phénomène important dans la vie d’une femme et d’une famille. Un couple qui n’a pas d’enfant, une femme, un homme qui n’a pas d’enfant se sent diminué sur tous les plans. La perte d’un enfant encore dans le ventre ou à la naissance est un moment difficile qui affecte le couple et surtout la femme sur les plans psychique et social. Odile Journet (1990) avait déjà relevé la condition de la femme dans les obligations de la procréation dans les sociétés diola du Sénégal et de la Guinée-Bissau. L’auteur étudiait dans ces sociétés, les accidents de la procréation auxquels les femmes sont confrontées. La mortalité infanto-juvénile, l’avortement spontané et la stérilité sont des situations fréquentes. Ensuite, la femme qui perd son enfant n’est pas culturellement tranquille, elle doit subir des rites afin d’éloigner le malheur hors de son ventre, de son corps, de son couple, de sa famille. Ce type de fait est relevé dans la localité de Mfou par Leonie, 34 ans, raconte sa capture ou sa fuite après une longue période de prostration et d’errance en ces termes : « Quand j’ai perdu mon huitième enfant, je voulais mourir, ma vie n’avait plus de sens, je restais là à la maison, les bras croisés, je réfléchissais comment me suicider parce que plus rien ne donnait pour moi. Quand les femmes passaient avec leur enfant au dos pour aller aux champs, j’éclatais en sanglot. Le soir quand les autres femmes de mon âge allaient danser, je me posais mille et une questions. Parfois, je dormais à la belle étoile jusqu’à ce que mon mari me ramène à l’intérieur. Mieux valait être tuée par quelque chose. Ou bien j’errais la nuit dans le village jusqu’à ce que quelqu’un me ramène. On a tout fait, on a tout entendu ».
A Soa, Laurentine, 31 ans, mère de deux enfants, avait perdu un enfant dans le ventre en 2014, elle avait fait un mort-né en 2015. Le troisième qu’elle a accouché par césarienne est mort le lendemain de sa naissance. Le quatrième est mort dans le ventre, à sa sortie, le fœtus était déjà dans un état de décomposition avancé. Le cinquième alors, toujours avec le cerclage, est sorti huit semaines après. Jusqu’à ce qu’on m’indique un monsieur qui m’a fait accoucher sans cerclage et sans difficultés. A l’hôpital, les sages-femmes et les infirmières lui disent qu’elle a l’ «edip» et qu’elle doit se soigner traditionnellement. Cette maladie est donc reconnue comme celle qui ne se soigne pas à l’hôpital (biomédecine). Elle pleure et dans ces pleurs, elle dit que c’est la deuxième fois que cela lui arrive. Elle pleurait chaque fois qu’elle se sentait isolée. De retour de l’hôpital, elle défait la valise qui contenait la layette, partage les habits à ses camarades qui venaient lui rendre visite. Elle sent mal à la tête et tout son corps pèse. Elle avait d’ailleurs bénéficié d’un repos de 45 jours. Elle devenait violente dans ces propos. Elle jalousait les autres femmes enceintes et celles qui venaient d’accoucher et donc les enfants étaient nés vivants. Pour rentrer à la maison, elle a fait venir sa petite sœur qui venait d’accoucher pour porter son enfant et donner à croire aux voisins qu’elle avait accouché normalement. Les voisins sont venus à mon secours comme à l’accoutumée et ont constaté qu’elle est rentrée sans son nouveau-né. Elle a pleuré à chaudes larmes, nous raconte-elle.
Ce témoignage de Gustave, 32 ans est aussi poignant ; « Mon épouse et moi sommes mariés depuis trois ans et deux fois de suite, nous avons perdu nos bébés. La première fois, le bébé est mort quelques heures après être venu au monde et la deuxième fois qui était, il y a quelques jours, le bébé est mort trois mois après l’accouchement... Après avoir passé deux semaines sous oxygène, pour des raisons qu’on ne peut vraiment pas expliquer, l’hôpital a parlé d’un genre de pneumonie, mais après avoir consommé plusieurs boites d’antibiotiques, elle a fini par mourir. Juste après sa mort, certaines langues parlaient de problème de dot, et bien d’autres choses relevant du surnaturel, mais aussi certaines personnes m’ont dit que ça doit être l’ «edip». Pendant la grossesse et même jusqu’à maintenant, ma femme a des démangeaisons, même sur les seins, après l’accouchement même, les abcès, (elle a déjà pris les antibiotiques, jusque-là rien), les boutons sur les parties intimes qui laissent les tâches noires. Quand elle a même accouché, on a dit que son sein est gâté, parce que quand l’enfant tétait, il faisait les selles verdâtres, alors elle a pris des choses pour arranger les seins, rien… »
2.7. Le «ndiba» et l’«edip» : une maladie-piège
Les populations enquêtées ont relevé à maintes reprises la présence d’une éruption cutanée comme maladies fréquentes. Les signes cliniques sont facilement perceptibles. Les éruptions cutanées ont une survenue, le plus souvent brutale, de lésions cutanées ou muqueuses. Nous sommes sans ignorer qu’une éruption peut être d’origine infectieuse comme les éruptions fébriles contagieuses de l’enfance (rougeole, varicelle ou zona). Elles peuvent être associées à des infections virales ou à des maladies parasitaires. Les maladies qui engendrent une éruption cutanée et reconnues par les populations sont le «ndiba» ou l’ «edip». La maladie est ainsi nommée selon les sociétés et les cultures. La maladie prend son sens dans un contexte culturel particulier. Chaque culture a une attitude qu’elle adopte vis-à-vis des personnes malades. L’interprétation de la maladie, l’appellation et le traitement vont pour ainsi dire varier selon les milieux culturels.
L’approche «etic» de la maladie donne à comprendre qu’il s’agit d’une maladie sexuellement transmissible, maladie contagieuse due aux germes et se transmet d’une personne malade à une personne saine par le biais des rapports sexuels, de la salive, de la sueur, des échanges de vêtements souillés, de l’utilisation des douches communes et d’une mauvaise hygiène de vie. Dans une approche «emic», on dira que la maladie est aussi contagieuse, résultat de la transgression culturelle. Le «ndiba» ou l’ «edip» se manifeste par des éruptions cutanées sur les parties génitales en général, les seins ou le bas ventre et parfois sur tout le corps si rien n’est fait. La biomédecine l’identifie par une série de maladies infectieuses à manifestations cutanées à l’instar de la rubéole, de la toxoplasmose, des mycoplasmes, de la syphilis, de la blennorragie et du chlamydiae.
Cette maladie est reconnue dans cette société comme celle qui atteint les femmes très fécondes. Dans cette culture, une femme sexuellement active doit faire des lavages ou purges lui permettant de nettoyer son organisme pour se libérer des maux de cet ordre. De l’avis de certaines informatrices, l’ «edip» est considéré comme un « poison » parce que la femme ayant l’ «edip» et faisant la maladie ne peut avoir d’enfants. Elle peut arriver à concevoir, mais avec les possibilités très faibles d’arriver à terme et elle fera face à des problèmes de fausses couches, d’enfant mort-né, des prématurés ou ayant des malformations s’ils survivent. Flore, femme de 29 ans, résidente à Yaoundé, mariée, relate son cas : «J’ai fait consécutivement cinq morts nés sans que je ne trouve une explication médicale. Le sixième est né avec une malformation et décédé une semaine plus tard. J’ai fréquenté les églises de réveil à la recherche de solutions, en vain. A un moment, j’ai cru que j’étais attaqué spirituellement jusqu’à ce que je lise vos travaux sur cette maladie».
Les enfants nés avec une malformation sont taxés d’enfants sorciers et parfois rejetés par la famille, abandonnés à eux-mêmes. Les infections seront à l’origine des malformations et du handicap chez la majorité des enfants. Dans une autre perspective, une femme faisant la maladie peut réussir à conserver sa grossesse mais les possibilités de survie de l’enfant sont très faibles car la mère est malade et son mal attaque également les seins, il lui est alors impossible d’allaiter le nourrisson. L’ «edip» se convertit en un fluide corporel qu’on appelle « eau sale, eau du vampire » de couleur jaunâtre qui coule du vagin et se mélange au sang menstruel. Pendant le traitement, ce liquide sort du vagin par des saignements en caillots de couleur jaunâtre, parfois sanguinolente. La patiente éprouve de la douleur pendant les rapports sexuels et perd progressivement cette envie. Le nourrisson qui survit à cette maladie et allaite aux seins empoisonnés par l’ «edip» de la mère ne pourra pas survivre jusqu’à l’âge de 15 ans, expliquent les informateurs pendant l’enquête.
L’ «edip» devenu chronique avec le temps lui donne un accès fébrile qui le conduit à trépas. L’enfant n’est jamais bien portant ; il peut avoir une malformation physique, la peau forme des traces semblables aux teignes. Pour le mort-né, la peau s’arrache et la chaire est visible, la tête est macérée à plusieurs degrés. On parle de mort-nés macérés au premier, deuxième, troisième degré. Eveline, 26 ans, Yaoundé, explique : « Quand j’ai fait l’échographie, on m’a dit que j’ai un mort-né de deuxième degré dans le ventre et je devais évacuer rapidement. L’enfant est sorti mort après presque 24 heures de travail. La douleur, les pleurs, j’étais passée à côté d’une crise de folie, c’est horrible de perdre son enfant dans le ventre, c’est autant horrible de l’évacuer, noooon ! ».
Le mal a dit (mal-a-die) de chercher son sens dans la culture. L’étymologie du mot «edip» dans la langue beti a pour racine «dip» qui veut dire bloquer et exprime le fait de l’être. Le verbe se forme à partir du nom pour décrire l’action. Ainsi le nom est précédé de « a » qui se prononce [ä]. Par exemple : «adip» veut dire bloquer. D’après l’idée initiale dans l’histoire de cette maladie en contexte Beti, les ancêtres l’ont comparée à la prise de piège qu’on utilisait pour attraper les oiseaux, à l’aide d’un liquide que l’on composait à base d’une sève de l’arbre «ekekam» et dont le produit obtenu s’appelle «nkam».Toute personne qui contacte l’ «edip» s’expose comme un oiseau qui ne peut plus échapper au piège.
Jeanne, 21 ans, Megong, témoigne : « L’« edip » est une mauvaise maladie qui dérange les gens ici au village. Quand tu ne connais pas, l’ «edip» tue ton enfant dans le ventre ou bien tu fais des mort-nés. Pour savoir que quelque chose ne va pas, la femme a la fièvre subitement, elle sent trop froid ou trop chaud, quand l’enfant est déjà mort dans le ventre. Le témoignage de cette femme peut aider à comprendre les raisons de décès des enfants dus au paludisme ou à la fièvre. L’ «edip» ou le «ndiba» rendu à un état chronique devient asymptomatique et se manifeste par la fièvre et les symptômes du paludisme.
L’ «edip» est une maladie contagieuse et la contagion se fait de diverses façons: transmission de la mère à l’enfant par le canal du cordon ombilical, échange des vêtements ou utilisation commune des linges ; les relations sexuelles avec des partenaires multiples, la salive… Le mot «edip» dérive du verbe «dipe» en Béti qui traduit le fait de prendre ce qui ne vous appartient pas. L’ «edip» apparait ici comme un instrument de contrôle social dans cette société. La maladie permet et oblige en quelque sorte les couples à être fidèle les uns les autres. L’ «edip» sanctionne les couples infidèles. Cette maladie peut aussi provenir de la transgression des interdits culturels, par exemple : une fille qui traverse une racine d’arbre produisant encore de la sève sur un sentier. La fille qui a transgressée la racine d’arbre a commis l’adultère.
Une femme enceinte contaminée par l’«édip» fait boire de cette eau sale au fœtus dès le deuxième mois de grossesse, il est alors rare que la grossesse arrive à terme. La mort fœtale survient au bout de quatre, six, huit mois de grossesse. A plusieurs reprises, la femme qui fait des morts fœtaux pose à son entourage de sérieux problèmes de soupçon de sorcellerie. On accuse soit le mari de « vendre » les enfants dans le «nkong» à partir du fœtus ou une tante qui a un mauvais œil ou encore une personne qui a eu des problèmes avec la femme enceinte pendant la grossesse.
Cette affirmation réconforte les femmes qui perdent leur enfant au cours de la grossesse. L’ «edip» empêche aux femmes de concevoir et les rendent stériles quand la maladie devient chronique. L’eau sale de l’«edip» s’accumule dans l’utérus et donne du volume à l’estomac ou occasionne des kystes et les myomes multiples (Utérus polymyomateux). Et si une échographie atteste qu’elle a les myomes, ces tumeurs sont responsables de l’infertilité, pourtant, ce n’est pas toujours le cas. L’ «edip» se manifeste cliniquement chez les femmes aussi par des démangeaisons de la peau ou des seins qui laissent des tâches noires. Le sang menstruel se constitue en caillot de couleur noir foncé, puis débouche à une absence des règles (aménorrhée). L’ «edip », bien que différent du «ndiba» se soigne presque de la même façon.
2.8. Les pratiques thérapeutiques du «ndiba» / «edip» et communication
Les personnes habilités à soigner cette maladie sont généralement les femmes ménopausées et des personnes initiées à cette pratique. Elles sont reconnues comme des spécialistes de ces maladies. Il est dit que les patients doivent se faire soigner par au moins trois femmes ménopausées différentes ou des initiés. Les deux partenaires vont recevoir des soins intensifs ne relevant pas de la biomédecine pendant une période de quatre-vingt-dix jours selon la gravité de la maladie. Le traitement existe sous plusieurs formes allant des bains de purification au traitement par voie orale, nasale et anale. Les essences végétales pour cette thérapie sont connues et le conditionnement relève de la compétence des spécialistes. Pendant les enquêtes, nous avons identifié toutes les plantes qui contribuent à soigner cette maladie ; nous les avons conditionné telles que indiqués par les praticiens et avons administré les décoctions à plusieurs autres personnes souffrant de cette maladie. Nous les avons suivis pendant leur traitement et à la fin, la majorité de ces patients avaient trouvés leur guérison. Les résultats étaient probants et plusieurs personnes guéries ont recommandé les leur ayant les mêmes souffrances ou les maux similaires à nous contacter pour les soins. Les personnes reconnaissantes revenaient nous présenter leur progéniture en signe de remerciement et laissaient un cadeau pour le souvenir. En Afrique, les soins ne se payent pas seulement par l’argent, mais aussi par la gratitude, la construction d’une relation sociale entre le soignant et le soigné.
Pour éradiquer l’ «edip» au sein d’un couple, les deux partenaires doivent se soigner conjointement et soigner les enfants qui sont nés avant la découverte de la maladie sinon, ces enfants peuvent aussi décéder. Il est même conseillé dans le traitement de recourir à des spécialistes tant la complexité de la maladie et du traitement exigent des compétences singulières. Les patients qui se soignent de l’ «edip» doivent observer des restrictions alimentaires pendant le traitement. Il leur est strictement interdit de manger certains aliments issus de notre agriculture tels que : le gombo, l’ananas et bien d’autres aliments selon les allergies de chaque patient pour éviter les récidives et ne pas perturber le traitement.
Outre ces mesures de traitement, la pratique du rite piaculaire intègre le traitement. La mort fœtale, comme autre forme de mort, engendre une série de représentations. Dans ce contexte, tout malheur, tout ce qui est de mauvais augure, tout ce qui inspire des sentiments d’angoisse ou de crainte nécessite un «piaculum». Il faut attacher l’enfant dans le ventre et le détacher ensuite pour que la femme puisse accoucher. Le met de pistache est le symbole de la fécondité, de la grossesse et de l’accouchement. Attacher le met de pistache (pétrit au départ avec de l’eau et autres médicaments) dans la feuille et le mettre dans la marmite (représente le ventre de la femme qui porte l’enfant jusqu’à terme) pour le cuire signifie : attacher l’enfant dans le ventre. Détacher, ouvrir le met de pistache après la cuisson, donc la maturité du fœtus, c’est ouvrir le ventre, accoucher, montrer aux yeux de tous.
En plus de ces pratiques thérapeutiques, une communication par la prévention et l’éducation semble nécessaire. La lutte contre cette maladie sexuellement transmissible «ndiba» ou «edip» ne sera réellement efficace que si l’information est adaptée aux besoins de la population cible que sont les femmes et les hommes en âge de procréer, les enfants nés dans un contexte infectieux. Le temps d’une seule et même campagne pour tous est révolue. Différents canaux sont actuellement utilisés pour tenter d’assurer une prévention de cette affection bactérienne, la plus efficace possible. Nous préconisons la création des centres d’information dans le service de maternité des formations sanitaires. Leur rôle sera de délivrer une information individuelle adaptée au profil des femmes qui viennent en consultation prénatale. Cette information est ciblée sur les problèmes exposés par le patient et reste confinée à la dualité de la consultation. Elle portera sur les modes de contaminations possibles intéressant le sujet : sexuelle, salivaire, sudation, contact. Elle est complémentaire à celle menée sur le terrain, car à la différence de ces dernières qui sont collectives, le rapport individuel créé par la consultation permet d’aborder les problèmes spécifiques du sujet. D’autres formes de communication peuvent compléter la précédente.
Conclusion
Au terme de cette réflexion sur les maladies infectieuses à l’origine de l’infertilité des couples et de la mortalité infanto-juvénile il ressort que les populations attribuent une cause mystique à leur état de santé et à la mort du fœtus anté-partum ou post-partum. Chaque société ou culture a une conception pour toute maladie et même une attitude propre qu’elle adopte face à la maladie. Chaque culture à ces représentations de la maladie et un traitement approprié à un mal, car la maladie de l’individu est liée à sa culture. On comprend ici que la maladie n’est plus seulement un fait biologique, mais un fait social et un fait social total, car elle interpelle d’autres faits de la structure sociale. L’«edip» et le «ndiba» sont deux termes qui désignent les maladies infectieuses sexuellement transmissibles. Yvan Touttou (2002) dit qu’ « une maladie infectieuse est la conséquence de l’agression d’un organisme vivant par un ou plusieurs micro-organismes. Ces derniers sont disséminés dans l’environnement tel que l’air, le sol, l’eau mais ils peuvent également être retrouvés dans des réservoirs tels que les aliments, les animaux ou les humains, porteurs sains ou infectés. La transmission s’effectue soit par contact direct avec l’un de ces réservoirs, soit par contact indirect par le biais d’un vecteur vivant ou non.». Dans cette étude, les populations connaissent bien la maladie et expliquent son origine par la multiplication des partenaires dont les relations aboutissent à la sexualité. Il s’agit en effet des maladies liées à l’infidélité des partenaires dans un couple et des professionnels ou travailleuses de sexe ou prostituées qui sont les personnes les plus exposées. Les facteurs socioculturels favorisent également des comportements de sexualité à risques. Cette maladie apparaît dans ce contexte culturel comme un poison qui tue d’abord les fœtus chez les femmes enceintes et même si l’enfant nait, ce dernier meurt par la suite car il est né avec la maladie et le lait maternel qu’il prend est également empoisonné, sale, infecté. Les dispositifs thérapeutiques issus de cette société permettent d’éradiquer le mal en passant finalement par des bains et des repas rituels. La sensibilisation par la mobilisation sociale peut contribuer à réduire le fossé des maladies infectieuses au Cameroun.
Références
Références bibliographiques
ABEGA Severin. Cécile, 1999, « Eau sale, eau propre, eau impropre ; L’exemple du rapport à l’eau chez les Béti ». In S. Bahuchet, D. Bley, H. Pagezy, N-Vernazza-Licht, L’Homme et la forêt tropicale. P.661-674.
ADJAMAGBO Agnès, MSELLATI Philippe, VIMARD Patrice, 2007, Santé de la reproduction et fécondité dans les pays du Sud. Nouveaux contextes et nouveaux comportements. Louvain-la-Neuve (BEL) ; Marseille : Academia Bruylant ; LPED.
ETAME-LOE Gisèle, NGOULE Charles Christian, MBOME Berthe, KIDIK POUKA Catherine, NGENE Jean Pierre, YINGANG Jacques, OKALLA EBONGUE Cécile, NGABA Guy Pascal, DIBONG Siegfried Didier, 2018, Contribution à l’étude des plantes médicinales et leurs utilisations traditionnelles dans le département du Lom et Djerem (Est-Cameroun), Journal of animal and plant Sciences, Vol. 35, Issue 1 : 5560-5578.
RAIMI Fassassi, KOKOU Vignikin, Vimard Patrice (dir), 2010, La régulation de la fécondité en Afrique : Transformations et différenciations au tournant du XXIe Siècle, LPED, GRIPPS, AB.
FOSTER M. Georges and. ANDERSON B. Gallatin, 1978, Medical anthropology, New York: John Wiley and Sons.
GUIGMA Marie-Gisèle, 2012, Situation de la santé maternelle et infanto-juvénile, Bruxelles, Belgique, Assemblée parlementaire de la francophonie, Réseau des femmes parlementaires du Burkina-Faso.
INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE, 2012, Enquête démographiques et de santé et à indicateurs Multiples, Calverton, Maryland, USA.
JOURNET Odile, 1990, La Condition des femmes : les obligations de la procréation dans les sociétés diola du Sénégal et de Guinée-Bissau, In Didier Fassin et Yannick Yaffré, Sociétés, Développement et santé, Paris, ELLIPSES.
LAROUSSE, 2007, Petit Larousse de la médecine, Espagne, Mateur Cromo.
MADZOUKA Jean, 1991, « La transmission des normes aux jeunes : quels modes préférentiels ? », Actes de la Conférence “Femme, Famille et Population”, Union pour l’Etude de la Population Africaine, Burkina-Faso, avril 1991, vol. 1 : P. 193- 204.
MARSAUDON Eric, 2002, Maladies infectieuses et VIH, Paris, Editions Vernazobres, MEMO 1. IFSI. Collection dirigée par Yvan TOUITOU.
RWENGE Mburano, 1995, Facteurs contextuels affectant les comportements sexuels des jeunes en milieu urbain camerounais. Le cas de la ville de Bamenda, Nord-Ouest Cameroun. Rapport de Recherche, Programme des Petites Subventions de l’UEPA.
NDONKO Peguy ,2009, Les usages de l’eau au Cameroun : contribution à une étude anthropologique des maladies endémiques d’origine hydrique, Marseille, Université de Marseille, These de Doctoract.
RETEL-LAURENTIN Anne, 1974, Infécondité en Afrique noire. Maladies et conséquences sociales, Paris, Masson, P.188.
SCHOFIELD Michael, 1971, « The sexual behaviour of young people », in J. MEDAWAR et D. PYKE (eds), Family planning, Haromond Sworth, Penguin : P. 173-178.
THE (de) Marie-Paule, 1970, Des sociétés secrètes aux associations modernes : la femme dans la dynamique dans la société béti, Paris : Université Doctorat de 3e cycle en sociologie.
TSALA Théodore, « Mœurs et coutumes des Ewondo », Etudes camerounaises, N° 56, Yaoundé, p, 8-112.
VAN Balen, 1958, Analyse van de demographishe gagevens van de chefferis Ezo en Sasa, Belgian Congo (unpublished report).
VINCENT Jeanne -Françoise, 1976, Traditions et transitions ; entretiens avec les femmes béti du Sud-Cameroun, Paris, ORSTOM/ Berger-Levraultt, Coll. L’Homme d’Outre-Mer », p.163.
Downloads
Publié
30/06/2022
Comment citer
Revue Espace, Territoires, Sociétés et Santé ,[En ligne], 2022,, mis en ligne le 30/06/2022. Consulté le . URL: https://retssa-ci.com/index.php?page=detail&k=262
Numéro
Rubrique
Qui sommes-nous ?
Licence
Copyright (c) 2023 NDONKO Peguy