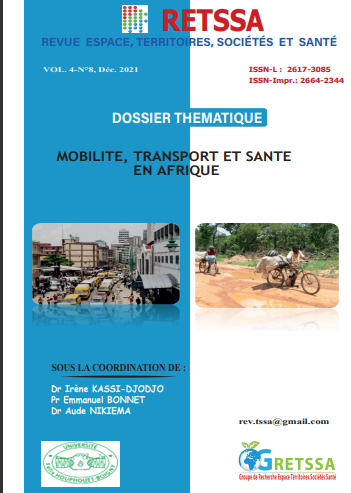4 |MOBILITE PROFESSIONNELLE ET PROPAGATION DES MALADIES EPIDEMIQUES : LE CAS DU VIH/SIDA EN CÔTE D’IVOIRE
PROFESSIONAL MOBILITY AND THE SPREAD OF EPIDEMIC DISEASES: THE CASE OF HIV / AIDS IN IVORY COAST
Mots-clés:
Mobilité professionnelle| migrants| migrants| routiers| commerçants itinérants| groupes socio-professionnels| groupes socio-professionnels| VIH/sida|Résumé
La mobilité professionnelle et la propagation du sida, dans les débuts de l’épidémie en Côte d’Ivoire ont des liens étroits. En effet, à l’émergence de cette épidémie en Côte d’Ivoire, les migrants de travail, les routiers internationaux, les commerçants itinérants et les groupes socio-professionnels à forte mobilité, ont constitué des groupes vulnérables du fait de la mobilité inhérente à leurs activités. Certes, de nombreux facteurs expliquent la propagation de l’épidémie en Côte d’Ivoire, mais au regard des voies de contamination et de la dynamique de l’épidémie, la mobilité des populations reste le principal moteur de dissémination de l’épidémie. Dans un tel contexte, les professions qui exigent des déplacements permanents peuvent constituer des sources de vulnérabilité quand bien même, leurs acteurs ont longtemps été soustraits de la liste des groupes dits « à haut risque », qui ciblait au premier chef, les travailleuses de sexe et des catégories professionnelles sédentaires. D’où, la question de savoir comment la mobilité professionnelle a-t-elle créé un terreau propice à l’explosion de la prévalence du VIH/sida dans certains groupes socio-professionnels et contribué à disséminer la maladie dans la population générale ?
A partir des rapports d’études, des données statistiques sur l’épidémie en Côte d’Ivoire et une revue de la littérature, l’étude met en relief la relation entre la mobilité professionnelle et la propagation de l’épidémie de sida en Côte d’Ivoire en relevant le fort taux de prévalence du VIH dans ces groupes.
Introduction
Depuis les premières enquêtes sur la dynamique et la progression géographique de l’épidémie du sida en Afrique subsaharienne, la Côte d’Ivoire est classée pays le plus touché par l’épidémie en Afrique de l’ouest (A. Zran, 2014, p. 2). Cette situation s’explique par un faisceau de facteurs interconnectés dont l’une des pièces maitresses du dispositif est la forte mobilité des populations sur son territoire. En effet, la sous-région ouest-africaine se caractérise par la très forte mobilité de sa population, « sans doute la plus mobile du continent subsaharien » (R. Lalou, V. Piché, 1994, p. 7). Au cœur de ce cycle de mouvements migratoires, la Côte d’Ivoire est devenue vulnérable à l’émergence du sida dont la flambée est naturellement redevable à la mobilité des populations. C’est pourquoi, M. Caraël (2006, p. 44), souligne à juste titre que :
« Le VIH est un phénomène moderne : il ne pouvait se multiplier qu’au vingtième siècle, à une époque où l’urbanisation, la mobilité, les migrations, les voyages internationaux, transforment le monde en un vaste réseau connecté qui a permis à un virus fiché dans le sang de quelques personnes d’en contaminer plus de 70 millions en moins de quarante ans ».
Dans son ouvrage consacré à l’histoire culturelle de la maladie, M. Sendrail (1980, p. IX), rappelle que « les maladies évoluent d’abord par suite de la dispersion des germes. Les migrations humaines ont toujours entraîné leur diffusion en des régions qui les ignoraient ». La question des mobilités est donc au centre de la réflexion sur la dynamique des épidémies. Déclenchée à une époque où les déplacements humains sont facilités par le développement des voies et moyens de transport aériens, terrestres, maritimes, ferroviaires, etc. l’épidémie du sida s’est rapidement disséminée dans un monde devenu vulnérable. Ainsi, « pendant la dernière moitié du 20ème siècle, avec les voyages internationaux de plus en plus fréquents et les relations sexuelles plus libérales, la population mondiale s’est retrouvée sans le savoir dans une situation de plus en plus risquée » (H. Jackson, 2004, p. 4-5). Au regard de ce qui précède, le sida apparait comme une épidémie de la mondialisation dont la vitesse de propagation est en lien avec les mouvements humains. R. Lalou, V. Piché, (1994, p. 6) expliquent à cet effet que :
« les flux migratoires constituent un phénomène crucial dans l'explication des grandes disparités géographiques de l'épidémie, le mode et l'intensité de cette propagation varient, fort probablement, selon la nature et le type de la migration considérée. Que le migrant se déplace seul ou en famille, à la recherche d'un travail ou pour des raisons politiques, que sa migration soit de courte ou de longue durée, circulaire ou définitive, et que les zones de départ et d'arrivée soient ou non déjà infectées, et le schéma de diffusion de la maladie s'en trouvera vraisemblablement modifié. Il y aurait donc autant de formes et d'intensités de propagation du sida qu'il existe de types migratoires.»
C’est montrer l’importance du rôle qu’a joué la mobilité dans la propagation de l’épidémie en Côte d’Ivoire. La Côte d’Ivoire qui enregistre une forte mobilité professionnelle, constitue un bon angle d’observation de l’impact de ces mouvements sur la dynamique de l’épidémie du sida dans le pays. Certes, de nombreux facteurs expliquent la propagation de l’épidémie en Côte d’Ivoire, mais au regard des voies de contamination et de la répartition géographique de l’épidémie, la mobilité des populations reste le principal moteur de sa dissémination. Dans un tel contexte, les professions qui exigent des déplacements permanents peuvent constituer des sources de vulnérabilité quand bien même, leurs acteurs ont longtemps été soustraits de la liste des groupes dits « à haut risque », qui ciblait au premier chef, les travailleuses de sexe et des catégories professionnelles sédentaires. D’où la question de savoir comment la mobilité professionnelle a-t-elle créé un terreau propice à l’explosion de la prévalence du VIH/sida dans certains groupes socio-professionnels et contribué à disséminer la maladie dans la population générale ?
Cette étude vise à mettre en relief la relation entre la mobilité professionnelle et la propagation de l’épidémie de sida en Côte d’Ivoire. Sans prétendre aborder toutes les formes de mobilité professionnelle, encore moins stigmatiser des corporations dont la bravoure et l’impact sur le dynamisme de la construction de la Côte d’Ivoire sont irréfutablement établis, elle s’attèlera à jeter un regard historien sur l’impact de ce phénomène dans les débuts du sida en Côte d’Ivoire. C’est pourquoi l’accent est mis sur les risques de la mobilité professionnelle en ciblant des activités qui explicitent la situation.
Méthodologie
1. Méthodologie
Le concept de mobilité professionnelle recouvre plusieurs réalités complexes. La mobilité professionnelle peut être un « changement de poste, d’établissement ou d’entreprise, de métier ou de niveau de qualification pour les personnes en emploi, ou encore transitions entre chômage, inactivité et emploi » (F. Lainé, 2010, p. 38). Ce concept peut-être également appréhendé sous trois dimensions, à savoir la dimension organisationnelle, la dimension sociologique et la dimension économique. La dimension organisationnelle considère la mobilité comme une succession d’emplois ou un changement d’affectation dans une structure organisationnelle. La dimension sociologique conçoit la mobilité comme le mouvement d’une personne au sein d’un groupe social auquel elle appartient et la dimension économique distinguent entre deux autres concepts à savoir, la réallocation des salariés et le roulement des travailleurs[1] (Van der Linden, 1999, p.112).
Dans le cadre de la présente étude, la mobilité professionnelle est abordée sous l’angle des déplacements des travailleurs dans le cadre de migrations de travail et les professions étatiques, privées et informelles qui exigent une mobilité géographique permanente des acteurs. La mobilité des travailleurs est donc appréhendée comme les déplacements, les mouvements à l’échelle nationale et internationale pour des raisons liées aux exigences de certaines professions.
L’étude s’appuie sur une documentation variée collectée dans plusieurs structures engagées dans la réponse à l’épidémie du sida. Ces documents sont composés de projets et rapports d’études de plusieurs organisations internationales, de données statistiques tirées des enquêtes de terrain réalisées par des organisations étatiques et non-étatiques nationales et internationales. Ils renseignent sur la dynamique de la répartition géographique de l’épidémie en Côte d’Ivoire, les risques liés à certains métiers à forte mobilité et les programmes de lutte déployés en faveurs de ces groupes spécifiques. A ces pièces, s’ajoutent les travaux des chercheurs intéressés par la question de la mobilité professionnelle en tant de sida. Les études de cas abordées renseignent sur l’environnement à risque favorisé par des professions. Cependant, pour certaines périodes et pour d’autres groupes socio-professionnels mobiles, la documentation est muette pour des raisons liées aux difficultés à les appréhender dans le cadre d’une étude, dans les premières années de l’épidémie, pour le peu d’intérêt qui leur a été accordé dans l’explication de la dynamique de l’épidémie et en raison de l’évolution de l’épidémie qui s’est introduite dans la population générale, rendant désuets les projets de recherches sur les groupes spécifiques ; projets considérés comme stigmatisant. Toutefois, l’analyse de la documentation permet de structurer l’étude autour de quatre catégories de mobilité professionnelles phares, à savoir : les migrants de travail, les routiers internationaux, les commerçants itinérants et les groupes socio-professionnels nationaux à forte mobilité.
[1] Selon B. Van der Linder, Le niveau de réallocation des travailleurs à un moment donné se définit comme étant le nombre de personnes (d'une zone géographique donnée) qui, entre deux périodes différentes, soit changent d'employeur soit transitent de l'emploi vers le non- emploi ou bien le contraire. Quant au roulement des travailleurs, il correspond au nombre d’entrées et de départs de main d'œuvre au cours d'une période donnée sur un territoire donné. Par le vocable entrée, il faut entendre l’embauche d’un travailleur. La notion de départ englobe tous les motifs de cessation d’une relation contractuelle entre un employeur et un travailleur.
Résultats
2. Résultats et Discussion
2.1. L’immigration en Côte d’Ivoire à l’émergence du sida : un ferment d’expansion de l’épidémie
« La Côte-d’Ivoire constitue le premier pays d’immigration d’Afrique de l’Ouest » (R. Blion et S. Bredeloup, 1997, p. 707). Cette situation s’explique par plusieurs facteurs, notamment son histoire coloniale, ses performances économiques au lendemain de son l’indépendance (J. Baulin, 1982), et les crises économiques, politiques et militaires dans nombre de pays de la sous-région auxquels ont adjoint le durcissement de leurs politiques migratoires.
En effet, après la déclaration de la colonie de Côte d’Ivoire par la France, en 1893, l’administration coloniale inaugure l’ère de l’exploitation de ce territoire par la mise en marche de grands chantiers de travaux, notamment le port, les routes, les voies ferrées, les bâtiments administratifs, les logements, les commerces, etc. C’est également à cette période que sont créées de vastes plantations de caféiers et de cacaoyers dans les régions du sud du pays. Face à l’incapacité des populations du sud de fournir le personnel suffisant à l’élaboration de ces travaux, le colonisateur se tourne dans un premier temps vers les populations des autres régions du pays, puis vers celles de la Haute-Volta en usant de moyens juridiques.
« En 1933, le Sud de la Haute- Volta, le pays Mossi, est rattaché à la Côte-d'Ivoire. Une telle mesure a pour objectif de détourner la migration voltaïque du Ghana et d'assurer le ravitaillement de l'économie ivoirienne en main-d'œuvre. A partir de 1940, la France en guerre a grand besoin de produits tropicaux : elle assigne à la Côte-d'Ivoire son ravitaillement en café et en cacao et intensifie la migration forcée vers le Sud. […] La migration en direction du Sud ivoirien est donc un phénomène essentiellement colonial. L'ordre colonial a délibérément créé un processus de migration forcée pour pourvoir en main-d'œuvre les régions forestières, avec pour objectif principal de faire coïncider concentration de population et activité économique. Une telle stratégie a eu pour résultat l'installation d'importantes communautés étrangères en Côte-d'Ivoire. En 1950 par exemple, la population étrangère installée en Côte-d'Ivoire était de 100 000 habitants, soit moins de 5 % d'une population totale estimée à 2 775 000 habitants. En 1958, elle est passée à 520 000 habitants, soit près du quart des 3 865 000 habitants de la Côte-d'Ivoire » (K. Brou, Y. Charbit, 1994, p. 36).
Cet héritage colonial a été entretenu par l’Etat post colonial dont l’économie reposait sur la performance de l’agriculture dans laquelle les étrangers jouaient un rôle important. En effet, entre 1960 et 1980, la Côte d’Ivoire connait une croissance économique exceptionnelle (S. Amin, 1967), due aux recettes tirées du binôme café-cacao dont les prix, élevés à l’époque, bénéficiaient au pays au point où on a pu parler de « miracle économique ivoirien » (P. Kipré, 2005, p. 221). Les fruits de cette croissance ont boosté la construction de nombreuses infrastructures qui ont élevé le pays au rang de vitrine de l’Afrique de l’ouest. Les reluisants scores de son économie favorisent « un phénomène d’urbanisation jamais égalée dans sous-région ouest-africaine » (G. Tapé et S. Dédy, 1991, p. 128). Le taux de croissance de la ville d’Abidjan estimé à 11% par an, était l’un des plus élevé au monde dans la décennie 1980 de même que le taux national de 3,6 % par an était parmi les plus élevés en Afrique (F. Deniaud, 1992).
Attrayante par la réputation d’havre de paix qu’elle s’est construite dans une sous-région en proie aux tribulations politiques et militaires d’une part, et, d’autre part, par le modèle de réussite économique qu’elle constituait pendant la période du « miracle économique », la Côte d’Ivoire se retrouve en point de mire de nombreuses migrations de travail animées par des ressortissants de la sous-région ouest africaine. « On comptait 17 % d’étrangers en 1965, 22 % en 1975 et 28 % en 1988 » (R. Blion et S. Bredeloup, 1997, p. 707). Selon le Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 1998 (RGPH 1998), le pays comptait « 16,4 millions d’habitants au total, quatre millions d’étrangers contre trois millions en 1988, dont 56% de Burkinabés, 19,8% de Maliens, 5,7% de Guinéens, 3,3% de Ghanéens. », (J-M., Amat-Roze, 2003, p. 135).
Ces mouvements migratoires ont été amplifiés par le climat socio-politique et la situation économique des pays de la sous-région. En effet, au moment où la Côte d’Ivoire connait une prospérité économique, nombre de pays de l’Afrique de l’ouest sont pris dans un tourbillon des crises économiques. La stagnation des économies sénégalaise et burkinabé, la dégradation de la situation ghanéenne, contrastent avec le boom économique ivoirien. En outre, le durcissement des politiques migratoires dans des pays comme le Ghana et le Nigeria par ailleurs secoués par des conflits militaro-politiques et l’obstacle de la langue, ont découragé les candidats à l’émigration vers ces pays. Enfin, les troubles politiques et les guerres civiles dans les pays proches tels que le Mali, la Guinée, le Libéria, la Sierra Léone, ont favorisé un déplacement massif des populations vers la Côte d’Ivoire, considérée comme un asile de paix.
Plaque tournante de l’immigration en Afrique de l’ouest, la Côte d’Ivoire connait l’une des plus fortes mobilités des travailleurs migrants en Afrique. Cette situation s’est muée en talon d’Achille à l’émergence de l’épidémie du sida. En clair, l’immigration liée au travail a, pour le moins que l’on puisse affirmer, contribué à la propagation du VIH en Côte d’Ivoire. Terre de convergences de nombreuses populations de la sous-région et de l’Afrique, la Côte d’Ivoire est l’un des pays où le lien entre les mouvements migratoires circulaires et les risques de propagation du VIH s’est révélé être bien réel dans les débuts de l’épidémie. En effet, si la migration de travail, surtout masculine est associée à un haut risque d’infection par le VIH, c’est en raison de l’adoption de nouveaux comportements sexuels par le migrant ou la continuation de ses pratiques anciennes, notamment les rapports sexuels occasionnels et le recours aux travailleuses de sexe. Mais la situation n’est pas homogène en zone rurale et urbaine. En milieu rural, certains migrants s’y installent avec leurs familles qui participent aux travaux agricoles. La présence de leurs proches attenue les difficultés d’insertion dans cet espace allogène. D’autres migrants sont des célibataires qui arrivent par des réseaux. De façon générale, le lien qui explique leur présence dans un village donné peut remonter à la colonisation. Ainsi, le nouveau migrant qui arrive pour la première fois en Côte d’Ivoire, ne vient pas par hasard. Il suit un parcours qui s’insère dans un réseau rôdé en place de longue date. À son arrivée, il est hébergé et pris en charge temporairement par un parent ou membre de sa communauté d’origine. Dans ces conditions, «...le stress si souvent évoqué, résultant d’un environnement nouveau et de l’isolement du migrant, est sans doute faible (…) et son influence sur l’adoption de comportement sexuels à risque diminuée » (R. Lalou, V. Piché, 1994, p. 38). En outre, l’absence de l’anonymat en milieu rural réduit considérablement les pratiques de multi partenariat sexuel.
Par contre, en zone urbaine, qu’ils soient célibataires ou mariés dans leur pays d’origine, nombre de migrants arrivent et vivent seuls durant une période relativement longue avant, de retourner épouser une femme au pays ou de faire venir leurs épouses. Or, l’environnement nouveau et contraignant auquel ils s’adaptent difficilement tant sur le plan socio-culturel, économique que psychologique auquel s’ajoute l’état de célibataire réel ou de fait, la séparation avec les autres membres de la famille et les amis, les confinent dans une posture d’isolement social, affectif et sexuel. La combinaison de tous ces facteurs favorise la multiplication de rapports sexuels occasionnels et le recours aux travailleuses de sexe. L’anonymat que leur garanti le statut d’étranger et le style de vie en ville facilitent l’adoption de tels comportements. C’est pourquoi M. Gelher (2000, p.116) soutient que :
« Le virus emprunte d’autres vecteurs, d’autres voyageurs, « partenaires des femmes libres» : travailleurs saisonniers de l’agriculture, bûcherons, puisatiers, pauvres du Mali et du Niger qui se font porte-faix autour des gares routières ou ferroviaires de Bouaké. Un brassage permanent, une population de transfrontaliers où se côtoient des hommes issus de cette partie ventrale du continent, qui se mélangent à des femmes, amateurs ou professionnelles.»
De façon générale, les migrants sous-régionaux masculins, venus seuls, n’ont nullement l’intention de se marier en Côte d’Ivoire. Cette situation peut expliquer leur recours aux services des travailleuses de sexe. Or, les migrants sont un groupe peu perméable aux campagnes de sensibilisation, assimilant implicitement le sida à un problème posé aux populations d’accueil. Ce défaut de réceptivité des campagnes de sensibilisation révèle l’un des biais des stratégies de prévention. En effet, le matériel pédagogique, la langue et la culture qui structurent les campagnes de sensibilisation ont été très souvent, du moins dans les débuts de l’épidémie, étrangères à celles des migrants qui se sentent très peu concernés. Cette situation est attestée par une enquête sur les connaissances, attitudes et comportements des Abidjanais sur le VIH conduite par S. Yelibi et al., (1993). Les chercheurs, soutiennent à partir de cette enquête que les migrants connaissent mal ou ignorent les modes de transmission du VIH du fait de l’analphabétisme ; 18% des hommes et 38 % des femmes ne comprenant pas la langue française dans laquelle les messages de sensibilisation étaient exclusivement diffusés.
Cependant, le comportement sexuel qu’ils adoptent n’est pas exclusivement façonné en zone d’accueil. « Les migrants qui ont eu des rapports sexuels avec des partenaires multiples et/ou des prostituées en Côte d’Ivoire ont plus souvent des relations occasionnelles en milieu d’origine que les autres migrants.» (R. Lalou, V. Piché, 1996, p. 456). C’est dire que le comportement sexuel se met en place tout au long de la vie et en fonction de l’évolution de l’environnement.
Par ailleurs, le risque de contraction du VIH par le migrant a été éclairé par une étude diligentée en Côte d’Ivoire, en 1992. L’enquête sérologique et par questionnaire socio- démographique réalisée par M. Diallo et al. (1992), à Abidjan auprès de 1169 hommes atteints de MST, a montré une association significative entre une immigration et le risque d’infection au VIH. Les auteurs ont observé que les immigrants, qui représentent 17% de l’échantillon, ont 2 fois plus de risque d'être atteints par le VIH, que les non-migrants, après contrôle des contacts avec les prostituées et des épisodes de MST. Cette tendance des migrants à fréquenter les travailleuses de sexe résulte d’une logique migratoire qui, en favorisant la séparation des ménages et la concentration des migrants sur les lieux de travail, amplifie la vulnérabilité de leur environnement. Ces relations avec les travailleuses de sexe favorisent la diffusion du virus non seulement dans le pays d’accueil mais aussi dans le pays d’origine. Au total, les migrations ont, malgré les nombreux bénéfices qu’elles procurent, constitué le point de vulnérabilité du travailleur migrant à des routiers et à des commerçants itinérants.
2.2. Sur les sentiers du risque : camionneurs et commerçants à l’épreuve du sida
La situation des routiers rend bien compte des liens entre la mobilité et la diffusion du sida en Côte d’Ivoire. En effet, la route a très rapidement été identifiée comme l’un des circuits les plus ouverts à la diffusion de l’épidémie parce que, selon R. Lalou, V. Piché, (1994, p. 24), « ses principaux usagers, les camionneurs internationaux, ont très rapidement été identifiés comme d’importants diffuseurs de la maladie ». Le cas ivoirien est révélateur de cette situation reconnue dans de nombreux autres pays d’Afrique subsaharienne. La position géographique de la Côte d’Ivoire et l’embonpoint de son économie qui en ont fait la plaque tournante de l’Afrique de l’Ouest, sont à l’origine du développement de l’activité des routiers.
« La Côte d’Ivoire (…) est un vaste couloir emprunté par le grand axe international de l’Afrique de l’Ouest. Plus rapidement qu’en Afrique centrale et Orientale, le sida y est devenu en quelques années un problème de santé publique majeur. (…). Abidjan, la capitale économique, est en relation privilégiée avec tous les États francophones de l’Afrique subsaharienne. Elle est devenue la plaque tournante du VIH pour toute l’Afrique de l’Ouest… ». (G. Tapé et S. Dédy, 1991, p. 13)
Carrefour de l’Afrique de l’Ouest, la Côte d’Ivoire abrite l’un des ports les plus performants d’Afrique. Sa plate-forme portuaire enregistre au quotidien, des départs et des arrivées de colonnes entières de camions qui ravitaillent l’arrière-pays et des pays frontaliers comme le Mali et le Burkina Faso. Les camions en direction du Burkina Faso partent d’Abidjan à Ouagadougou, empruntant la voie nationale sud-nord qui traverse les villes de Yamoussoukro, Bouaké, Ferkéssédougou, Ouangolodougou, Pogo (en Côte d’Ivoire), puis Bobo-dioulasso, Banfora et Ouagadougou (au Burkina Faso). D’autres camions suivent l’axe Abidjan, Bouaké, Korhogo, Tingréla pour rejoindre les deux grandes villes du Mali, Sikasso et Bamako. La voie de l’est enregistre également des départs d’Abidjan à Noé[1], pour atteindre Elubo, Takoradi et Accra au Ghana.
La fluidité du trafic est assurée par l’existence de grands axes internationaux qui convergent avec une grande aisance des pays frontaliers suscités vers la Côte d’Ivoire, leur lieu de ralliement. Ce sont donc des centaines de camionneurs qui se retrouvent chaque jour sur ces routes où ils passent plusieurs nuits. Certaines villes doivent leur animation à cette activité qui garantit la survie des commerces érigées en bordure de ces grands axes. D’autres villes ont été érigées en haltes de repos par les routiers. C’est le cas de Bouaké, ville carrefour située au centre du pays. A mi-parcours entre Abidjan et les pays frontaliers du septentrion ivoirien, cette ville est stratégique pour les routiers qui en ont fait une de leur base préférées. M. Gehler (2000, p.115-116) décrit avec clarté le rôle que joue cette ville dans le vécu des routiers internationaux en mettant en relief le risque de propagation du VIH :
« Que serait Bouaké sans les routiers ? Chaque jour, une colline entière se couvre de remorques en provenance de tous les coins d’Afrique de l’Ouest, cinq cent par jours, environ, pour une population de près d’un million habitants. Un passage quasi-obligé. Un gigantesque dépôt de carburant alimente les camions et se fait alimenter par eux. Le Tchad par exemple, reçoit des dons de pétrole du Koweït. Mais le Koweït préfère stocker en Côte d’Ivoire pour des raisons de sécurité : d’où les navettes. Le café, le cacao, les matières premières transitent par Bouaké, centre géographique. La colline et une bonne partie de la ville vit de ces activités. Il faut loger les routiers, les nourrir, les habiller, les coiffer, les raser, les soigner, entretenir les camions. Des femmes, de nombreuses femmes tirent leurs revenus de ces voyageurs particuliers. Ils apprécient le soir venu, qu’on leur ait préparé un dîner et un lit. Ils ont leurs habitudes. Une partenaire, un toit, un repas, une couche à chaque étape. Ils paient bien sûr, et s’attachent souvent la même femme pour une longue période. Ils acquittent le loyer et les frais annexes. Souvent, cela s’avère insuffisant. Alors elles ont deux, trois ou plusieurs routiers et d’autres clients. Et avec tous ces vecteurs, qui passent d’un pays à un autre, d’une femme à une autre, puis à nouveau, d’un homme à l’autre, le virus voyage et se propage. C’est sa route de l’Ouest. De l’atlantique vers l’intérieur et inversement. ».
A l’image de Bouaké, de nombreuses autres villes qui jalonnent le parcours de ces routiers ont constitué des carrefours à risque d’explosion épidémique. Comme l’expliquent R. Lalou, V. Piché, (1994, p. 24) :
« En matière de sida, l’argument est généralement le suivant. Les villes routières, qui jalonnent les grands axes de circulation, ne sont pas seulement des haltes de repos pour les routiers, mais représentent aussi un haut-lieu du commerce et de la prostitution. Les filles de bar, le personnel hôtelier, les commerçantes itinérantes et les prostituées de rue sont alors autant de personnes qui, par profession ou à l’occasion, vendent des services sexuels. Or en recourant régulièrement à cette forme de commerce, les camionneurs deviennent, à leur retour, tout naturellement diffuseur potentiels du VIH et autres MST ».
L’ancrage de ces pratiques a capté l’attention des acteurs de la lutte qui ont développé des programmes de sensibilisation ciblant les routiers. En effet, à partir de 1996, l’Agence Ivoirienne de Marketing Social (AIMAS), inclut le marketing des préservatifs de marque « Prudence » dans ses activités de sensibilisation sur le sida. Sa stratégie s’est traduite par la réalisation de spots de sensibilisation, de téléfilms, d’activités de communication de proximité visant à inciter les populations à utiliser ces préservatifs. C’est dans cette optique que dans la seconde série du téléfilm « Sida dans la cité » qu’elle a réalisée, l’AIMAS a consacré des séquences aux camionneurs, notamment les risques liés aux rapports sexuels occasionnels non-protégés au cours de leurs nombreux périples. L’évaluation de l’impact de ce téléfilm sur le comportement sexuel des personnes l’ayant suivi a révélé que :
« L’utilisation du préservatif lors du dernier rapport sexuel augmentait avec le nombre d’épisodes regardés. Les personnes ayant vu 10 épisodes et plus étaient significativement plus nombreuses à avoir utilisé le préservatif lors du dernier rapport sexuel que celles qui ont vu moins d’épisodes. L’on a également constaté que les personnes qui ont été exposées à ce feuilleton avaient une meilleure connaissance sur le sida et une attitude plus favorable face à cette pandémie. »[2]
Outre ce téléfilm, une campagne de sensibilisation intitulée « Roulez protégés », a été développée en direction des routiers. Elle se déclinait par des accroches barrées de ce slogan, présentant des routiers à bord de leurs camions et munis d’un paquet de préservatif de marque « Prudence ». Ces images jalonnaient les grands axes du pays empruntés par les conducteurs de camions.
Ce slogan est à l’initiative de l’ONG internationale Population Service International qui, à partir de 1997, a commencé à développer des actions sur les axes Abidjan-Ouangolodougou et Abidjan-Aboisso, en vue d’inciter les routiers, les personnes impliquées dans le transport et tous ceux qui fréquentent les gares, à prendre moins de risques afin de freiner la diffusion transfrontalière du VIH. Cette initiative implémentée au niveau régional a été mise en œuvre en Côte d’Ivoire, au Burkina-Faso et au Togo. Baptisée « Prévention du Sida sur les Axes Migratoires de l’Afrique de l’Ouest » (PSAMAO), elle ciblait quatre groupes spécifiques : les chauffeurs routiers, les professionnelles du sexe, les travailleurs saisonniers et les passagers des cars de transport. La stratégie d’approche de ces groupes cibles se faisait par des actions de sensibilisation conduites par des pairs éducateurs formés sur la base d’un document guide et l’utilisation des accroches, des mass-médias, des animations de masse et la distribution ou la promotion des préservatifs Prudence.
« Des cassettes ont été régulièrement produites et distribuées aux passagers sur les gars routières situées sur les lignes internationales. La distribution du condom se fait dans les lieux stratégiques tels que les gars et les stations d’essence. Des gadgets étaient distribués pour encourager les pairs éducateurs lors des jeux concours. Des soirées spéciales ont été organisées dans les bars »[3].
Toutes ces activités de sensibilisation en direction des routiers confirment l’important rôle joué par la route dans la dissémination du virus en Côte d’Ivoire. C’est en raison de ce même risque inhérent à la mobilité professionnelle que le cas des commerçants itinérants et internationaux est analysé.
Les commerçants itinérants sont des marchands qui écument villes, villages et hameaux en proposant divers articles aux populations. Ces articles sont composés de pagnes, d’ustensiles de cuisine, de produits cosmétiques, de vêtements, de jouets pour enfants, de tenues de sport, de mets en conserve, etc. Cette stratégie commerciale qui consiste à trouver leurs fidèles clients et de potentiels nouveaux acquéreurs sur leurs lieux de travail ou à leur domicile, les contraint à passer plusieurs nuits dans diverses localités. Ce cycle interminable qui garantit la survie de leur commerce crée des conditions favorables à entretenir des rapports sexuels occasionnels et/ou réguliers avec des clients des localités arpentées. En effet, le désir de fidéliser un généreux client ou le manque de moyens financiers pour s’offrir les articles proposés, débouchent sur des relations intimes multiples. C’est ainsi qu’il se raconta, par exemple, que des vendeurs de pagnes, les « Marka », comme les appellent en Côte d’Ivoire, se servaient des pagnes pour appâter des femmes avec les lesquelles ils entretenaient des rapports sexuels en catimini. Ces rapports occasionnels ont contribué à propager le VIH dans les zones reculées (villages et hameaux) dont l’éloignement des zones urbaines semblait constituer un rideau naturel de prévention. En se positionnant en relai entre les zones rurales et les zones urbaines, le commerce itinérant, nonobstant ses nombreux services rendus aux populations, a fragilisé la frontière qui freinait la circulation de l’épidémie entre ces deux zones. Certes, des études spécifiques n’ont pas été diligentées sur ce groupe difficile à cerner, surtout à une époque où les enquêtes sérologiques sur ces catégories socio-professionnelles n’étaient pas systématiques, mais on peut postuler que dans un contexte de cette maladie contagieuse, le risque de contamination lié à cette activité est bien réel.
Il en est de même pour les commerçants dont l’itinérance est de niveau international. Régulièrement éloignés de leurs familles, ces hommes et ces femmes, pour des raisons multiples dont certaines relatives aux avantages qu’elles pourraient en tirer ou pour du tourisme sexuel, entretiennent des rapports sexuels occasionnels avec des personnes rencontrées au cours de leurs nombreux voyages d’affaire. Ainsi, d’un pays à un autre, le VIH traverse les frontières dans les deux sens, rallongeant sa chaine de contamination. C’est pourquoi, à l’image des routiers, le commerce itinérant interne et le commerce international ont exposé leurs animateurs au risque de contraction et de diffusion du VIH par la forte mobilité qui les caractérisent. Par ailleurs, même si leur mobilité est temporaire, les hommes d’affaires et les travailleurs dont les sempiternelles missions les disposent à une mobilité internationale permanente, peuvent être logés à la même enseigne.
Cependant, le risque lié à la mobilité géographique n’est pas spécifique aux groupes susmentionnés encore moins au déplacement internationaux. Les migrations rurales internes et celles des groupes socioprofessionnels ont également rajouté au risque de propagation de l’épidémie à l’échelle nationale.
2.3. Les groupes socio-professionnels à forte mobilité en contexte de sida
Le phénomène des migrations et leurs relations avec le VIH/sida impliquent certes les migrations internationales dont le flux est important en Côte d’Ivoire mais aussi les migrations internes dont celles des ruraux et des groupes socioprofessionnels. En effet, de nombreux sites de travail et de nombreux complexes agro-industriels en zones rurales ou semi-urbaines exigent une main-d’œuvre permanente ou saisonnière. Le site du complexe ne pouvant, à lui seul, absorber le besoin en main-d’œuvre et toutes les compétences requises pour son fonctionnement, il est régulièrement fait appel à des ressources humaines des autres régions du pays. Ainsi, la concentration d’hommes célibataires de fait ou réels sur ces sites de travail favorise le développement de réseaux de prostitution animés par des travailleuses de sexe « locales », c’est-à-dire des femmes des localités qui environnent ces sites mais aussi, des travailleuses de sexe itinérantes en provenance de différents centres urbains du pays, qui viennent régulièrement passer du temps avec ces travailleurs. Cette situation est à l’origine de l’émergence des foyers de l’épidémie dans les zones qui abritent ces complexes. Une enquête sérologique diligentée dans les complexes agro-industriels a révélé que la séroprévalence y avoisine 17%[4]. A titre d’exemple, « les migrants ruraux reçoivent une visite mensuelle de prostituées qui séjournent pendant quelques jours sur les sites de plantations agro-industrielles de Bettié, SOGB et Zuénoula... »[5]
A l’instar des sites susmentionnés, bien d’autres sont écumées par des travailleuses de sexe qui y vont proposer leurs services. C’est le cas du Service des Mines d’Ity (SMI) de Zouhan-Hounien, le complexe sucrier de Borotou-Koro à Touba, les sites de PALMCI[6] dans la région d’Aboisso, de Tabou, les sites de la SAPH[7] disséminés sur le territoire ivoirien, les sites de construction de barrages hydroélectriques tels Taabo et Ayamé, etc.
A ces sites qui concentrent des travailleurs de divers horizons en contact régulier avec des travailleuses de sexe, il faut ajouter les travaux ponctuels qui entrainent un déplacement de travailleurs sur un site particulier. C’est le cas de la construction de routes, de ponts, etc. Toutes ces activités favorisent les rapports sexuels occasionnels pendant lesquels l’utilisation du préservatif n’est pas systématique. J. Tchéro (2014, p. 120) rapporte les propos d’un chef de village enquêté en 1985 dans le cadre de sa thèse unique de doctorat. Ce témoignage qui situe les faits au début du sida en Côte d’Ivoire donne un aperçu des liens entre la mobilité professionnelle ponctuelle et la propagation de la maladie.
« Les étrangers - gbo gbə ðã- qui ont bitumé la route Abidjan-Gagnoa avaient, à cette époque, entretenu des rapports avec toutes les filles des villages situés le long de cette voie. Quand ils se sont retirés à la fin des travaux, parmi les autochtones qui ont pris le relais, ç’a été l’hécatombe, victimes d’une maladie bizarre, qui n'était ni lakahi - blennorragie - ni bagu - syphilis -, mais quelque chose qui y ressemblait ; tous ceux qui l'ont contracté en sont morts. Nous l'avions appelé fatigué - kpəkpəle. Voilà de quelle manière certaines maladies sont arrivées chez nous. »
C’est justement cette situation à risque qui a conduit les promoteurs du téléfilm « sida dans la cité », à axer le scénario de la seconde série sur l’insécurité épidémiologique qui a gagné les espaces ruraux du fait des mouvements migratoires entre zones urbaines et zones rurales en contexte de sida. Dans cette seconde série, un charismatique et respecté chef du village s’est retrouvé infecté par le VIH. Le réalisateur montre comment une chaine de contamination peut être créée entre la ville et le village. Le scénario raconte l’histoire d’une idylle entre la cadette des épouses de ce chef et certain Cérapo, un ressortissant du village en fonction à Abidjan. C’est lui qui infecta son amante qui transmettra le virus à son époux, le chef de village. Ce dernier, à son tour, infecta toutes ses épouses. Ce scénario faisait d’une pierre deux coups, en sensibilisant sur les risques liés à la polygynie en temps de sida et la porosité du verrou des zones rurales. Exposées à l’épidémie du VIH qui peut même infecter la plus haute personnalité du village et le garant de la tradition, ce feuilleton a souligné que le sida ne devrait pas être perçu comme une maladie de la ville.
Outre les travailleurs des sites agro-industriels et des grands travaux publics, des groupes socioprofessionnels qui parcourent le territoire national aux fins de servir l’État ou d’accomplir des missions de travail sont concernés par le risque de contraction lié à leur mobilité. Les études réalisées sur certaines professions ont révélé l’ampleur du problème. En effet, parce qu’ils font partir des catégories symboles de la mobilité des groupes socio-professionnels, et par leurs activités qui leurs donnent un privilège en zone d’exercice, les enseignants, les forces de défense et de sécurité, les personnels de santé…, ont été les plus en vue. Une enquête d’envergure nationale ciblant les enseignants a été réalisée entre 1996 et 1998, par le projet Impact du VIH-sida sur le système éducatif de la Côte d’Ivoire[8]. Selon cette étude :
« 641 enseignants vivaient avec le VIH dont 81% d’instituteurs 15,9% de professeurs du secondaire et 3,1% d’éducateurs. Au cours de l’année scolaire 1996-1997, sur 218 décès d’instituteurs dont la cause est connue, 140, soit 64,22 % sont dus au VIH/sida ; ainsi 5 instituteurs décèdent du VIH/sida par semaine scolaire. Pour l’année scolaire 1997-1998, 59 décès sur les 85 dont la cause est connue, soit 69,41% sont dus au VIH/sida. Quant aux enseignants du secondaire, au cours de l’année scolaire 1996-1997, 19 décès sur les 44 dont les causes sont connues, soit 43,18% sont dus au VIH/sida.[9]
Les conclusions de l’étude ont révélé que le VIH/sida est la première cause de mortalité chez les instituteurs en Côte d’Ivoire, à cette époque et une cause importante dans l’ensemble de la corporation des enseignants. De plus, les conséquences liées à la mort, à l’absence sur le lieu de travail pour cause de VIH/sida sont désastreuses pour le système éducatif ivoirien. En effet, la période d’absence des instituteurs sur leur lieu de travail pour cause du sida est de 6,2 mois en moyenne, contre 10 jours pour une maladie autre que le sida[10].
Quant aux agents des forces de défense et de sécurité, selon le Bureau National d’Etude Technique et de Développement (BNETD), l’équivalent d’une compagnie est perdu chaque année pour cause de sida[11]. C’est dire l’impact du sida sur ce corps remarquablement mobile à l’échelle nationale. Tous ces indicateurs attestent du rôle joué par la mobilité des groupes socio-professionnels dans la propagation et la géographie de l’épidémie en Côte d’Ivoire.
[1] Elle est la dernière ville ivoirienne à la frontière du Ghana
[2] Centre Africain de Recherche et d’Intervention en Développement (CARID), Johns Hopking Bloomberg School of Public Health / Center for Communication Programs, Communication pour le changement de comportement dans le domaine du VIH/sida en Côte d’Ivoire : Analyse des stratégies et de la réponse de 1985 à 2004, Rapport final, p. 47
[3] Id.
[4] Ministère d’État, Ministère du Plan et du Développement, Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP), République de Côte d’Ivoire, p. 58
[5] UNICEF, Bureau de Côte d’Ivoire, Rapport national sur les disparités : analyse socio-économique des inégalités dans l’atteinte du bien-être des enfants et des femmes, Abidjan, 2002, p. 22
[6] Palmiers de Côte d’Ivoire (PALMCI) est une société spécialisée dans la création des plantations des palmiers et la production de l’huile de palme.
[7] Sociétés Africaine de Production d’Hévéa
[8]Ce projet a été financé par l’ONUSIDA, la Banque Mondiale, l’UNESCO et des organismes partenaires.
[9] Bulletin du Projet Impact, Cf. UNICEF, Bureau de Côte d’Ivoire, Op. Cit., p. 22
[10] Ibid. p. 25
[11] Id.
Conclusion
Cette étude a montré que la mobilité permanente qui caractérise certaines professions a constitué un important vecteur de dissémination du sida en Côte d’Ivoire. Les épidémies n’évoluant qu’au rythme des déplacements humains, la mobilité reste un facteur déterminant de leur dynamique. C’est en ce sens que l’étude du cas ivoirien, remarquablement pertinent, permet de cerner, d’élucider les risques liés à la mobilité professionnelle. Terre de convergence des migrants de l’Afrique de l’ouest et poumon économique de l’espace UEMOA[12] du fait de son économie florissante au lendemain des indépendances, la Côte d’Ivoire a toujours été le théâtre d’un ballet permanent de travailleurs migrants, de routiers internationaux qui desservent la sous-région à partir de son port, de commerçants itinérants et internationaux, auxquels on peut adjoindre des groupes socio-professionnels nationaux (travailleurs des complexes agro-industriels, enseignants, agents des forces de sécurité, personnel médical, etc.), en constant mouvement dans le cadre de leurs services. Ces professions inhérentes à la vie moderne favorisent souvent des conditions de vulnérabilité des acteurs dans un contexte marqué par le déclenchement d’une épidémie qui se transmet majoritairement par voie sexuelle en Afrique subsaharienne. L’étude a donc montré comment ces professions ont indépendamment d’elles créé un terreau favorable à une diffusion du VIH à l’échelle nationale.
Cependant, cette étude non exhaustive sur les risques liés à la mobilité professionnelle en contexte de sida en Côte d’Ivoire ne prétend borner et réduire les mouvements nécessités par le travail aux seuls cas abordés. Elle ne vise pas non plus à indexer ses animateurs comme les bouc-émissaires de la répartition géographique de la maladie en Côte d’Ivoire, encore moins les ériger en « groupes à haut risque » selon l’expression de l’époque devenue désuète. S’appuyant sur des cas de forte mobilité professionnelle, l’étude a tenté de montrer que :
« Tous ces mouvements de populations présentent une caractéristique commune : ils favorisent des rapports sexuels occasionnels, souvent non protégés, et font ainsi du migrant et du voyageur à la fois l’hôte et le vecteur potentiels du VIH. » (R. Lalou, V. Piché, 1994, p. 12).
Vu sous cet angle, cette recherche peut être complétée par une autre sur la mobilité professionnelle temporaire et sporadique, liée aux événements sportifs ou culturels comme le tour cycliste, le championnat national de football, les spectacles et concerts d’artistes musiciens à travers le pays etc., qui favorisent des rapports sexuels occasionnels.
[12] Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
Références
Références bibliographiques
AMAT-ROZE Jeanne-Marie, 2003, « L’infection à VIH/sida en Afrique subsaharienne, propos géographiques », Hérodote, N° 111, p. 117-155.
AMIN Samir, 1967, Le développement du capitalisme en Côte d’Ivoire, Paris, Editions de Minuit, 338 p.
BAULIN Jacques, 1982, La politique intérieure d’Houphouët-Boigny, Paris, Editions Eurafor-Press, 255 p.
BLION Reynald, BREDELOUP Sylvie, 1997, « La Côte-d’Ivoire dans les stratégies migratoires des Burkinabè et des Sénégalais », in : CONTAMIN Bernard, MEMEL-FOTÊ Harris (Ed.), Le modèle ivoirien en questions : crises, ajustements, recompositions, Paris, Karthala-Orstom, p. 707-737.
BROU Kouadio, CHARBIT Yves, 1994, « La politique migratoire de la Côte d’Ivoire », Revue européenne des migrations internationales, vol. 10, n°3, p. 33-59
CARAËL Michel, 2006, « face à la mondialisation du sida : vingt ans d’interventions et de controverses », in : DENIS Philippe, BECKER Charles, (Dir.), L’épidémie du sida en Afrique subsaharienne. Regards historiens, pp.43- 61.
Centre Africain de Recherche et d’Intervention en Développement (CARID), John Hopkins Bloomberg School of Public Health/Center for communication programs, 2005, Communication pour le changement de comportement dans le domaine du VIH/SIDA en Côte d’Ivoire : analyse des stratégies et de la réponse de 1985 à 2004, rapport final, 166 p.
DENIAUD François, 1992, Jeunesse urbaine et préservatifs en Côte d’Ivoire : connaissance, perception, pratiques, besoins et attentes, mémoire de DEA en sciences sociales, Université René Descartes, Paris V, 70 p.
DIALLO Mamadou, ACKAH Alain, LAFONTAINE Marie-France, DOORLY Ronan, ROUXT Robert, KANGA Jean-Marie, HEROIN Pierre, DE COCK Kevin, 1992, "HIV-1 and HIV-2 infections in mes attending sexually transmitted disease clinics in Abidjan, Côte d’Ivoire", AIDS, n°6, pp. 581-585.
GELHER Monique, 2000, Un continent se meurt. La tragédie du sida en Afrique, Paris, Stock, 250 p.
GRMEK Mirko, 1995, Histoire du sida. Début et origine d’une pandémie actuelle, Paris, Payot, (3e Ed.), 492 p.
JACKSON Hélène, 2004, Le sida en Afrique. Continent en crise, Harare, SAFAIDS, 528 p.
KIPRE Pierre, 2005, Côte d’Ivoire. La formation d’un peuple, Paris, Sides-Ima, 292 p.
LAINE Frédéric, 2010, « La mobilité professionnelle : facteurs structurels et spécificités de l’Île-de-France », ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 431–432, p. 37-56.
LALOU Richard, PICHE Victor, 1994, Migrations et sida en Afrique de l’ouest. Un état des connaissances, Les dossiers du CEPED N° 28, Paris, 53 p.
LALOU Richard, PICHE Victor, 1994, 1996, « Sida et migrants internationaux : cadre analytique de réflexion et premiers résultats à partir d’un exemple ivoirien », colloque international Sciences sociales et sida en Afrique. Bilan et perspectives, communications - volume 1, 4-8 novembre 1996, Sali Portudal, Sénégal, pp.445 - 461.
Ministère d’État, Ministère du Plan et du Développement, 2009, Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP), République de Côte d’Ivoire, 180 p.
OUDIN Xavier, 1985, Les activités non structurées et l’emploi en Côte d’Ivoire. Définition et mesure, thèse de IIIe cycle, Centre de développement, faculté des Sciences Économiques, université de Rennes 1,174 p.
SENDRAIL Marcel, 1980, Histoire culturelle de la maladie, Paris, Privat, 445 p.
TAPE Gozé Tapé, DEDY Séri, 1991, Comportements sexuels et sida en Côte d’Ivoire, CNLS, 220 p.
TCHERO Joachim, 2014, Santé et développement en Afrique subsaharienne. La maladie : approche historique d’Hier à Aujourd’hui, Paris, L’Harmattan, 248 p.
UNICEF, Bureau de Côte d’Ivoire, 2002, Rapport national sur les disparités : analyse socio-économique des inégalités dans l’atteinte du bien-être des enfants et des femmes, Abidjan, 48 p.
VAN DER LINDEN Bruno, 1999, « Rotation des emplois et mobilité des travailleurs en Belgique », Cahiers Economiques de Bruxelles, 2ème trimestre, n°162, pp. 107-148.
ZRAN Toily Anicet, 2014, L’histoire du VIH/sida en Afrique subsaharienne : le cas de la Côte d’Ivoire de 1985 à aujourd’hui, Thèse unique de doctorat d’histoire, Université Félix Houphouët-Boigny, 674 p.
Downloads
Publié
30/12/2021
Comment citer
Revue Espace, Territoires, Sociétés et Santé ,[En ligne], 2021,, mis en ligne le 30/12/2021. Consulté le . URL: https://retssa-ci.com/index.php?page=detail&k=233
Numéro
Rubrique
Qui sommes-nous ?
Licence
Copyright (c) 2023 ZRAN Toily Anicet