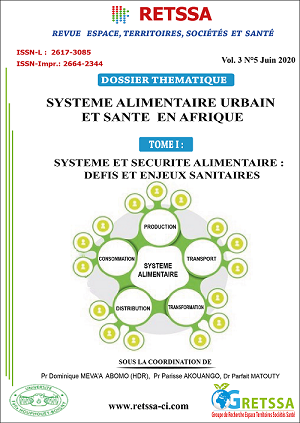8 |Éditorial Tome 2 : RISQUES SANITAIRES LIÉES AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET AUX ACTIVITÉS HUMAINES
Editorial Tome 2 : HEALTH RISKS RELATED TO CLIMATE CHANGE AND HUMAN ACTIVITIES
Mots-clés:
Résumé
« MUTATIONS ENVIRONNEMENTALES ET RISQUES SANITAIRES EN AFRIQUE »
Introduction
L’Afrique fait face ces dernières années à des mutations sans précédent sur le plan climatique, écologique, social et dans les cadres de vie (J.P. Deléage, 2018; L. Favreau, 2014). Ces différentes mutations sont dues aux actions anthropiques. En effet, l’incapacité de l’homme par ses systèmes à gérer de manière efficiente les déchets ménagers, les détritus et les effluents émis par ses activités en milieu urbain tout comme dans le monde rural, met à mal la qualité de l’environnement ; ce qui occasionne la diffusion des maladies qui y trouvent des conditions favorables (B. Ménard, 2011). Ces aspects sont abordés dans les contributions regroupées dans ce Tome 2 intitulé « risques sanitaires liées aux changements climatiques et aux activités humaines ». Il renferme 14 articles.
Les auteurs y abordent successivement l’impact de la variation des paramètres du climat sur la prévalence du paludisme dans la ville de Bangui, l’influence du contexte d’habitation sur la distribution spatio-temporelle des cas de méningite dans la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso, les risques sanitaires des mutations environnementales en Algérie d'un territoire vierge à un territoire violé radioactivement, quelques stratégies d'adaptation aux changements climatiques pour un développement durable au Sénégal, la pratiques de quelques activités économiques (l’orpaillage, la production du charbon de bois, du savon ‘‘kabakrou’’) et les risques sanitaires ainsi que l’impact des eaux usées des activités industrielles sur la santé des populations riveraines.
Ce Tome 2 contient également la rubrique « VARIA » qui développe divers sujets d’actualités portant sur la production et commercialisation du soja au centre du Bénin, deux réflexions sur la pandémie de la COVID-19, les facteurs de la vulnérabilité alimentaire des refugiés centrafricains au Tchad et stratégies d’adaptations ; de la vulnérabilité à la résilience : l’entrepreneuriat féminin, un socle pour l’économie sociale et solidaire au Sénégal ; les conditions de travail, vulnérabilité professionnelle et performance des enseignants dans les établissements secondaires publics au Cameroun.
1ère partie : Changements climatiques et risques sanitaires
« Le changement climatique est un enjeu majeur pour lequel la population mondiale doit se responsabiliser » (C. Bérubé, 2010, p.2). Les effets des changements climatiques ont pour conséquences de profonds bouleversements socio-économiques et environnementaux. Ces bouleversements concernent les précipitations caractérisées par des séquences d’inondation, de sècheresse prolongée, de fortes températures et une fréquence élevée des vents violents. Les populations sont vulnérables aux conséquences des effets des changements climatiques. Mais les risques liés au changement climatique, sont très mal perçus par les populations locales, les décideurs ou même les techniciens (Hellequin, 2013) cité par B. Anouk (2016, p.11).
C’est ainsi que cet axe rassemble les contributions qui mettent en exergue la variable humaine, responsable des perturbations climatiques et la vulnérabilité des populations. « En une analyse des représentations et des perceptions des individus du changement climatique et des risques qui lui sont associés doit permettre de renforcer la capacité d’adaptation des territoires et des sociétés face à ce phénomène » (B. Anouk, 2016, P.3).
De manière spécifique, les cinq contributeurs abordent l’impact de la variation des paramètres du climat sur la prévalence du paludisme dans la ville de Bangui (République centrafricaine), influence du contexte d’habitation sur la distribution spatio-temporelle des cas de méningite dans la région de la boucle du Mouhoun, Burkina Faso ; les risques sanitaires des mutations environnementales en Algérie d'un territoire vierge à un territoire violé radioactivement ; stratégies d'adaptation aux changements climatiques pour un développement durable : étude du cas de l’entrepreneuriat des femmes dans le village de Mouiit, Sénégal ; de la vulnérabilité à la résilience : l’entrepreneuriat féminin, un socle pour l’économie sociale et solidaire dans le delta du Saloum au Sénégal.
La contribution de BOMBA Jean Claude, KEMBE Marcel et ZAGUY GUEREMBO Raoul Ludovic tente d’établir la concordance entre les variations mensuelles des paramètres climatiques et la prévalence du paludisme à Bangui, ville située à l’orée de la zone équatoriale. Les résultats obtenus ne montrent pas clairement la concordance entre la prévalence du paludisme et les paramètres climatiques, du fait de la complexité des liens entre ces paramètres et le paludisme. Le climat n’est pas un intervenant unique dans la prolifération du paludisme à Bangui. De ce fait, la différenciation temporelle de la prévalence du paludisme liée au climat représente encore un défi pour le Centrafrique. Il est donc essentiel d’orienter de nouvelles études sur les facteurs de prévalence du paludisme.
L’étude de BADOLO Alain, TRAORÉ Issouf, MALO Sadouanouan et OUÉDRAOGO François de Charles vise à proposer une description et l’analyse de facteurs de risque environnementaux et climatiques liés à la distribution spatio-temporelle des cas de méningite dans la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso. L’estimation de l’association entre les variations géographiques de l’incidence de méningite et celles de variables d’exposition, fait appel aux modèles de régression écologique. Les cas de méningite sont quasi nuls pour des taux d’humidité supérieurs à 70%. On observe une distribution saisonnière des cas, avec une augmentation de 17.07% du nombre de cas de la saison sèche et froide à la saison sèche et chaude, une baisse de 51.23% en saison humide et chaude. La structuration spatiale des variables environnementales montre une distribution hétérogène, avec des agrégations d’entités spatiales dans des zones ayant des caractéristiques environnementales similaires et des cas spatialement atypiques. Les coefficients de régression 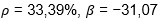 ,07 estimés pour la variable explicative « humidité » et un impact total de −17,828 pour les températures, révèlent une dépendance spatiale dans la distribution des incidences et un impact significatif des températures et de l’humidité sur l’hétérogénéité des incidences de méningite.
,07 estimés pour la variable explicative « humidité » et un impact total de −17,828 pour les températures, révèlent une dépendance spatiale dans la distribution des incidences et un impact significatif des températures et de l’humidité sur l’hétérogénéité des incidences de méningite.
NAILI Manel, TELAIDJIA Djamel, EDDAOUDI Fatima et BOUCHAMA Leila quant à eux mettent l’accent sur l'impact de la radioactivité sur l'environnement et la santé en raison des essais nucléaires en Algérie. Les rayonnements agressifs affectent les populations locales souffrant de différents cancers, maladies oculaires, malformations génétiques et autres maladies très rares. Les radiations mortelles portées par le sable, l'eau et l'air toxique touchent directement ou indirectement l'environnement et la population locale.
Face aux risques sanitaires liés aux changements climatiques, la contribution de SARR Serigne Momar abordent quelques stratégies d’adaptation pour un développement durable. Il examine la contribution de l’entrepreneuriat féminin, en contexte de changement climatique, dans l’édification d’une économie sociale et solidaire qui participe à atteindre un certain degré de résilience, malgré la permanence des vulnérabilités biophysiques et socioéconomiques dans le delta du Saloum. Il souligne que la crise écologique, qui sévit depuis plusieurs décennies, offre un cadre de réflexion innovant pour faire évoluer la recherche sur l’entrepreneuriat féminin, déjà enserré dans les contraintes sociales et les défis économiques. Entre la ruralité et l’insularité, la péjoration climatique au Sahel gêne le quotidien des populations et des États. Mais au sein des communautés telles que les Niominkas dans ce delta, les femmes jugulent la précarité de leurs ménages à travers une Fédération locale des Groupements d’intérêt économique (FELOGIE), appuyée par des acteurs institutionnels. Toutefois, le contexte d’incertitude et d’imprévisibilité rappelle les femmes sans cesse à l’ouvrage ; d’où l’intérêt des innovations sociales pour entretenir les activités de production et embellir le mode organisationnel et le partenariat. Du coup, la résilience devient une quête permanente et une affaire de temporalités dans les ensembles systémiques.
2ème partie : Activités humaines et risques sanitaires
En milieu rural comme urbain, les mutations environnementales, par les problèmes qu’elles provoquent, ne sont pas sans conséquences sur la population. En effet, au cours des derniers siècles, l’Homme a contribué aux processus de changement de l’environnement naturel qui risquent d’altérer de manière significative son cadre de vie en espace de quelques générations à cause des effets des activités humaines qui sont évidents et irréversibles (A.P. Paolo, 1990).
De plus, le développement accentué des activités minières en zone rurale en Afrique, induisent des mutations environnementales qui remettent en question les perspectives de développement à long terme des localités à cause de nombreux problèmes socio-économiques et sanitaires qu’elles engendrent (F. B. HUE Bi et al., 2020 ; E. Voundi et al., 2019). Ces pays africains sont confrontés à de nombreuses transformations liées à la déforestation due aux activités et aménagements anthropiques (activités agricoles, orpaillage artisanal clandestin ou industriel, construction des équipements, infrastructures etc.). Ces mutations engendrent souvent de nombreux problèmes environnementaux qui exposent les populations à des risques sanitaires de plus en plus accrus.
Sous cet axe, sont abordées spécifiquement les risques sanitaires liés à quelques activités économiques telle que l’orpaillage, la production du charbon de bois et du savon ‘‘kabakrou’’ respectivement au Burkina Faso, au Gabon et en Côte d’Ivoire ainsi que l’évaluation de la pollution de l’eau liée aux activités industrielles et leurs impacts sur la santé des populations à Abidjan.
Au Burkina Faso, SOMA Assonsi, COMPAORE Nadège épouse BAMBARA et YAMEOGO Lassane abordent l’épineux problème de l’activité d’orpaillage et son impact sur les ressources naturelles et la population. Ils révèlent que l'exploitation artisanale de l’or, en pleine expansion dans le sous bassin versant du fleuve Mouhoun au Burkina Faso est très dangereuse car elle, se caractérise par l’utilisation de méthodes et d’outils archaïques. À tous les niveaux, les effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine sont perceptibles. Nombreux sont les facteurs associés, qui, de manière plus ou moins insidieuse ou expresse, participent à la dégradation quasi irréversible de l’environnement et à l’exposition des populations à des risques de santé dus à la pollution des sols, des eaux et de l’air. Malgré les effets néfastes perceptibles et perçus par les différents acteurs, les activités d'orpaillage continuent à se développer, car elles constituent une source de revenus pour une bonne partie de la population.
La production de charbon de bois et la fabrication du savon ‘‘ Kabakrou’’ entrainent aussi des risques environnementaux et sanitaires selon MABIKA Jérôme ; GOGOUA Gbamain Éric, COULIBALY Moussa et SORO Seydou.
En effet, la production de charbon activités de base génératrices de revenus pour les populations, elle est aussi l’émanation de multiples problèmes. C’est ce problème qu’aborde MABIKA Jérôme à travers sa contribution intitulée « la production de charbon de bois à Essassa en périphérie est de Libreville (Gabon) : entre génération des revenus et risques environnementaux et sanitaires ».
Il tente d’évaluer les retombées socio-économiques et les risques environnementaux et sanitaires liés à la production de charbon de bois sur le site d’Essassa en périphérie Est de Libreville au Gabon. Les résultats montrent que la production de charbon de bois à Essassa est une activité génératrice de revenus qui engendre en même temps des problèmes environnementaux et sanitaires importants tels que les émissions de gaz à effet de serre, les accidents de travail et les maladies professionnelles.
Gogoua Éric et al., quant à eux ont montré que la fabrication du savon artisanal « kabakrou », dans la ville de Korhogo en Côte d’Ivoire, soulève un problème suscité par des conditions changeantes de la vie moderne et des espoirs nouveaux y correspondants. Il analyse la dynamique sociale et économique de la femme productrice du savon « kabakrou » et les risques que génère cette activité sur l’environnement urbain de la ville de Korhogo. Il en ressort que cette activité artisanale est génératrice de revenu propulsant considérablement la place de la femme dans la société mais contribue à la pollution du sol, des eaux et de l’air par ses déchets et rejets de toutes natures. L’utilisation d’intrants dangereux comme la soude caustique et les conditions inappropriées de travail exposent ces acteurs à des risques sanitaires.
Les activités économiques, précisément industrielles, génèrent des eaux polluées qui mal traitées influencent négativement la santé des populations riveraines. C’est ce sujet qu’aborde la contribution de YAO-ASSAHI Akoissi Ida Natacha, GNAGNE Agness Essoh Jean Eudes Yves, ANOH Kouassi Paul et YAPO Ossey Bernard intitulée « évaluation de la pollution de l’eau liée aux activités industrielles et impact sur la santé des populations à Abidjan sud ».
Ils démontrent que les effluents liquides des industries continuent d’affecter la qualité des baies à Abidjan Sud ce qui a des impacts sur l’état de santé de la population. En effet, leurs travaux font ressort que les effluents liquides des industries présentent certains paramètres physiques et chimiques avec souvent des valeurs plus élevées que les valeurs guides. Ces effluents sont déversés dans les baies lagunaires d’Abidjan à travers les points de rejet sans traitement préalable ; ce qui un impact sur la santé des populations riveraines.
En définitive, l’ensemble des réflexions proposées dans ce Tome 2 met en relief les difficultés de perception des risques sanitaires liés aux changements climatiques et la nécessité de concilier la pratique des activités économiques au développement durable.
Par ailleurs, les contributions de ce deuxième Tome font montre d’une insuffisance de couverture de thématiques relevant des sciences naturelles et médicales. Or, la prise en considération des exigences de la pluridisciplinarité et des complexités permet de mieux apprécier les risques sanitaires liés aux changements climatiques et aux activités humaines. Une bonne perception de ces risques sanitaires et même environnementaux, par les populations locales, les spécialistes et les décideurs, permettra d’adopter des stratégies appropriées pour le développement humain durable en Afrique.
Méthodologie
N/A
Résultats
N/A
Conclusion
N/A
Références
ANOUK Bonnemains, 2016, Perceptions et représentations du changement climatique auprès des populations dans leur cadre de vie. [Rapport de recherche] LabEx ITEM. 2016. hal-01420366v2, HAL Id: hal-01420366 http://hal.univ-grenoble-alpes.fr/hal-01420366v2, 16 p.
BÉRUBÉ Christine, 2010, Changements climatiques et distorsion de la perception des québécois : de la communication à l'action, Essai présenté au Centre Universitaire de Formation en Environnement en vue de l’obtention du grade de maître en environnement (M.Env.), Centre Universitaire de Formation en Environnement, Université de Sherbrooke, 81 p.
DELÉAGE Jean-Paul, 2018, « Faire face aux mutations géopolitiques et climatiques », Écologie & politique, N° 56, pp. 5-16. DOI : 10.3917/ecopo1.056.0005. URL : https://www.cairn.info/revue-ecologie-et-politique-2018-1-page-5.htm
FAVREAU Louis, 2014, « Alternatives citoyennes dans un monde en mutation : les nouvelles dynamiques internationales », Éthique publique [En ligne], vol. 16, n° 2, mis en ligne le 12 mai 2015, consulté le 26 janvier 2021. URL : http://journals.openedition.org/ethiquepublique/1496 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.1496
HUE Bi Broba Fulgence, KAMBIRE Bébé, ALLA Della André. 2020. Mutations environnementales liées à l’orpaillage à Ity (Ouest de la Côte d’Ivoire), Annales de l’Université de Moundou, Série A : Annales de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines, Vol. 7(2), Tchad, pp. 133-151
MÉNARD Boris, 2011, Thaïlande: résurgences infectieuses et transition épidémiologique. Médecine tropicale, 71(5), pp. 421-427.
Paolo Antonio Pirazzoli, 1990, Les changements de l'environnement à l'échelle du globe et les géographes, Annales de géographie N°553, 99è année, pp. 257-272.
Voundi Eric, Fendoung Philippes Mbevo, Emossi Patrick Essigue, 2019, « Analyse des mutations socio-environnementales induites par l’exploitation minière à Bétaré-Oya, Est-Cameroun », Vertigo, Vol. 19, URI https://id.erudit.org/iderudit/1065409arCopiedAn error has occurred
Downloads
Publié
Comment citer
Revue Espace, Territoires, Sociétés et Santé ,[En ligne], 2021,, mis en ligne le . Consulté le . URL: https://retssa-ci.com/index.php?page=detail&k=208
Numéro
Rubrique
Editorial
Licence
Copyright (c) 2023 KAMBIRE Bébé et YASSI Gilbert Assi