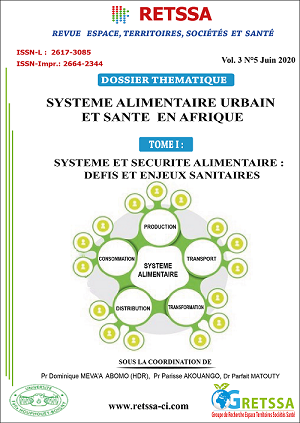0 |Éditorial Tome 1 : MUTATIONS DES CADRES DE VIE ET RISQUES SANITAIRES
Éditorial Tome 1 : CHANGES IN LIFE FRAMEWORKS AND HEALTH RISKS
Mots-clés:
Résumé
« MUTATIONS ENVIRONNEMENTALES ET RISQUES SANITAIRES EN AFRIQUE »
Introduction
Comme la plupart des continents, l’Afrique fait face ces dernières années à des mutations sans précédent dans les conditions et les cadres de vie (vie (J.P. Deléage, 2018; L. Favreau, 2014). Ces mutations de plus en plus complexes avec l’instabilité politique dans les pays et son corollaire de déplacés et réfugiés des populations, les modes de production agricole, les pandémies, etc., sont dues aux actions anthropiques. En effet, l’incapacité de l’homme par ses systèmes à gérer de manière efficiente les déchets ménagers, les détritus et les effluents émis par ses activités en milieu urbain tout comme dans le monde rural, met à mal la qualité de l’environnement ; ce qui occasionne la diffusion des maladies qui y trouvent des conditions favorables (B. Ménard, 2011). Un cadre de vie malsain, en raison des conditions favorables qu’il présente pour la diffusion des maladies infectieuses, est considéré comme vecteur de pathologies. Cette idée est soutenue par D. Soulancé et al. (2011) qui affirment que les lieux de vie (quartiers, jardins, maisons) ont un impact non négligeable sur la santé des populations. Pour ces auteurs, les lieux de vie ne sont pas sans influence sur la santé des populations, autant par les relations qu’entretiennent les individus avec ces lieux que par l’organisation propre de ces espaces. Ainsi, le cadre de vie des populations exerce une influence sur la diffusion des maladies. Les principales maladies influencées par un environnement malsain sont la diarrhée, les Infections des voies Respiratoires Aiguës (IRA), les différentes formes de lésions involontaires ou maladies de la peau (dermatose), la fièvre typhoïde et le paludisme (A. Prüss-Üstün et al., 2008 ; l’OMS ; 1994).
Plusieurs études révèlent que les facteurs environnementaux jouent un rôle important dans la prolifération des pathologies environnementales. Malgré ces publications, les liens entre l’environnement et la santé, particulièrement en milieu urbain en Afrique subsaharienne, demeurent faiblement documentés. Quelques travaux ont permis de contribuer à l’avancement des connaissances, mais de nombreux aspects de l’environnement restent à approfondir (F. D. BOUBA, 2019, p.192).
Vu sous cet angle, un état des lieux sur ces mutations environnementales et les risques sanitaires à l’échelle locale, régionale, nationale et interétatique s’avère nécessaire. Il permettra de proposer une résilience appropriée dans une approche globale et transversale de travaux de sociologues, anthropologues, géographes, démographes, économistes, philosophes, etc., si l’on veut tendre vers un développement humain durable dans les territoires et sociétés en Afrique.
Dans ce sens, ce dossier thématique de la Revue Espace, Territoires, Sociétés et Santé (RETSSA) se veut une réponse aux enjeux des mutations environnementales en lien avec les risques sanitaires ; autour d’une préoccupation principale : quels sont les enjeux des mutations environnementales sur la santé et le bien-être des populations au regard des réalités actuelles ? Quelles approches emprunter pour une efficacité d’adaptation face aux mutations environnementales et les risques sanitaires ? L’objectif de ce dossier est d’analyser les différentes mutations environnementales et les risques sanitaires dans les espaces, territoires et sociétés en Afrique.
L’ouvrage a enregistré 31 contributions venant de la Côte d’Ivoire (10), du Cameroun (2), du Bénin (5), du Sénégal (4), du Tchad (2), du Mali (1), du Gabon (2), de la République Centrafricaine (1), du Burkina Faso (2), de l’Algérie (1) et du Congo (1). Une diversité de domaines (santé, environnement, changements climatiques, ville, gouvernance, politique publiques, etc.) traitée dans deux tomes, structure ce dossier thématique. Le tome 1 comprend trois parties de 17 contributions et le tome 2 enregistre deux parties avec 14 articles, la rubrique varia comprise.
Le Tome 1 du dossier thématique a pour thème « mutation des cadres de vie et les risques sanitaires ». Il met en évidence les diverses mutations dans les cadre de vie et les risques sanitaires. Il aborde successivement les problèmes occasionnés par l’urbanisation (pression urbain, mutation spatiale des quartiers périphériques des villes et les habitats spontanés), l’insalubrité des cadres de vie, la qualité de l’eau et leurs liens respectifs avec les risques sanitaires auxquels sont exposées les populations. Ce Tome 1 est également une lucarne à travers laquelle une série de contributions au titre de la rubrique « VARIA » développe divers sujets d’actualités sur les pathologies liés aux modes de conservation de l’eau, la COVID-19, les structures des soins et l’accessibilité aux soins, la morbidité et recours aux soins, opinion des femmes face à la consultation prénatale, l’influence de la drépanocytose sur le développement moteur de l’enfant, et afin le théâtre-forum comme un moyen de sensibilisation dans la lutte contre la mortalité maternelle en Afrique.
1ère partie : Dynamique urbaine et risques sanitaires
Dans les villes africaines, la santé est mise à mal du fait du foncier et de l’urbanisation non maîtrisés. Ainsi, les populations sont soumises à plusieurs problèmes environnementaux notamment d’assainissement (gestion des eaux usées et des ordures ménagères) (F.D. BOUBA, 2019, p.193). Les trois contributions sur cet axe abordent la dynamique urbaine et les risques sanitaires auxquels sont exposées les populations.
La contribution de NSEGBE Antoine de Padoue analyse les pressions urbaines et état de santé de l’environnement à Makepe-Missoke, un ancien front d’urbanisation dans l’arrondissement de douala 5ème au Cameroun. Cette ville fait face à une forte croissance urbaine et un étalement important. À Makèpè-Missokè, ces processus ont favorisé l’occupation des bas-fonds marécageux et autres espaces résiduels dont l’usage est ambivalent, dépotoir pour les uns, lieux de résidence pour les autres. Prenant appui sur les ODD contenus dans l'Agenda 2030, son étude fait le point sur les processus et conditions de développement de ce quartier. Il dresse ensuite un état sanitaire de la zone, à partir d’un processus de bio-évaluation de la qualité de l’eau et de la biodiversité aquatique basé sur un protocole d’échantillonnage simplifié. Enfin, à partir de l’état de santé de l’environnement et de l’analyse des données sanitaires, il établit que les populations sont fortement exposées aux risques sanitaires. Quant à CHABI Moïse, il met l’accent sur les mutations spatiales et dynamiques urbaines des communes périphériques de Cotonou, précisément les cas d’Abomey-Calavi, Sèmè-Podji et Ouidah. Il démontre que ces territoires périphériques passent de la fonction résidentielle à un espace polyfonctionnel productif. L’effectif de la population a été multiplié par 10. Mais l’étalement urbain a fait perdre des hectares de ressources forestières et des espaces agricoles. À cela, s’ajoute l’exacerbation des maux comme le paludisme et la diarrhée.
La dynamique urbaine entraine aussi la construction d’habitations spontanées dans lesquelles les populations sont exposées aux risques sanitaires. C’est ce que l’étude de AHOHOUNDO Parfait Cossi Alexis; TOHOZIN Côovi Aimé Bernadin, HONVO Aser Zinsou Simon; KIKI Cyrille et DEKLE Amos tente de montrer à travers leur contribution intitulée « Habitations spontanées et risques sanitaires dans le premier arrondissement de la ville de Porto-Novo ». Ils analysent les dangers liés à la précarité du cadre de vie dans certains quartiers de la ville de Porto-Novo. Les résultats montrent que 73 % des habitations sont en matériaux précaires. La cohabitation des populations avec ce cadre de vie insalubre est responsable de fortes nuisances soit 95,13 % du secteur d’étude. Des affections courantes sont fréquemment déclarées par la population. 71,04 % de la population sont malades du paludisme, 22,13 % des affections gastro-intestinales et 6,83 % des dermatoses occasionnelles. Le recours à l’automédication traditionnelle est observé dans la zone à 57 %, aux soins cliniques 39 % et 4 % se tournent vers l’automédication moderne.
2ème partie : Assainissement du cadre de vie et risques sanitaires
La maîtrise de l’assainissement, au sens large et ses enjeux, est l’un des défis majeurs des villes en développement » (Y.H. B. Nguendo, 2008, p.4). Les quatre contributions sur cet axe abordent les problèmes liés à l’assainissement (eaux usées, les ordures ménagères) et les risques sanitaires auxquels sont exposées les populations.
Les facteurs de risque environnementaux sur la santé sont à prendre en compte dans les politiques de gestion urbaine car les maladies liées à la mauvaise qualité de l’environnement font de nombreuses victimes dans le monde depuis des décennies. Les travaux de HUE Bi Broba Fulgence, KAMBIRE Bébé et ALLA Della André analysent l’influence de l’insalubrité du cadre de vie dans la survenue du paludisme et de la fièvre typhoïde à Sinfra en Côte d’Ivoire. Les investigations menées auprès de 205 chefs de ménages montrent que le rejet d’ordures (69%) et l’évacuation d’eaux usées (60%) dans les rues, les caniveaux, sur les terrains nus, dans les ravins et rigoles par les ménages à Sinfra contribuent à l’insalubrité du cadre de vie, ce qui favorise le risque des maladies environnementales à l’échelle des différents quartiers. Les ménages vivant dans les quartiers insalubres sont plus exposés au risque du paludisme et de fièvre typhoïde (32%) que ceux habitant les quartiers salubres (1%).
La dégradation du cadre de vie urbain a donc un lien avec la prolifération de certaines pathologies. C’est dans ce même sens qu’abordent KAMBIRE Bébé, YASSI Gilbert Assi et LAMA Koffi Jacques par leur contribution intitulée « dégradation du cadre de vie et risques sanitaires à Bingerville (Côte d’Ivoire) ». Les principaux résultats obtenus révèlent une dégradation du cadre de vie de Bingerville qui se manifeste par la prolifération des ordures ménagères et de diverses eaux usées. Les quartiers qui ont un niveau d’insalubrité plus élevé sont ceux qui enregistrent les forts taux de maladies environnementales.
Le coefficient de détermination traduisant l’intensité de relation entre le niveau d’insalubrité des quartiers et le nombre de malades montre que 78,24% des maladies environnementales sont attribuées à l’insalubrité à Bingerville. Il existe donc un lien entre les maladies environnementales et la mauvaise qualité de l’environnement. La fièvre typhoïde fait partie de ces maladies environnementales auxquelles sont vulnérables les populations au Nord-ouest du Bénin selon l’étude de BATI KOUTOUMPO Barka Louis Philippe, GOMEZ COAMI Ansèque et SAMBIENI N’koué Emmanuel intitulé « Vulnérabilité à la fièvre typhoïde dans les communes de Tanguieta-Materi-Cobly au Nord-Ouest du Benin ». Leur étude analyse la vulnérabilité de la population à la fièvre typhoïde durant la période 2015-2019. La fièvre typhoïde est un problème majeur de santé publique dans les Communes de Tanguiéta-Materi-Cobly au nord-ouest du Bénin avec une prévalence qui dépasse celle des autres zones sanitaires du département. La relation est significative entre le niveau de vulnérabilité et le domaine d’activité avec près de 70% de personnes exerçant dans l’agriculture, le commerce et l’artisanat. Le niveau de vulnérabilité est lié à la commune de résidence des enquêtés et les plus vulnérables à la fièvre typhoïde sont fortement représentés dans les communes de Cobly et de Matéri contrairement à la commune de Tanguiéta. La vulnérabilité des individus à la fièvre typhoïde est indépendante du sexe et de l’âge des enquêtés.
Contrairement aux trois précédentes contributions qui mettent l’accent sur la dégradation du cadre de vie et les risques sanitaires, SANO Abdou Khadre et GAYE Ibrahima Diop montre successivement que l’assainissement du cadre de vie et l’engagement éco-citoyen des associations améliorent le bien-être des populations et leur cadre de vie. SANO Abdou Khadre à travers son article intitulé « Migration et transferts immatériels : quand la salubrité devient la carte postale du village de Lidoube (Matam, Sénégal) » montre comment des apports de la migration ont contribué à améliorer le cadre et les conditions de vie des populations du monde rural, en agissant sur les mentalités et en changeant les comportements. En effet, grâce à la construction des toilettes modernes équipées d’eau courante pour lutter contre la défécation à l’air libre et surtout à une politique de salubrité venue d’ailleurs, Lidoubé fait partie des villages les plus propres du Département.
Quant à GAYE Ibrahima Diop, il analyse l’engagement éco-citoyen des associations de Fatick au Sénégal dans deux espaces de pratiques durables. Les résultats obtenus montrent que les associations participent à l’amélioration du cadre de vie, à la conservation des ressources naturelles et à la sensibilisation des populations. Les résultats indiquent aussi que ni l’âge de l’association, ni son ancrage local encore moins sa vocation première n’agissent sur les pratiques durables proposées. Cependant, le niveau d’instruction du représentant principal de l’association, son intégration dans les réseaux de défense de l’environnement et ses capacités de négociation, sont des facteurs qui influencent significativement ces pratiques écologiques. Signe d’une pénétration sociale perfectible, les interventions des associations restent limitées par les carences du système de gouvernance territoriale.
3ème partie : Gestion de l’eau et risques sanitaires
L’accès à l’eau potable est un droit reconnu à tout individu. Mais dans les pays africains, son accès reste encore un luxe pour les populations. Le manque d’eau, l’altération de sa qualité et les divers modes d’approvisionnement de cette ressource est à l’origine des maladies hydriques. C’est ce que tente d’aborder les trois contributions inscrites sous cet axe.
Le manque d’eau est une problématique très complexe liant à la fois la santé et l’environnement. Les travaux de DOMBOR DJIKOLOUM Dingao, TIDJANI Assouni et ADIMATCHO Aloua, dans les quartiers spontanés et précaires de la ville d’Abeché, au Tchad, relèvent la vulnérabilité sanitaire des populations liée à l’accès à l’eau telles que le paludisme (42,5%), la dysenterie (17%), la diarrhée (16,1%), la conjonctivite (7,5 %) et la dermatose (12,3 %).
Outre le manque d’eau, l’altération de la qualité de l’eau souterraine, due à la défaillance du système d’assainissement à des risques sanitaires. C’est ce problème que traitent Zawdjatou TAHIROU, Henri S. TOTIN VODOUNON et Roufaï DJIBRIL B. à travers leur contribution intitulée « qualité des eaux de puits et risques sanitaires en milieu urbain àkandi- Benin ».
Ils analysent la qualité microbiologique et physico-chimique de l’eau des puits dans la ville de Kandi et les risques de maladies auxquels sont exposées les populations qui en font usage. L’étude révèle que les puits sont contaminés par Escherichia coli (70 à 46 000 UFC/100 mL), les coliformes totaux (10900 à 640000 UFC/100 mL) et les streptocoques fécaux (32 à 20100 UFC/100 mL). Les paramètres comme la température (100 %), les nitrates (70 %), la turbidité, le potassium (40 %) et le fer (10 %) présentent des valeurs non conformes aux normes de potabilité. Les eaux ont un faciès chloruré et sulfaté calcique et magnésien (40 %), hyper chloruré sodique (30 %), hyper chloruré calcique (20 %), chloruré sodique et potassique (10 %).
Pour la conservation de l’eau dans les ménages, les populations ont recours à plusieurs modes ; ce qui entraine des risques de maladies hydriques. L’étude de TRAORE Drissa « Modes d’approvisionnement en eau et risque de maladies hydriques dans le quartier Balouzon à Daloa (centre-ouest- Côte d’Ivoire) » met en évidence ces risques. Les résultats montrent que 90,51% des enquêtés stockent l’eau tandis que 09,49% des ménages n’en conservent pas. La durée de la conservation de l’eau avant son usage est à la base des pathologies les plus fréquentes à Balouzon que sont les maladies diarrhéiques (52,54%) et la fièvre typhoïdes (15,25%). Elles sont suivies par les cas de dermatoses (11,86%). La promotion du traitement et de la bonne conservation de l’eau à usage domestique et l’amélioration des infrastructures d’assainissement sont un moyen complémentaire pour réduire les maladies à transmission hydrique.
En conclusion, le Tome 1 du dossier thématique rassemble des réflexions analytiques des diverses mutations environnementales et les risques sanitaires. Elles couvrent les considérations empiriques centrées respectivement sur les mutations des cadres de vie, l’insalubrité du cadre de vie, la gestion de l’eau et les risques sanitaires de ces différents aspects. Le point fort à relever dans ce Tome 1 est que la grande majorité des dix-huit (18) contributions reçues dépeint la situation réelle des cadres de vie africains à l’échelle locale et régionales et les risques sanitaires auxquels sont exposées les populations. Ce qui pose le défi actuel à relever par les africains en matière d’assainissement (au sens général) et les risques sanitaires en Afrique surtout en milieu urbain. L’Afrique occidentale occupe une bonne place dans ces contributions avec respectivement 10 articles sur 11. De plus, en dehors de ces champs qui présentent la pluralité des facettes sur la mutation des cadres de vie et les risques sanitaires, ce Tome 1 a le mérite de présenter des contributions à titre de « varia » en guise d’ouverture sur des sujets abordant souvent un seul aspect de la thématique du présent numéro de RETSSA. Ces contributions appellent à poser un regard pragmatique sur les facteurs environnementaux, anthropiques et structurels à la base de la recrudescence des maladies tropicales.
Si le dossier présente des articles de qualité scientifique indiscutable, il manque d’explorer les aspects théoriques et méthodologie sur les mutations environnementales et risques sanitaires. Ce Tome 1 qui examine des contributions s’inscrivant dans le domaine des sciences sociales, environnementales et économiques aurait connu un regain d’intérêt exhaustif à analyser certains risques sanitaires liés aux cadres de vie urbain et rural des pays africains. Quoiqu’il en soit, les questions soulevées et traitées par ces différentes contributions posent le problème du rôle de l’État et de ses démembrements décentralisés en matière de risque/sécurité sanitaire des populations dans un monde de plus en plus en mutation. La prise en considération de l’ensemble de ces réflexions reste un gage pour le développement humain durable en Afrique.
Méthodologie
Résultats
Conclusion
Références
Références bibliographiques
BOUBA Djourdebbé Franklin, 2019, « Santé Environnementale dans les Villes en Afrique Subsaharienne: Problèmes Conceptuels et Méthodologiques », European Scientific Journal, Edition Vol.15, No9. https://eujournal.org/index.php/esj/article/view/11906/11335, pp. 192-213
DELÉAGE Jean-Paul, 2018, « Faire face aux mutations géopolitiques et climatiques », Écologie & politique, N° 56, pp. 5-16. DOI : 10.3917/ecopo1.056.0005. URL : https://www.cairn.info/revue-ecologie-et-politique-2018-1-page-5.htm
FAVREAU Louis, 2014, « Alternatives citoyennes dans un monde en mutation : les nouvelles dynamiques internationales », Éthique publique [En ligne], vol. 16, n° 2, mis en ligne le 12 mai 2015, consulté le 26 janvier 2021. URL : http://journals.openedition.org/ethiquepublique/1496 ; DOI :https://doi.org/10.4000/ethiquepublique.1496
MÉNARD Boris, 2011, Thaïlande: résurgences infectieuses et transition épidémiologique. Médecine tropicale, 71(5), pp. 421-427.
NGUENDO Yongsi H.B, SALEM Gérard, THOUEZ Jean-Pierre, 2008, « Risques sanitaires liés aux modes d'assainissement des excréta à Yaoundé, Cameroun », Natures Sciences Sociétés, Vol. 16, p. 3-12. URL : https://www.cairn.info/revue-natures-sciences-societes-2008-1-page-3.htm
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS), 1994, Crise de la santé en milieu urbain. Les stratégies de la santé pour tous face à une urbanisation galopante. Rapport des Discussions Techniques de la Quarante-quatrième Assemblée mondiale de la Santé, Genève, 93 p.
SOULANCÉ Dominique, GAIMARD Maryse, BLEY Daniel & VERNAZZA-LICHT Nicole. (2011). Lieux de vie et santé des populations : l’exemple du chikungunya à la Réunion. Cahiers de géographie du Québec, 55 (156), 603–621.
PRÜSS-ÜSTÜN Annette, CORVALÁN Carlos, 2006, Prévenir la maladie grâce à un environnement sain: une estimation de la charge de morbidité́ imputable à l'environnement: résumé́ analytique ; Rapport, OMS ; Genève
Downloads
Publié
Comment citer
Revue Espace, Territoires, Sociétés et Santé ,[En ligne], 2021,, mis en ligne le . Consulté le . URL: https://retssa-ci.com/index.php?page=detail&k=207
Numéro
Rubrique
Editorial
Licence
Copyright (c) 2023 KAMBIRE Bébé et YASSI Gilbert Assi