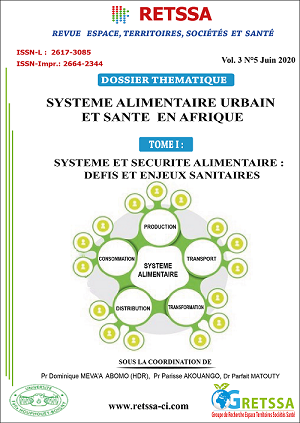6 |DEGRADATION DU CADRE DE VIE ET RISQUES SANITAIRES À BINGERVILLE (CÔTE D’IVOIRE)
DEGRADATION OF THE LIVING ENVIRONMENT AND HEALTH RISKS IN BINGERVILLE (CÔTE D’IVOIRE)
Mots-clés:
cadre de vie| dégradation| risques sanitaires| maladies environnementales| Bingerville|Résumé
Le phénomène de l’insalubrité est préoccupant dans la ville de Bingerville. Ce problème influence négativement la qualité de vie des populations et les expose aux maladies environnementales. Cette contribution a pour objet d’analyser les déterminants de la dégradation multiforme dans le cadre de vie des populations de Bingerville et son lien avec leur santé. Pour bien mener l’analyse, une démarche méthodologique a été adoptée. Elle repose sur la recherche documentaire, l’observation directe, des entretiens avec des autorités compétentes de la ville et une enquête par questionnaires auprès de 208 chefs de ménage. Les principaux résultats obtenus révèlent une dégradation du cadre de vie de Bingerville qui se manifeste par la prolifération des ordures ménagères et de diverses eaux usées. Le mode de gestion des eaux usées y reste individuel du fait de l’absence ou de la rareté d’infrastructures adéquates d’assainissement. Pour l’évacuation des déchets solides ménagers, 51,03% des chefs de ménages enquêtés ont recours à des dépotoirs anarchiques. Seulement 13,9% utilisent les dépôts autorisés. Les quartiers qui ont un niveau d’insalubrité plus élevé sont ceux qui enregistrent les forts taux de maladies environnementales. Ce sont les quartiers Gbagba 1ère extension, Gbagba, EECI, Cimetière Agriculture. Le coefficient de détermination traduisant l’intensité de relation entre le niveau d’insalubrité des quartiers et le nombre de malades montre que 78,24% des maladies environnementales, sont attribuées à l’insalubrité à Bingerville. Il existe donc un lien entre les maladies environnementales et la mauvaise qualité de l’environnement.
Introduction
Un cadre de vie malsain (mauvaises conditions de gestion des ordures et eaux usées), en raison des conditions favorables qu’il présente pour la diffusion des maladies infectieuses, est considéré comme vecteur de pathologies (A. J. McMichael, 2000, p.1120). Cette idée est soutenue par D. Soulancé et al. (2011, p.3) qui affirment que les lieux de vie (quartiers, jardins, maisons) ont un impact non négligeable sur la santé des populations.
Dans les villes africaines en général, la santé est mise à mal du fait de l’urbanisation non maîtrisée avec son corolaire de problèmes environnementaux (C. Walid, 2013, p.1). Ainsi, les populations sont soumises à l’insalubrité et aux problèmes d’assainissement ; ce qui détériore leur cadre de vie et influence négativement leur santé.
Les Nations Unies ont reconnu l'accès à l'assainissement et à un environnement de qualité comme un droit humain préalable à tous les droits humains à travers les décisions N° 64/292 du 29 juillet 2010. Pour y parvenir, les gouvernements ont convenu d'intégrer pleinement la protection de l'environnement et du cadre de vie dans le processus de développement de leurs États (D. A. Yao, 2017, p.9). Malgré ces nombreux engagements pris pour l'environnement et le cadre de vie, l'Organisation Mondialisation de la Santé (OMS) estimait en 2006 que 1,1 milliard de personnes dans le monde, soit 17 % de la population mondiale n'avait toujours pas accès à un assainissement adéquat.
Ces problèmes environnementaux, en milieu urbain africain, se posent surtout avec acuité à cause de la croissance rapide de la population, de l’urbanisation incontrôlée, de la faible conscience environnementale et du manque de rigueur dans la gestion de l’environnement.
Bingerville, une ville historique et Chef-lieu de ladite commune, située à l’est dans le District Autonome d’Abidjan, n’échappe pas à ce phénomène d’insalubrité du cadre de vie. Cette ville périphérique d’Abidjan compte 91 319 habitants (Institut National de la Statistique, 2014). Elle connaît une croissance démographique et spatiale rapide du fait de ses possibilités d’accueil et d’extension mais aussi à son histoire. En effet, Bingerville a été préférée à Grand-Bassam comme capitale de la Côte d’Ivoire entre 1900 et 1934 en raison de son site accidenté (G. A. Yassi et al., 2016, p.100). Plus tard, les migrations en direction de la ville de Bingerville ont été accentuées avec l’insécurité que la ville d’Abidjan a connue du fait de la crise postélectorale de 2011. De ce fait, plusieurs quartiers ont été créés ou ceux existant ont connu une extension. Cette situation provoque un nouveau défi de gestion de l’environnement urbain et des déchets ménagers en particulier (C. Q. K. Yao, 2010, p.5). Les infrastructures d’assainissements et de collectes des déchets sont presqu’inexistantes à Bingerville. En parcourant les différents quartiers de la ville, on constate la prolifération des dépôts d’ordures, des écoulements d’eaux usées dans les rues et à proximité des habitations, en provenance des fosses septiques et des puits perdus. Les eaux pluviales stagnent dans les rues dégradées et dans les rares caniveaux encombrés par le sable et les déchets solides.
Il s’ensuit que les déchets ménagers et les eaux usées domestiques constituent des gîtes larvaires de certaines pathologies et des sources de nuisances (K. Dongo et al. (2009 p.9). L’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales a toujours été placé en marge des priorités dans les programmes nationaux d’investissement. De même, la prolifération de l’habitat précaire, l’absence et l’inefficacité des systèmes d’assainissement des eaux usées et pluviales, les difficultés de collecte et d’élimination des déchets solides ainsi que les mauvaises pratiques environnementales des ménages influencent négativement le cadre de vie. La conséquence d’un tel phénomène est la prolifération des maladies environnementales (K. Dongo et al., 2009, p.9) et M. Coulibaly et al., 2018, p.18). Face à ces constats, un problème de dégradation de la santé de la population du fait d’un cadre de vie malsain se pose à Bingerville. La question principale à laquelle cette contribution tente de répondre est quelle est l’influence de l’insalubrité du cadre de vie sur la santé de la population à Bingerville ? L’objectif est de montrer le lien entre la dégradation du cadre de vie et la santé de la population de Bingerville à travers l’analyse des facteurs de dégradation de l’environnement et les risques sur la santé des populations.
Méthodologie
1. Méthodologie
1.1. Bingerville, le terrain d’enquête et d’analyse
Située au sud-est de la Côte d’Ivoire (Carte n°1), Bingerville se localise à 18 Kilomètres du centre-ville d’Abidjan (V. F.A. D. Loba, 2010, p.1) et fait partie du District Autonome d’Abidjan depuis 2001. La carte n°1 présente la localisation de l’espace urbain de Bingerville.
Carte n°1 : Localisation de la ville de Bingerville
Bingerville est d’abord une Sous-préfecture incluse depuis 2001 dans le District autonome d’Abidjan. Elle abrite des infrastructures scolaires, sanitaires et touristiques de renommée nationale et internationale à l’image de l’école des arts appliqués, du jardin botanique, du Centre des métiers de l’électricité qui est une école interafricaine, de l’École Militaire Préparatoire Technique (EMPT), de l’hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara etc. Enfin, deuxième capitale de la Côte d’Ivoire, la ville est limitée au nord-ouest par la Sous-préfecture de Brofodoumé, au nord-ouest et à l’ouest par la Sous-préfecture d’Alépé, au sud-est par la ville d’Abidjan, au sud-ouest par la Sous-préfecture de Grand-Bassam. La ville de Bingerville est un cadre idéal pour comprendre le lien entre un environnement dégradé et la santé de la population.
En effet, la population de Bingerville a évolué à un rythme lent pendant plusieurs décennies. En 1975, elle ne comptait que 18 000 habitants (INS, 1975). Elle est passée à 39 000 habitants en 1998 ; soit un accroissement moyen annuel de 2,96 % (INS, 1988). Estimée à 47 180 habitants en 2010, sa population culmine à 91 319 habitants sur une superficie de 10 200 ha selon le dernier recensement (INS, 2014). Cette croissance vertigineuse au cours de la décennie 2000 trouve plusieurs explications. D’abord, Abidjan avec une forte croissance démographique est confrontée à des problèmes de logement. De même, l’on assiste à un déplacement des populations vers Bingerville du fait de l’insécurité de la ville d’Abidjan consécutive à la crise postélectorale de 2011. L’autre raison de la double croissance démographique et spatiale de la ville de Bingerville « est la multiplication des opérations de lotissement par les propriétaires terriens qui contrôlent désormais le foncier urbain depuis le désengagement de l’État de ce secteur à partir de la crise économique de 1980. À cela s’ajoute l’action du privé à travers les Sociétés Civiles Immobilières (PROMOGIM, SICOGI, ALOBHE, SYNATRESOR, ORIBAT, EICER, etc.) qui ont initié des programmes de construction des cités FEHKESSE, SYNATRESOR, PALMA, LES HEVEAS, BNETD, DON MELO et FIGUIER (des habitats économiques de moyen et haut standing) » (G. A. Yassi et al, 2016, p. 102). Cependant, les équipements d’aménagements et d’assainissements n’accompagnent pas cette croissance démographique et spatiale. La non maîtrise de la dynamique urbaine et de l’accroissement démographique a favorisé le développement d’un paysage urbain très atypique, dominé de plus en plus par les quartiers précaires à habitat non planifié comme Gbagba, Gbagba extension, EECI, Cimetière et Agriculture.
1.2. Techniques de collecte des données
Dans le cadre de ce travail, deux démarches de recherche ont été utilisées pour la collecte des informations. Il s’agit de la recherche documentaire et des enquêtes de terrain. La recherche documentaire a porté sur les documents textuels, statistiques et cartographiques.
Les sources documentaires consultées font référence aux ouvrages et articles relatifs à la dégradation de l’environnement urbain, aux problèmes environnementaux, à la prolifération des maladies infectieuses et aux problèmes de santé en milieu urbain.
Les données statistiques ont été fournies par l’Institut National de la Statistique (INS), le service technique de la Mairie et les centres de santé du milieu urbain de Bingerville. Nous avons reçu de l’INS les données sociodémographiques issues des différents recensements de la population et de l’habitat de 1975 ; 1998 et 2014.
Le fond de carte à l’échelle 1/70000ème du Centre d’Information Géographique et Numérique (CIGN) du BNETD, en 2020, a été utile pour la spatialisation des phénomènes étudiés.
L’enquête de terrain s’est traduite par l’observation, les interviews et l’enquête par questionnaire auprès des chefs de ménages.
L’observation a permis de fixer la signature de la mauvaise gestion des déchets ménagers et de l’assainissement sur le cadre de vie du milieu urbain de Bingerville. Au moyen d’un guide d’entretien, les interviews réalisées avec le service technique de la Mairie de Bingerville a permis de recueillir des données sur le type et le nombre de quartiers, l’état de salubrité, le mode d’usage des équipements de gestion des déchets, la fréquence de collecte des ordures ménagères dans les quartiers ainsi que l’état des infrastructures routières de la ville. Les statistiques sanitaires sur la ville ont été fournies par les responsables des centres de santé qui y exercent. Ces données sont relatives aux différentes pathologies enregistrées en 2020.
Pour une couverture spatiale totale de la zone d’étude, l’enquête par questionnaire a été menée auprès d’un échantillon de 208 chefs de ménages choisis dans neuf quartiers représentatifs sur 34. En effet, ces quartiers sont choisis selon leur typologie (habitats précaires, économiques et résidentiels). Les quartiers sélectionnés sont répartis dans les différentes couronnes (Centrale, Intermédiaire et périphérique) de la ville. En ce qui concerne la taille de l’échantillon, le calcul a eu pour substrat la formule de Aragon et al, (2009), cité par Y. SYLLA, (2016, p. 76).
-
n = Taille de l’échantillon ;
-
t = Coefficient de marge (déterminé à partir du seuil de confiance)
-
N = taille de la population mère ;
-
e = Marge d’erreur ;
-
P = proportion de ménage supposés avoir les caractères recherchés. Cette proportion variante entre 0 et 1 est une probabilité d’occurrence d’un évènement. Lorsque l’on ne dispose d’aucune valeur de cette proportion, elle est fixée à 50% (0,5).
Pour cette étude, nous avons pris : p = 0,50 ; un niveau de confiance de 96% donc t = 2,05 et la marge d’erreur e = 0,1 soit 10%.
À un niveau de confiance de 96%, la taille minimale de ménages représentatifs est estimée à 104. Cependant, la réalité du processus d’enquête nous a amené à procéder à un réajustement de la taille de l’échantillon en vue de pallier d’éventuels refus ou défections des répondants au cours de notre enquête. Pour compenser la perte anticipée, il importe de multiplier la taille de l’échantillon par l’inverse des taux de réponses (GUMACHAN, MAROIS et FEVE cité par Y. SYLLA (2016, p. 76). Dans le cadre de cette étude, nous avons estimé le taux de réponse à 50%. Dès lors, la taille d’échantillon de ménage corrigé est : n* = (104) × (100/50) = 208. Ainsi, nous avons enquêtés 208 ménages. Le nombre de ménage enquêté dans chaque quartier a été déterminé par la règle de trois et est réparti dans le tableau n°2.
Tableau n°2 : Répartition des ménages enquêtés par quartier
Source : INS, 2014 et données obtenues après calcul
Le facteur discriminant pour le choix des chefs de ménages enquêté, dans chaque quartier, a été le critère de proximité des zones de stagnation des eaux usées de lessive, de vaisselle et de dépotoirs d’ordures ménagères. Cette enquête réalisée en octobre 2020 a permis d’avoir des données sur le mode de gestion des eaux usées de lessive, de vaisselle, de douche, des eaux vannes ainsi que des ordures ménagères.
1.3. Traitement des données
Les données collectées par la recherche documentaire et l’enquête de terrain ont été traitées manuellement. La saisie des données a été élaborée avec le logiciel sphinx 5 pour l’analyse des données quantitatives. Le volet cartographique a été fait à l’aide des logiciels Arc GIS et Adobe Illustrator. Le logiciel Excel a été utilisé pour des analyses statistiques descriptives qui nous ont permis de réaliser des tableaux qui contiennent les pourcentages des phénomènes étudiés issues d’un traitement statistique simple.
Une méthode a été utilisée d’une part, pour déterminer le niveau d’insalubrité à l’échelle des quartiers et d’autre part, pour montrer le lien entre la prolifération des maladies environnementales et le niveau d’insalubrité.
Méthode utilisée pour déterminer le niveau d’insalubrité à l’échelle des quartiers.
La méthode est inspirée du modèle de spatialisation du niveau de salubrité utilisé respectivement par M. COULIBALY (2016, p.144) et Y. SYLLA (2016, p.170). Le processus de classification adopté prend en compte pour chaque type d’objet géographique le nombre et la superficie. Outre les centres de groupage anarchiques, les décharges et le point de groupage retenu par la Mairie, les superficies des dépôts d’ordures et des rejets d’eaux usées de lessive, de vaisselle et vannes ont été mesurées. En fonction de chaque superficie, une cote allant de 5 à 14 pour les déchets solides et 4 à 14 pour les déchets liquides a été attribuée. Nous avons utilisé ensuite la formule d’évaluation du niveau de dégradation de l’environnement suivante: ISNDE = ISNI + ISNA.
Avec :
-
ISNDE : Indice de Spatialisation du Niveau de Dégradation de l’Environnement
-
ISNI : Indice de Spatialisation du Niveau d’Insalubrité
-
R : Profil des côtes attribuées à chaque dépôt sauvage
-
D : Nombre de dépôts sauvages, de points de collectes ou de décharge
-
ISNA : Indice de Spatialisation du Niveau de stagnation des eaux usées
-
R’ : Profil des côtes attribuées à chaque rejet d’eaux usées
-
r : Nombre de points d’eaux usées (eaux stagnantes)
Méthode utilisée pour montrer le lien entre la prolifération des maladies environnementales et le niveau d’insalubrité.
Pour analyser le lien entre le niveau d’insalubrité et les maladies environnementales, nous avons eu recours à la méthode de régression linéaire visant à établir la corrélation entre deux variables (dépendantes et indépendantes). Pour y parvenir, nous avons utilisé les données chiffrées des malades par quartier et les avons mis en rapport avec les indices de spatialisation du niveau d’insalubrité.
Ce modèle de régression linéaire permet de mesurer l’intensité de la liaison entre deux variables quantitatifs.
Cette intensité de liaison est analysée à l’aide du coefficient de corrélation de Bravais-Person. Le coefficient de corrélation Bravais-Pearson est un paramètre important dans l’analyse des régressions linéaires (simples ou multiples). Ce coefficient varie entre -1 et +1.
-
une valeur proche de +1 montre une forte liaison entre les deux caractères. La relation linéaire est ici croissante (c’est-à-dire que les variables varient dans le même sens) ;
-
une variable proche de -1 montre également une forte liaison mais la relation linéaire entre les deux caractères est décroissante (les variables varient dans le sens contraire) ;
-
une valeur proche de 0 montre une absence de relation linéaire entre les deux caractères.
Pour calculer le coefficient de corrélation r sur un échantillon, on détermine un risque d’erreur α. Dans le cadre de cette étude, nous avons envisagé un risque d’erreur α= 5%. L’intensité de relations entre les variables est mesurée à l’aide du coefficient de détermination (r²). Ce coefficient est le carré du coefficient de corrélation de Bravais-Pearson. Il traduit la qualité d’une régression en résumant la part de l’information totale prise en compte par le modèle de régression. L’intensité de relation entre deux variables est appréciée à partir de la valeur du coefficient de détermination (r²).
Lorsque le coefficient de détermination r² est :
-
supérieur à 75%, on a une corrélation de très forte intensité de relations ;
-
compris entre 60 et 75%, on a une corrélation de forte intensités ;
-
compris entre 45 et 60%, on a une corrélation de moyenne intensité de relations ;
-
compris entre 25 et 45%, on a une corrélation de faible intensité de relations,
-
compris entre 0 à 25%, on a une absence de corrélation ou une corrélation de très faible intensité de relations.
Résultats
2. Analyse des résultats
Les résultats du travail présenté portent sur les facteurs de dégradation du cadre de vie et les principales pathologies que l’on y rencontre.
2.1. Les facteurs de dégradation du cadre de vie de Bingerville
Plusieurs facteurs concourent à la dégradation de l’environnement urbain à Bingerville. Il s’agit de la mauvaise gestion des déchets solides et liquides, du manque d’infrastructures d’assainissement et d’aménagement, du laxisme des autorités communales faces aux difficultés environnementales et aux mauvaises pratiques des ménages en matière d’hygiène.
2.1.1. Une difficile gestion des eaux usées et vannes
Les résultats obtenus concernant les modes d’évacuation des eaux usées de lessive et de vaisselle sont présentés dans le tableau n°1.
Tableau n°1 : Modes d’évacuation des eaux usées de lessives et de vaisselles par type d’habitat à Bingerville
Source : Enquête de terrain, Kambiré et al., octobre 2020
L’analyse des données du tableau n°1 montre que les réseaux d’égout constituent à 50% les principaux lieux d’évacuation des eaux usées des ménages des quartiers résidentiels tels que Mamadou Coulibaly, Résidentiel. Quant aux ménages des quartiers à habitats économiques tels que Ayopoumin, Blanchon, 27,5% d’entre eux rejettent plus ces eaux usées dans les fosses septiques. Mais l’observation sur le terrain montre le contraire car les ménages de ces quartiers déversent les eaux de vaisselles et lessives dans les rues ou dans les cours. Concernant les quartiers précaires comme Gbagba, Gbagba extention, Cimétière, EECI et Agriculture, 46,3% des ménages déversent leurs eaux usées dans les rues ou derrière les cours. Cette pratique est à la base de la dégradation des rues. En effet, avec l’insuffisance du réseau de drainage dans le milieu urbain de Bingerville, on observe la stagnation et l’écoulement des eaux usées dans ces quartiers (Photo n°1).
Photo n°1 : Eaux usées de lessive et de vaisselles à Gbagba, un quartier sous-équipé de Bingerville
Source : Prise de vue J.K .Lama, octobre 2020
Au premier plan de la photo n°1, les eaux usées de lessive et de vaisselles déversées traversent le quartier Gbagba. Les vendeuses sont installées à proximité pour y pratiquer leur commerce.
Ces eaux se concentrent dans des dépressions pour devenir un lieu de prédilection des moustiques. L'assainissement constitue l’un des éléments fondamentaux dans la préservation ou l'amélioration de la santé de l'individu et de la communauté tout entière. Or dans la ville de Bingerville, la gestion des eaux usées n’est pas efficiente. Elle se fait de manière individuelle non seulement en ce qui concerne les eaux usées de lessive et de vaisselle mais aussi pour les eaux usées de douche (Tableau n°2).
Tableau n°2 : Les lieux d’évacuation des eaux de douche
Source : Enquêtes de terrain, B. Kambiré et al., octobre 2020
Plusieurs méthodes sont utilisées par les ménages pour l’évacuation des eaux usées de douche selon le type d’habitat.
L’analyse des données du tableau n°2 montre que les fosses septiques ou puits perdus constituent à 100% les principaux lieux de rejet des eaux usées de douche dans les quartiers résidentiels. Quant aux ménages des quartiers à habitats économiques, 85,5% rejettent les eaux usées de douche dans les fosses septiques. Concernant les quartiers précaires, les fosses septiques ou puits perdus constituent les lieux d’évacuation des eaux usées pour 58,5% des ménages. Mais les observations sur le terrain ont permis de constater que dans les quartiers à habitats précaires la plupart des fosses septiques / puits perdus sont endommagés ou inexistants laissant couler les eaux usées dans les rues (Planche n°1). Aussi, certains chefs de ménages (29,3%) relient directement leurs fosses septiques/puits perdus aux caniveaux à ciel ouvert ou aux ravins.
Planche n°1 : Eaux usées stagnantes dans un quartier précaire de Bingerville
Source : Prise de vue, J. K. Lama, mars 2021
La photo A présente un tuyau à ciel ouvert qui déverse les eaux usées de douche en plein air, derrière les concessions, sans aucun aménagement tandis que sur la photo B, ces eaux stagnent devant les habitations.
L’évacuation des eaux vannes est aussi un véritable problème dans le milieu urbain à Bingerville. Le mode d’évacuation diffère dans les ménages et selon le type d’habitat (Tableau n°3).
Tableau n°3 : L’évacuation des eaux vannes selon la typologie des quartiers
Source : Enquête de terrain, B. Kambiré et al,. octobre 2020
L’analyse du tableau n°3 montre que 45 chefs de ménages, soit 100% des enquêtés des quartiers résidentiels évacuent les eaux vannes par le biais des fosses septiques. Dans les quartiers à habitats économiques, les égouts sont utilisés par 68 ménages, ce qui donne 87% de l’échantillon. Ces égouts sont en mauvais état. 13% des ménages ont recours aux puits perdus et fosses septiques. Dans les habitats précaires, les ravins sont utilisés par les ménages à 7,3%, les puits perdus à ciel ouvert (53,7%) et les fosses septiques (39%) constituent les principaux lieux d’évacuation des eaux de vannes des ménages. Ces méthodes d’évacuation des eaux vannes présentent des risques sanitaires pour la population car celles-ci sont constituées des sous-produits de la digestion tels que les matières fécales et l'urine.
2.1.2. Gestion des ordures ménagères
Les ordures ménagères, avant d’être évacuées au lieu de groupage, sont d’abord conservées par les ménages. Le tableau n°4 présente les modes de conditionnement des déchets dans les ménages selon les types de quartiers.
Tableau n°4 : Modes de conditionnement des ordures dans les ménages (en %)
Source : Enquêtes de terrain, B. Kambiré et al., Octobre, 2020
L’analyse du tableau n°4 montre que pour la conservation des ordures ménagères à domicile, 47% des chefs de ménages du quartier résidentiel ont recours aux demi-futs plastiques. Les sachets (35%) et les sacs vides (12%). Dans les quartiers à habitats économiques tels que Ayopoumin, Blanchon, 44% des ménages utilisent les sacs comme mode de conditionnement des ordures. Les seaux constituent le deuxième mode le plus utilisé dans ces types d’habitats avec 31,3% des ménages. 13,3% et 8,4% des ménages utilisent respectivement les sachets et les corbeilles. Dans les quartiers à habitats précaires (Gbagba extention, Gbagba, EECI, Cimetière, Agriculture), les seaux sont utilisés par 36,80% des chefs de ménages, les sacs par 26,80% et les sachets, 22%. Dans ces types de quartiers, les ordures sont entreposées au sol et créent des désagréments aux populations. Les déchets amassés au sol, à l’extérieur des habitations, sont souvent emportés par le vent, les rongeurs et autres animaux errants.
Pour se débarrasser des ordures ménagères conditionnées dans les ménages, différents modes d’évacuation sont observés (Tableau n°5).
Tableau n°5 : Modes d’évacuation des ordures ménagères par les ménages
Source : Enquêtes de terrain, B. Kambiré et al., Octobre, 2020
L’analyse du tableau n°5 montre que les principaux modes d’évacuation des ordures ménagères se font dans les centres de groupage, par la collecte municipale, les broussailles et les caniveaux. Dans le quartier Résidentiel, 58,1% des chefs de ménage éliminent leurs déchets dans les centres de groupage et 41,9% par la collette municipale. Dans les habitats économiques comme Ayopoumin, Blanchon, ce sont 60,9% des ménages qui rejettent leurs ordures dans les centres de groupage et 24,69% ont recours à la collecte municipale. Seulement 11,5% des ménages utilisent les broussailles et les caniveaux. En ce qui concerne les quartiers à habitats précaires que sont EECI, Gbagba, Gbagba extention, Cimetière et Agriculture, 34,1% des ménages utilisent les centres de groupages, 17,1% la collecte municipale et 48,2 ont recours aux caniveaux, broussailles, rues pour éliminer les ordures. Selon l’enquête menée, le recours aux caniveaux, rues et broussailles pour éliminer les ordures ménagères dans les habitats précaires et évolutifs à Bingerville s’explique par l’éloignement des points de dépôts. Les ménages éloignés des lieux de groupage ont du mal à y accéder compte tenue de la distance et du relief de plateau entaillé par de nombreuses vallées. Ces ménages déversent leurs ordures simplement dans les rues (Photo n°2).
Photo n°2 : Lieu de déversement des ordures ménagères
Source : Prise de vue, J.K. Lama, mars 2021
Au premier plan de la photo n°2, une eau usée ruisselante provenant du haut plateau dans laquelle sont déversées les ordures ménagère à Gbagba.
2.1.3. Manque d’infrastructures routières et d’assainissement
En dehors de la voie principale qui traverse la ville et de quelques voies des quartiers centraux, le reste du milieu urbain de Bingerville ne bénéficie pas d’infrastructures d’aménagement routier. Les voies des quartiers périphériques ne sont pas bitumées. Pendant les saisons pluvieuses, ces quartiers sont inaccessibles. On assiste en effet, à une dégradation accélérée des rues par l’étalement des eaux de ruissellement. Cette situation engendre de nombreuses difficultés environnementales qui mettent en mal la qualité de vie des riverains. La ville de Bingerville dans son ensemble, hormis le quartier administratif (ancienne cité blanche), a un niveau d’équipement et d’assainissement jugé très bas. En effet, aucun ménage n’a accès à un réseau d’évacuation d’eaux usées. Les quartiers sont sujets à des inondations lors des saisons pluvieuses. La gestion des eaux usées reste individuelle. En effet, en raison de l’absence de réseau d’égouts, l’obligation a été faite par la municipalité aux populations de construire des bacs à puisards (ou puits perdus). Malgré cette injonction, des ménages, dans la ville de Bingerville, ne disposent pas de ces ouvrages. L’enquête révèle que la proportion des ménages qui ont recours aux voies publiques, aux caniveaux ou à la cour de leur concession pour évacuer les eaux usées est de 50%. De même, le réseau de collecte des ordures ménagères et des déchets solides reste largement déficitaire.
Photo n°3 : Sol érodé dans le milieu urbain à Bingerville 
Source : Prise de vue, J. K. Lama., Octobre 2020
Au premier plan de la photo n°3, l’on aperçoit une rue complètement dégradée, en plein milieu urbain par manque d’infrastructure d’évacuation des eaux pluviales.
2.1.4. Niveau de dégradation du cadre de vie de Bingerville
Les pratiques qu’adoptent les ménages face à la salubrité et l’assainissement sont déterminantes pour le maintien ou l’amélioration de leur santé. On relève que les pratiques auxquelles ont eu recours les populations à l’égard de certaines questions comme le mode d’évacuation des eaux usées et des ordures ménagères se sont avérées inefficientes. La pauvreté et l’ignorance demeurent les principales raisons évoquées par les ménages enquêtés. En effet, les réponses recueillies à la question « pourquoi les populations n’adoptent pas de comportements qui sont de nature à maintenir leur cadre de vie sain ? », 31%, mettent en cause le manque d’infrastructures de gestion des déchets dans les quartiers, 39% des chefs de ménages enquêtées estiment en revanche que les populations agissent mal parce qu’elles sont pauvres et 30% lient cette situation à un manque d’éducation sanitaire et/ou environnementale des populations.
À l’aide du modèle de spatialisation du niveau de salubrité, nous avons procédé à la classification des quartiers de Bingerville selon leur niveau d’insalubrité. Partant des résultats obtenus, les quartiers de la ville de Bingerville diffèrent les uns des autres selon le niveau de la dégradation de l’environnement comme illustrée par la carte n°2.
Les quartiers d’habitat de types précaires, sous équipés comme Gbagba, Gbagba extension, Cimetière, Agriculture et EECI ont un niveau d’insalubrité très élevé (entre 9,1 et 16), contrairement aux quartiers économiques (6.1 - 9) et résidentiels (0-3). Le niveau d’insalubrité à Bingerville est donc en rapport avec la typologie des quartiers.
Carte n°2 : Niveau de dégradation des quartiers de Bingerville
Source : Enquêtes de terrain, B. Kambiré et al., Octobre, 2020
2.2. Les principales pathologies récurrentes à Bingerville
La prolifération des dépôts d’ordures ménagères, l’envahissement des quartiers par les eaux usées contribuent énormément à la dégradation de l’environnement et causent de nombreux risques sanitaires à la population. Selon l’enquête de terrain, les principales maladies environnementales déclarées par les chefs de ménages sont le paludisme (55,3%), les Infections Respiratoires Aigües (IRA) (13,73%), la diarrhée (9,6%) et les dermatoses (7,6%). On peut expliquer ces résultats par la cohabitation des ménages avec les eaux usées et les ordures ménagères.
Les données fournies par les différents centres de santé de Bingerville montrent les taux des pathologies suivantes : 60,20% des pathologies retenues après les consultations à l’Hôpital Général sont le Paludisme, 61,79% s’observe au Centre de Santé Urbain de Gbagba, 51% à la PMI de Bingerville. Le taux des Infections Respiratoires Aigües sont de 6,74% à l’Hôpital Général, 1,65% au CSU de Gbagba, 18,17% à la PMI de Bingerville. Les taux de Diarrhée sont de 3,78% à l’Hôpital Général, 0,67% au CSU de Gbagba, 13,81% à la PMI de Bingerville. Les taux de Dermatose sont de 1,22% à l’Hôpital Général, 3% au CSU de Gbagba et 12,22% à la PMI.
Le paludisme est la pathologie la plus récurrente selon les données des centres de santé avec 3356 cas sur un total trimestriel de 5 623 cas de pathologies enregistrées en 2020. Les infections respiratoires aigües s’élève à 285 cas, les dermatoses 115 cas et les diarrhées 225 cas sur 5623 cas de pathologies enregistrées. Le nombre de cas des autres pathologies s’élève à 1642.
2.3. Relation entre problèmes environnementaux et les maladies dont souffre la population
Carte n°3 : Relation entre les facteurs de dégradation du cadre de vie et les problèmes de santé à Bingerville
La carte n°3 met en évidence le lien entre la dégradation de l’environnement dans les différents quartiers de Bingerville et le nombre de malades liés à l’insalubrité. L’analyse des données du terrain révèle une corrélation croissante entre les problèmes de stagnation des eaux usées, les déchets et l’état de morbidité des quartiers à Bingerville. Cette corrélation est perceptible à travers le graphique n°1. Dans cette corrélation linéaire, la variable explicative est l’insalubrité des quartiers. L’état des morbidités est la variable expliquée. Une courbe de tendance linéaire a été ajoutée au nuage de points obtenu. La croissance de cette courbe montre que les deux variables évoluent dans le même sens. Ce qui veut dire que le nombre de malades croit en fonction de l’évolution du niveau d’insalubrité du cadre de vie dans les quartiers.
Graphique n°1 : Corrélation entre le niveau de dégradation du cadre de vie et le nombre de malades à Bingerville
Source : Enquêtes de terrain, B. Kambiré et al., octobre 2020
Pour un niveau de significativité de 0,05% et de coefficient de corrélation (r = 0,8845), l’intensité de la liaison entre les deux variables est testée par le coefficient de détermination. Le coefficient de détermination (r² = 0,7824) traduit l’existence d’une corrélation d’intensité très forte entre le niveau d’insalubrité et l’incidence des maladies environnementales, car r² = 0,7824 est supérieur à 75%. Pour un nombre de degrés de liberté de 7, le r² de cette corrélation linéaire est de 0,7824 et le r = 0,8845. Le r lu dans la table de PEARSON est de 0,711. Le r calculé (0,88) est supérieur au r lu (0,71). On conclut alors qu’il existe une corrélation linéaire significative entre ces deux variables. Le coefficient de détermination traduisant l’intensité de relation entre le niveau d’insalubrité des quartiers et le nombre de malades montre que 78,24% des maladies environnementales seraient attribuées à l’insalubrité à Bingerville. En d’autres termes, le niveau d’insalubrité est pertinent dans la distribution des maladies environnementales. Cela se voit dans les quartiers Gbagba 1ère extention, Gbagba, EECI, Cimetière Agriculture qui ont les plus grands niveaux d’insalubrité. Ces différents quartiers ayant les niveaux de dégradation du cadre de vie très élevé, enregistrent les plus grands nombres de malades dans la ville.
Conclusion
Conclusion
L’objet de cette contribution est d’analyser les déterminants de la dégradation multiforme du cadre de vie des populations de Bingerville et son lien avec leur santé. Au total, la gestion des eaux usées reste précaire à Bingerville. Les fosses septiques, les rares caniveaux existants, les rues et même la cour sont les principaux lieux d’évacuation de ces eaux usées quel que soit le type d’habitat. Si dans les quartiers résidentiels aucun ménage ne déverse les ordures dans les caniveaux, les rues et les broussailles, dans les quartiers à habitat économique et précaire, en revanche, ce sont respectivement 11,5% et 48,2% des ménages qui ont recours à ces différents lieux pour l’élimination de leurs ordures ménagères.
Cette insalubrité, couplée aux problèmes d’assainissement à Bingerville, génère des risques de maladies environnementales tel le paludisme qui vient en tête avec 46% des pathologies de la localité.
L’état environnemental de Bingerville et les risques de vulnérabilité des populations aux maladies qui en résultent varient selon les quartiers. 78,24% des maladies environnementales sont attribuées à l’insalubrité des quartiers, du fait de la négligence des risques sanitaires. Ce sont les quartiers Gbagba 1ère extention, Gbagba, EECI, Cimetière Agriculture qui ont les niveaux d’insalubrité environnementale les plus élevé. Ces différents quartiers enregistrent les plus grands nombres de malades dans la ville.
La ville de Bingerville reste très préoccupée par la qualité de l’environnement urbain. La gestion des établissements humains dans cette ville est devenue une nécessité pour les populations et les pouvoirs publics en raison de l’insalubrité qui expose la population aux maladies environnementales telles que le paludisme, les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires aigües, les dermatoses. Ce qui fait dire à Margaret Chan, Directeur général de l’OMS (2014) que « la santé de la population passe par la salubrité de l’environnement. Si les pays ne prennent pas des mesures afin que les populations vivent et travaillent dans un environnement sain, des millions de personnes continueront à tomber malades et à mourir ». Le bien-être de l’homme dépend profondément de la qualité de son environnement. Face aux risques sanitaires liés aux mutations environnementales, il existe des possibilités d’action (W. Dab et al., 2013, p.18). Le développement contemporain des politiques environnementales doit faire appel à de nouvelles formes d’actions et d’instruments à appliquer face aux multiples transformations actuelles que subit le cadre de vie urbain. Ces actions doivent permettre de résister aux effets des mutations environnementales en milieu urbain ivoirien, de les absorber, de s'y adapter et de se remettre de manière rapide et efficace aux différentes mutations environnementales négatives sur le bien-être de la population. « La maîtrise de l’assainissement au sens large est de nos jours l’un des défis majeurs des villes en développement » (Y.H. B. Nguendo, 2008, p.4). Quoiqu’il en soit, les questions soulevées et traitées par cette contribution posent le problème du rôle de l’État et de ses démembrements décentralisés en matière de risque/sécurité sanitaire des populations dans un monde de plus en plus mondialisé.
Références
Références bibliographiques
BOUBA Djourdebbé Franklin, 2019, « Santé Environnementale dans les Villes en Afrique Subsaharienne: Problèmes Conceptuels et Méthodologiques », European Scientific Journal, Edition Vol.15, No9. https://eujournal.org/index.php/esj/article/view/11906/11335, pp. 192-213.
COULIBALY Aboubakar, KAMBIRE Bébé et SOUMAHORO Donilibé Vamara, 2020, « Impacts des activités des marches dans la dégradation du cadre de vie à Daloa (centre-ouest de la Côte d’Ivoire) », Journal Africain de Communication Scientifique et Technologique, Série Sciences Sociales et Humaines, no88, IPNETP, Abidjan, pp. 1461-1477.
COULIBALY Moussa, 2016, Dégradation de l’environnement et santé à Daloa, Thèse de doctorat unique en Géographie, Université Félix Houphouët-Boigny-Abidjan, 329 p.
COULIBALY Moussa, TUO Péga & AKÉ-Awomon Djaliah Florence, 2018, « Insalubrité et maladies infectieuses dans les quartiers précaires de Yopougon Gesco-Attié : cas de Judé, Mondon et Ayakro (Abidjan, Côte d’Ivoire) », Revue Espace, Territoires, Sociétés et Santé,1(1), 46–65, mis en ligne le 08 juillet 2018, https://www.retssa-ci.com/index.php?page=detail&k=18
Dab William, Danielle Salomon, 2013, Agir face aux risques sanitaires, hors collection, JOUVE, 41 p.
DONGO Kouassi, KOUAME Koffi Ferdinand, KONE Brama, BIEMI Jean, TANNER Marcel et CISSE Gueladio, 2008, « Analyse de la situation de l’environnement sanitaire des quartiers défavorisés dans le tissu urbain de Yopougon à Abidjan, Côte d’Ivoire », VertigO. La revue électronique en sciences de l'environnement de Montréal ; 8 (3). https://journals.openedition.org/vertigo/6252, DOI : 10.4000/vertigo.6252.
EVIAR Ohomon Bernard, ATTA Koffi, GOGBE Teré, 2013, «Stratégies de gestion des cadres et conditions de vie des populations à Abobo », European Scientific Journal (Ed) vol.9, No.29, pp. 128-143.
Institut National de la Statistique (INS) Côte d’Ivoire, 2014. Synthèse des résultats définitifs du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH), INS, Côte d’Ivoire, 232 p.
Institut National de la Statistique (INS), 1998. Recensement général de la population et de l’habitat RGPH). INS, Côte d’Ivoire, 218 p.
Institut National de Statistique (INS), 1975. Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH).
KAMBIRE Bébé, YMBA Maïmouna, OUATTARA Karidiatou Sotia, 2018, « Gestion des déchets liquides et vulnérabilité des populations aux maladies : cas de Songon Agban, District d’Abidjan », TROPICULTURA, Volume 36, N°2, Royal Academy for overseas sciences, Belgique, pp. 407 - 416.
KOUASSI Konan, 2012, Insalubrité, gestion des déchets ménagers et risques sanitaires infanto-juvénile à Adjamé, Thèse de Doctorat, Université Félix Houphouët-Boigny, 370 p.
Akou Don Franck Valéry Loba, 2010, « Les déterminants de la dynamique spatiale de la ville de Bingerville (sud de la Côte d'Ivoire) de 1960 à nos jours », EchoGéo [En ligne], 13 | 2010, mis en ligne le 20 septembre 2010, consulté le 04 juillet 2021. URL : http://journals.openedition.org/echogeo/12078 ; DOI : https://doi.org/10.4000/echogeo.12078.
MCMICHAEL Anthony John, 2000, « Environnement urbain et santé dans un monde de mondialisation croissante: enjeux pour les pays en développement », Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 78, pp.1117-1126.
NGUENDO Yongsi H.B, SALEM Gérard, THOUEZ Jean-Pierre, 2008, « Risques sanitaires liés aux modes d'assainissement des excréta à Yaoundé, Cameroun », Natures Sciences Sociétés, Vol. 16, p. 3-12. URL : https://www.cairn.info/revue-natures-sciences-societes-2008-1-page-3.htm
NGWE Emmanuel, BANZA-NSUNGU Antoine, 2007, Les déterminants sociaux environnementaux de la mobilité diarhiéique des enfants de moins de 5 ans en milieu urbain au Cameroun : les villes d' EBOLOWA et MAROUA, Rapport de Synthèse, 17 p.
OMS, 1994, Crise de la santé en milieu urbain. Les stratégies de la santé pour tous face à une urbanisation galopante. Rapport des Discussions Techniques de la Quarante-quatrième Assemblée mondiale de la Santé, Genève, 93 p.
PRÜSS-ÜSTÜN Annette, CORVALÁN Carlos, 2006, Prévenir la maladie grâce à un environnement sain: une estimation de la charge de morbidité́ imputable à l'environnement: résumé analytique ; Rapport, OMS ; Genève.
SIP Sié Jean Pierre, ATTA Koffi Lazare, 2019, les problèmes environnementaux de la ville de Bouna (nord-est de la Côte d’Ivoire), Revue Ivoirienne des Lettres, Arts et Sciences Humaines, N° 43, Tome 1, École Normale d’Abidjan, pp. 151-162
SOULANCÉ Dominique, GAIMARD Maryse, BLEY Daniel & VERNAZZA-LICHT Nicole. (2011). Lieux de vie et santé des populations : l’exemple du chikungunya à la Réunion. Cahiers de géographie du Québec, 55 (156), 603–621.
TRAORE Drissa, 2017, « Déchets ménagers et santé de la population en milieu urbai n à Anyama, District d’Abidjan ». Thèse de doctorat unique, Géographie, Université Félix Houphouët-Boigny, 252 p.
TUO Péga, COULIBALY Moussa, AKA Djaliah Florence, TAMBOURA Awa Timité., ANOH Kouassi. Paul., (2016), « Ordures ménagères, eaux usées et santé de la population dans la ville de Daloa (Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire) », Regardsuds, n°2, Institut de Géographie Tropicale, Université Félix Houphouët- Boigny, pp.192- 213.
Walid Chouari, 2013, « Problèmes d'environnement liés à l'urbanisation contemporaine dans le système endoreïque d'Essijoumi (Tunisie nord-orientale) », physio-Géo, Volume 7, https://doi.org/10.4000/physio-geo.3493, pp. 111-138.
SYLLA Yaya, 2016, Prolifération des déchets et émergence des maladies infectieuses dans la ville d’Abidjan : cas de la commune de Koumassi, thèse de doctorat en Géographie, Université Félix Houphouët Boigny, 365 p.
YAO Armel Dimitri, 2017, Gestion des eaux usées et qualité du cadre de vie à Abobo-Sogefiha, Mémoire de Maitrise, Université Félix Houphouët-Boigny, 113 p.
YAO Kouassi Quonan Christian, 2010, A la recherche d’une synergie pour la gestion des déchets ménagers en Côte d’Ivoire : Cas du District d’Abidjan, Thèse de doctorat en Géographie, Université de Maine, France, 305 p.
YASSI Gilbert Assi ; Dindji Médé Roger, 2016, « Un exemple de gestion différenciée des déchets solides ménagers à Cocody, à la périphérie d’Abidjan », Koffi-Didia Adjoba Marthe et Yapi-Diahou Aphonse (Eds), Périphéries abidjanaises en mouvement, Yaoundé, IRESMA, pp. 119-135.
YASSI Gilbert Assi, OUATTARA Awa, 2016, « Déchets et voirie dans la ville : la question des liens, l’expérience de Bingerville », Le Journal des Sciences Sociales, Numéro spécial « Variations subsahariennes », pp. 97 - 110.
Downloads
Publié
Comment citer
Revue Espace, Territoires, Sociétés et Santé ,[En ligne], 2021,, mis en ligne le . Consulté le . URL: https://retssa-ci.com/index.php?page=detail&k=180
Numéro
Rubrique
Qui sommes-nous ?
Licence
Copyright (c) 2023 KAMBIRE Bébé, YASSI Gilbert Assi et LAMA Koffi Jacques