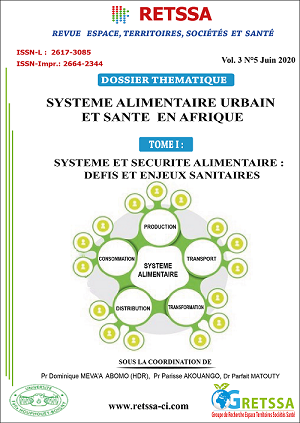1 |La protection maternelle et infantile au Gabon : des années 1930 aux années 1970
Maternal and child protection in Gabon: from the 1930s to the 1970s
Mots-clés:
Protection| maternelle| infantile| Période coloniale| Période post- coloniale| santé| Gabon|Résumé
Le niveau de santé au Gabon, au regard des principaux indicateurs demeure préoccupants traduisant, particulièrement, une vulnérabilité du couple mère-enfant. Selon l’Enquête Démographique et de Santé (EDSG II 2012), le taux de mortalité maternelle est estimé à 316 décès pour 100 000 naissances vivantes. Ce chiffre relativement élevé est un marqueur important de l’état de santé précaire dans lequel se trouvent la mère et l’enfant en particulier. Notre étude se propose d’analyser les politiques du Gabon plus spécifiquement celles liées à la protection maternelle et infantile, depuis la période coloniale jusqu’aux années 1970. L’étude s’appuie sur des données quantitatives et qualitatives issues des archives nationales qui nous permettent de mettre en lumière les réalités et tendances de la protection maternelle et infantile pendant cette période. En définitive, la question de la santé mère-enfant est aujourd’hui bien intégrée dans les politiques sanitaires nationales, cependant on constate un décalage entre ces politiques et les efforts techniques déployés sur le terrain, le nombre de décès du couple mère-enfant demeure préoccupant.
Introduction
La santé est un facteur déterminant du développement social et économique de tout pays. En assurant le bien-être physique, psychique et social de l’individu, elle comble ses besoins en termes de productivités. Selon l’une des définitions de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 1946),si la notion de « santé » se circonscrit à l’individu et à son épanouissement total, celle de la « santé publique » englobe l’ensemble des approches ou des efforts collectifs, administratifs et institutionnels qui visent à améliorer et à promouvoir la première. Un troisième concept intervient : celui de politique de santé. Il est considéré comme « l’attitude officielle exprimée par le gouvernement dans le domaine de la santé, lors des déclarations solennelles ou au sein de documents de planification » (M. Barbieri, P. Cantrelle, 1991, p.51). Ainsi définit, il vise la détermination des problèmes de santé majeurs dans un pays, et par la suite, établir les programmes d’action.
Les politiques de protection maternelle et infantile sont développées au Gabon depuis la période coloniale. En effet, les autorités coloniales, dans leurs diverses activités d’exploitation des ressources et de la mise en valeur des colonies, se sont confrontées aux diverses maladies qui sévissaient dans la colonie du Gabon, notamment les maladies endémo-épidémiques et la trypanosomiase (A. Longo, 2007, p.66) Dans la nécessité de disposer d’une main-d’œuvre considérable, ces dernières ont développé des politiques pour préserver la santé des populations en mettant un accent particulier sur le couple mère-enfant. Dès les indépendances, les autorités gabonaises ont compris l’impérieuse nécessité d’améliorer le bien-être de la mère et de l’enfant.
En dépit, d’une intensification de la Protection Maternelle Infantile, en 1955, le taux de mortalité infantile était de 230 pour 1000 (Archives Nationales de Brazzaville, ST, 1950-1955.) Les statistiques montrent que beaucoup d’enfants décédaient dans le milieu gabonais au cours des premières années de vie et le taux de mortalité infantile restait très élevé (Enquête Démographique et de Santé (EDSG II 2012).
C’est dans cette optique que le Gabon, érigé en territoire autonome en 1960, va poursuivre l’œuvre entreprise par le colonisateur.
Des études ont été menées sur la question de la protection maternelle et infantile. C’est le cas de A. Chovet (1990) qui a écrit sur la protection de la mère et de l’enfant en Afrique Equatoriale Française (AEF) de 1920 à 1956. Nous avons également les travaux de R. Assengone Minko (1984) sur les problèmes de santé de la mère et de l’enfant en zone rural : cas de Mitzic au Gabon.
Notre étude se veut complémentaire aux précédentes en s’intéressant plus particulièrement à l’évolution de la politique sanitaire au Gabon, notamment au couple mère-enfant.
Le présent article tente de répondre à la question suivante : quelle politique sanitaire les autorités coloniales et post- coloniales ont mené pour améliorer le bien-être de la femme et de l’enfant ?
Les hypothèses suivantes vont guider notre étude :
-
les problèmes de santé de la mère et de l’enfant relevés dans tous les rapports de santé comme goulot d’étranglement du sous-peuplement du Gabon dénotent une certaine négligence de la part des autorités coloniales ;
-
après les indépendances, malgré l’existence des politiques en faveur de la protection maternelle et infantile, on constate un décalage dans les faits.
L’objectif de cet article est d’analyser les politiques sanitaires liées à la protection maternelle et infantile au Gabon, et leur impact réelle sur le terrain, de l’époque coloniale, à l’époque post-coloniale.
Méthodologie
1. Méthodologie
Nous avons choisi la méthode régressive qui consiste pour l’historien à remonter du présent au passé. Les limites temporelles portent vont des années 1930 aux années 1970, car comme l’affirme F. Braudel (1969, p.42) : « tout travail historique décompose le temps. L’historien ne sort jamais du temps de l’histoire, le temps colle à sa pensée comme la terre à la bêche du jardin ».
Les années 1930 marquent les débuts de la protection maternelle et infantile avec l’initiative de l’œuvre du berceau gabonais en 1936. Quant aux années 1970, sur le plan sanitaire, c’est la fin du 2e plan quinquennal.
La recherche documentaire a été d’une importance capitale pour saisir le contenu de la politique de protection du couple mère-enfant émise par les pouvoirs publics depuis la colonisation jusqu’aux années 1970. Ainsi, cette méthode d’enquête a permis de répertorier les rapports de santé maternelle et infantile, les articles de lois, les documents officiels et non officiels.
Pour ce qui concerne la période coloniale, nous avons travaillé avec les sources d’archive de première main (les manuscrits) et les sources imprimées (publications officielles publiées au cours de la période retenue, etc.).
Pour la période post- coloniale, les différents documents (ouvrages et articles de revues) ont permis de cerner les orientations des politiques de protection maternelle et infantile telles que définies par les autorités coloniales et les pouvoirs publics gabonais, mais aussi, saisir les grands principes de fonctionnement des maternités, des PMI (qui sont notre champ d’étude). Nous avons collecté des données sur les sites internet des administrations suivantes :
-
la direction générale du Ministère de la santé ;
-
la direction générale des statistiques et des études économiques.
Sur ces deux sites, nous avons obtenu des rapports d’enquêtes, des rapports d’activités et des statistiques.
Les rapports ont été complétés par de nombreuses publications d’institutions internationales, des articles scientifiques et les ouvrages.
Parmi les documents recueillis, nous avons sélectionné ceux qui abordent directement l’élaboration et la mise en place de la stratégie de santé et les rapports d’activités qui souvent, livrent un premier aperçu des écarts entre les discours et les objectifs visés. Il a été également question des textes officiels : textes juridiques, textes politiques et les documents précisant les missions des différentes structures en charge de l’organisation de la santé.
Résultats
2. Résultats et discussion
2.1. La protection maternelle de la période coloniale jusqu’aux années 1970
La population gabonaise stagnait voire même reculait depuis le XIXe siècle. Dans la colonie du Gabon sévissait une mortalité infantile élevée. Celle-ci constitue, au même titre que l’infécondité une menace importante, vu que «un peuple qui n’a pas d’enfants est un peuple condamné » (J. Verrière, 1978, p. 36).
2.1.1. La protection maternelle pendant la période coloniale
Nous allons tout d’abord examiner la situation pendant la colonisation et ensuite des indépendances aux années 1970.
Le moyen pratique de conservation de la race prônée dans les années 20, consistent à élaborer une organisation de la politique sanitaire et des textes réglementaires. Il est difficile de parler de Protection Maternelle Infantile en Afrique Equatoriale Française A.E.F. et plus particulièrement au Gabon. Non qu’elle ait été inexistante, mais parce que tout l’effort de l’assistance médicale s’était porté sur la lutte contre la maladie du sommeil. La circulaire du 28 mars 1929 est éloquente à ce sujet : « c’est autour des services de trypanosomiase que s’organise l’ensemble médical, qu’il s’y accroche comme autour d’une colonne vertébrale (Dr. Beaudiment 1938, p189).
Les débuts du service de protection maternelle infantile correspondent aux premières initiatives de l’œuvre du Berceau gabonais à Libreville qui avait dispensé 136 consultations pour enfants de 2 à 5ans en 1936, pratiqué 72 accouchements à domicile et assuré la vaccination du Bacille de Calmette et Guérin (B.C.G.) à tous les nourrissons inscrits. Les missions protestantes du Gabon avaient quant à elles, réalisé dans leurs 7dispensaires, 27 accouchements et 95 574 consultations tandis que l’hôpital privé du docteur Schweitzer comptait 7 accouchements de femmes européennes et 70 accouchements de femmes indigènes. Ce n’est qu’en 1936, par arrêté du 15 juin que le service de l’œuvre de la protection de l’enfance et de la maternité se créa en A.E.F
Auparavant, les médecins assuraient les consultations des femmes enceintes et des nourrissons dans les rares postes médicaux qui existaient. Avant 1936, les femmes étaient consultées de manière irrégulière par le corps médical. Mais à partir de cette même année, dans les formations fixes et lors des tournées, les femmes enceintes étaient examinées par les infirmières visiteuses. Mais dans la réalité, les femmes africaines se soumettaient peu à des visites régulières dont elles ne saisissaient pas l’utilité. Par exemple, l’analyse des urines paraissait insolite ; quant au toucher vaginal, il n’était aucunement toléré, car souvent accusé d’être à l’origine d’un accouchement prématuré. L’évolution de ces consultations nous est donnée dans les tableaux n°1 et 2.
Tableau n°1 : Rendement des services de PMI de 1939 à 1947
Source : Archives Nationales du Gabon ANG, Rapport annuel, CAOM 4(1) D55, 1943
De 1939 à 1943, les consultations prénatales augmentèrent. Cette évolution n’était pas due au fait que les femmes reconnaissaient l’intérêt de ces consultations, mais était plutôt due au fait que leurs enfants recevaient des petits cadeaux matériels. Nous constatons également une fluctuation des consultations à partir de 1945. Nous pouvons dès lors avancer que cette baisse était le résultat de l’évolution socio-politique qui influença la fréquentation des maternités. Pour essayer de démontrer l’importance de la PMI, nous prendrons l’exemple de la province de l’Ogooué-Maritime qui est significatif car, c’était un lieu de rencontres de nombreuses populations gabonaises attirées par les activités commerciales et l’industrie du bois.
Tableau n°2 : Rendement des services de PMI dans les œuvres publiques et privées de 1938 à 1943 dans la province de l’Ogooué-Maritime
Source : Archives Nationales du Gabon (ANG), Fonds de la Présidence de la République, Rapport annuel de 1943, carton 760
Le tableau n°2 nous permet de suivre l’évolution du rendement des PMI dans le département de l’Ogooué-Maritime. Notons toutefois que ce département est celui de l’Estuaire, les mieux dotés en infrastructures. Ces départements attirèrent donc plus de femmes dans les centres médicaux et représentèrent le mieux l’évolution de la fréquentation des maternités dans le territoire du Gabon.
De 1938 à 1943, les consultations dans les formations publiques augmentent. En 1938 elles étaient de 721 alors qu’en 1943 elles atteignaient 2640 soit 1849 de plus. Ces augmentations sont la preuve marquante de la compréhension de femmes de l’Ogooué-Maritime du rôle que jouaient ou que pouvaient jouer pour elles et pour leurs futurs enfants les consultations prénatales. Pendant cette même période, le nombre de consultantes auprès des privées décroît. C’est certainement parce que les femmes n’ayant pas de moyens financiers préféraient se remettre aux structures publiques.
Jusqu’en 1945, date de l’entrée en fonction de la première sage-femme, les accouchements furent rarement recensés dans la colonie. A défaut de sage-femme et de maternités, certains médecins assurèrent les accouchements et les consultations des femmes. De plus, la création de nouveaux centres médicaux avec hospitalisation, et l’amélioration du confort des anciennes structures attirèrent plus de malades. De 1939 à 1943, les accouchements dans les formations de l’Ogooué-Maritime passent de 312 à 493 (Archive Nationale du Gabon, Rapport annuel, 1943). Le rapport souligne que malgré le nombre de femmes visitées, il y a une faible proportion qui accouche dans les maternités. Cela signifie que les accouchements à l’hôpital se heurtaient encore à la mentalité qui voulait qu’on reste encore attaché à l’accoucheuse du village. En 1942, il y’a eu 149 accouchements en milieux ruraux dans l’Ogooué-Maritime et 354 en 1943. En tenant compte de ces chiffres et de ceux qui suivent (accouchements dans les formations), les % de naissances dans ces milieux sont pour 1942 et 1943 21, 01 et 41, 9. (Cf rapport annuel, 1943).
Quant aux consultantes post-natales, leur nombre passa de 4 676 en 1951 à 26 005 en 1956 et le nombre des consultations de 9 409 à 51 374 (L. M. Durand-Reville, 1958, p. 54). En regardant l’évolution des consultations et des consultantes prénatales et post-natales, nous remarquons que, contrairement aux consultations prénatales, les consultations et les consultantes post-natales connurent une augmentation vertigineuse. Dans les milieux urbains notamment, les femmes africaines acceptaient plus volontiers les consultations après l’accouchement que pendant la grossesse.
Ceci explique d’ailleurs le nombre croissant des consultations infantiles qui passaient de 108 408 en 1951 à 156 210 en 1956.
Malgré une politique nataliste, et l’intérêt porté à la mère et à l’enfance africaine, le nombre des sages-femmes et des matrones, censé favoriser cette politique et cet intérêt, resta insuffisant au regard des besoins de la population pendant la période coloniale. Le tableau n°3 montre l’évolution des effectifs de sages-femmes africaines.
Tableau n°3 : Evolution des effectifs de sages-femmes africaines en A.E.F. de 1946 à 1954
Source : Afrique Equatoriale Française (A.E.F.), Rapport sur l’exécution du PPQ, P.M-28
Le Gabon avait les effectifs les plus élevés chez les sages-femmes comparé aux autres territoires de la fédération. En effet, on dénombrait en 1954, 10 sages-femmes au Gabon, 7 en Oubangui, 4 au Moyen-Congo et 3 au Tchad.
Le tableau n°4 décrit l’évolution des effectifs de matrones africaines en AEF.
Tableau n°4 : Evolution des effectifs de matrones africaines 1946-1954
Source : Afrique Equatoriale Française (A.E.F.), Rapport sur l’exécution du PPQ P.M-28
Outre l’insuffisance numérique des sages-femmes et des matrones, ce corps de métier fut mal réparti et souvent regroupé dans la même localité.
L’activité de la PMI se manifestera alors de diverses façons : les réunions de femmes enceintes au cours desquelles leur sont fournies des conseils touchant l’hygiène de la grossesse et de l’hygiène infantile, les visites aux femmes ayant accouchées à domicile ou à l’hôpital avec distribution des dons matériels, couches, savons, etc. Cette œuvre a pour but d’atteindre la femme et à travers elle, la famille africaine.
Pendant toute la période coloniale, « faire du noir » était devenu l’un des mots d’ordre de la politique coloniale de la France dans ses colonies. Tous les gouvernements, se devaient d’encourager la natalité dans les territoires et prendre toutes les mesures d’hygiène, d’assistance et prévention pour sauvegarder la race noire et les Africains.
2.1.2. Des indépendances aux années 1970
Soucieux de son accroissement démographique, le Gabon poursuit l’objectif colonial de la « conservation de la race ». Les infrastructures sanitaires existant dans les différentes régions, bien qu’importantes, n’arrivent pas ou plus à couvrir les besoins des populations en matière sanitaire. Ainsi, à partir de 1958, la nouvelle république autonome avec l’ouverture des nouveaux débouchés économiques qui nécessitent une main-d’œuvre abondante, oriente son programme de développement vers l’augmentation des capacités d’infrastructures existantes et la construction de nouvelles. « Ayant reconnu la santé comme un droit du citoyen, le gouvernement gabonais a réagi dès la première décennie de l’indépendance. Ici, c’est l’année 1970 qui a été marquante, puisque c’est cette année où a commencé l’application d’une politique sanitaire nouvelle, visant les objectifs suivants : accroissement du bien-être de la population par celui du confort physique, mental et social, augmentation du rythme de la croissance démographique par la baisse du taux de mortalité infantile et la lutte contre l’infécondité » (El Hadj Omar Bongo, 1984, p.148).
Dans ce programme, l’accent est particulièrement mis sur la protection maternelle infantile, base de l’économie d’un pays.
Les actions sont coordonnées à la fois entre le Ministère de la Santé, et d’autres Ministères, dans la protection maternelle infantile, depuis la grossesse jusqu’à la surveillance du jeune enfant au sein de son milieu social. Le service de santé public entreprend donc l’augmentation du nombre des maternités qui passe de 20 unités en 1961 à 34 unités en 1972 (Situation économique, sociale et financière de la République de 1964-1973). C’est dans ces maternités que sont dispensés les gestes essentiels de la vie humaine en même temps que la mère et aussi le père, dans une moindre mesure, acquiert une meilleure éducation hygiénique et sanitaire.
La protection maternelle infantile se charge, en fait, de coordonner les visites prénatales qui commencent normalement dès que la femme constate la disparition de ses menstruations jusqu’à la dernière semaine avant l’accouchement.
Elle passe par la surveillance de la prise de poids, la recherche des œdèmes, la prise de la pression artérielle, sachant qu’une femme doit prendre de 10 à 12 kg pendant sa grossesse.
Au Gabon, l’anémie est fréquente, car les parasites abondent : ankylostome, hématozoaire et bilharzie, ajoutés à d’autres carences entraînent une faiblesse de l’organisme. A partir des signes cliniques, on peut déterminer une anémie chez une femme enceinte. Ce qui nécessite la prise de fer pendant toute la période de la grossesse et la chloroquine pour lutter contre le paludisme.
Les réactions sérologiques pour la syphilis seraient utiles, puisqu’en dépistant la syphilis avant le quatrième mois, on peut par une simple injection de pénicilline, guérir la mère et protéger l’enfant. Etant donné le fait que la syphilis demeure l’une des causes d’avortement, il est impératif de la traiter très tôt au risque d’entraver l’évolution normale de la grossesse d’où, l’impérieuse nécessité de commencer les visites prénatales très tôt. Une grossesse bien suivie entraîne un accouchement sans complication. Le tableau n°5 indique les indices de variations des consultations prénatales.
Tableau n°5 Les consultations prénatales
Source : Réalisé à partir des données sur la situation économique sociale et financière de la République gabonaise de 1964-1975
Dans ce tableau, nous relevons les consultations proprement dites mais aussi les consultantes ; autrement dit, les personnes chargées de réaliser ces consultations. En observant l’évolution des consultations, nous notons que celles-ci est loin d’être linéaire. Elle renferme en effet, les phases d’accélérations et de décroissance.
Quant à l’accouchement, il se pratique dans les maternités pour celles qui sont suivies mais aussi pour celles qui ne le sont pas. Toutefois, la majorité des femmes rurales n’avaient pas de confiance aux maternités et se faisaient accoucher par des femmes spécialisées en la matière ou simplement par les gens de leur entourage qui avaient déjà acquis cette maturité.
L’accouchement en maternité demeure le moyen le plus sûr pour mettre au monde. Le phénomène s’est donc répandu. Il est pour cela pratiqué dans des conditions d’hygiène convenables par un personnel auxiliaire. Mais, les personnes requises sont à la pratique des accouchements sont les sages-femmes qui ont été formées pour les besoins de la cause.
Le tableau numéro 6 ci-dessous répertorie les accouchements annuels au sein des maternités du Gabon.
Tableau n°6 Le nombre d’accouchements annuels dans les maternités
Source : Premier Plan Quinquennal 1966-1970, p. 373
Situation économique, sociale et financière de la République 1964-1975
Ce tableau nous présente une vision exhaustive des accouchements en maternité. Ainsi, la croissance moyenne annuelle des accouchements entre 1957 et 1975 est de 7, 69%. On peut affirmer par rapport au taux d’accroissement que les femmes accouchent de plus en plus dans les maternités et que l’amélioration des conditions sanitaires des populations agit en faveur de la baisse de la mortalité. Les efforts fournis en matière de la P.M.I., ont porté leurs fruits.
En examinant le tableau numéro 2, nous constatons aussi les différentes phases de variations entre 1957 et 1961, le taux d’accroissement moyen annuel est de 10, 85%.
De 1968 à 1974, le taux d’accroissement moyen annuel est de 12, 69%. Quant à la dernière variation entre 1974 et 1975, elle est de 2, 10%.
Après l’accouchement, la femme et l’enfant sont sous surveillance médicale malgré le fait qu’ils ne soient pas internés et ce jusqu’à l’âge de cinq ans pour l’enfant. Cette surveillance est appelée post-natale ou encore néo-natale. Son but est de vérifier l’état de santé de la femme. Elle consiste à palper les seins et procéder à l’éducation en matière d’allaitement et d’alimentation de la mère. De plus, « la sage-femme procède au toucher vaginal pour voir la qualité des pertes dans le but de déceler une infection éventuelle… Le toucher permet aussi d’observer si l’utérus n’a aucune anomalie et si l’accouchée n’a pas d’hémorroïdes. En général, la surveillance post-natale permet à la sage-femme de revisiter complètement la femme ». Certaines complications peuvent surgir après l’accouchement, c’est pourquoi elle s’avère nécessaire. Pour cela, la mère continue à fréquenter la PMI pour les pesées de l’enfant, les vaccinations, les conseils pour l’alimentation et aussi pour les cas de maladies. Le tableau n°7 nous indique l’évolution des consultations post-natales.
Tableau n°7 : Les consultations post-natales
Source : Situation économique, sociale et financière de la République 1964-1970
Le tableau regroupe l’ensemble des consultations post-natales. Il nous renseigne sur les consultantes et les consultations réalisées. L’absence de l’évolution linéaire de ces données constitue un handicap pour notre analyse du phénomène.
Les valeurs générales du tableau se présentent d’une façon très contrastée, c’est une évolution en dents de scie à tendance régressive.
Par rapport aux consultations prénatales, l’impression qui se dégage est la négligence de la part des parturientes qui ne se présentent plus régulièrement ou dut tout à la Protection Maternelle et Infantile P.M.I.
La protection maternelle infantile est un problème crucial dans la santé de la population au Gabon. C’est pourquoi, la population rurale, la plus nombreuse doit bénéficier d’une protection équivalente à celle des villes ; grâce à une répartition des effectifs et des équipements de la médecine suivant un équilibre régional systématiquement recherché. Cette protection est largement développée et « les femmes accouchant dans les maternités reçoivent des encouragements » (Petit atlas du Gabon, 1958, p.10). Ce qui incite ces dernières à faire confiance à la santé publique.
La protection maternelle infantile se développe au sein des centres de santé.
Les centres de protection maternelle voient leur réseau s’étendre progressivement. Avant l’indépendance, le Gabon compte neuf centres de P.M.I. » (J.O.A.E.F., note de présentation du Ministre de la santé publique du 28 janvier 1959).Le Ministère de la Santé Publique a mis au point un programme national de protection maternelle infantile, avec la collaboration de l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S) et du Fond des Nations Unies pour l’Enfance (U.N.I.C.E.F), à partir de l’année 1962 (Direction des établissements sanitaires et de la médecine préventive, service des statistiques sanitaires, Rapport annuel, 1963, chap. V).
La PMI se déroule dans un centre de santé ou au sein de la maternité. Cette dernière est comprise dans une unité sanitaire, le tableau ci-dessous nous donne une idée de l’évolution des maternités qui est l’outil indispensable pour la protection maternelle infantile.
Tableau n°8 Evolution des maternités
Source : Situation économique, sociale et financière de la République gabonaise, 1970
En 1958, le Gabon compte 9 maternités régionales « qui avaient une capacité hospitalière de 150 lits (A. Longo, 2007).
L’évolution de l’infrastructure sanitaire, dès les premières années de l’indépendance, s’avère lente. En effet, en 1960, le réseau sanitaire compte 28 unités de maternités et en 1968, 2 unités s’ajoutent. La croissance moyenne annuelle est de 3, 50% au bout de 2 ans. De 1968 à 1972, nous avons 4 nouvelles unités de maternités qui viennent agrandir le réseau existant. Mais, cette évolution n’est pas significative car le taux d’accroissement moyen annuel est de 3,28%.
A partir du deuxième plan quinquennal ce chiffre tend à la hausse. Cela est révélateur de l’effort consenti dans ce domaine.
Le Ministère de la Santé œuvre pour l’amélioration des conditions sanitaires des populations. Ainsi, après avoir constaté une évolution pas très accentuée, durant le premier plan quinquennal, c’est-à-dire de 1966 à 1970 avec 2, 65% du nombre de lits, dès 1971, il s’accroit de 9, 14%. Deux faits marquants sont à relever dans ce tableau.
Le premier a trait à l’évolution du nombre de lits. Il ne suit pas tout à fait l’évolution des unités. Ainsi, pour le même nombre d’unités, le nombre de lits progresse au fil des ans. En effet, à défaut de la construction de nouvelles unités, les autorités décident de l’augmentation du nombre de lits.
Le deuxième fait est relatif à la question des statistiques. L’absence des données chiffrées continues nous empêche d’avoir une évolution linéaire. Aussi après 1972, notre connaissance des maternités devient difficile. Mais, cela n’est pas synonyme du manque de progrès dans le domaine. Toutefois, en dehors des 34 unités de maternités indépendantes ou rattachées aux centres médicaux, le Ministère de la Santé dispose de 6 centres de santé (P.M.I. et dispensaires) répandus sur le territoire. Direction des établissements sanitaires et de la médecine préventive, service des statiques sanitaires. Rapport annuel 1984, service des statistiques sanitaires. Le seul problème avec les centres de santé est le manque de lits d’hospitalisation sinon toutes les consultations se déroulent sans changement dans ces structures.
« Mais l’efficience de l’effort accompli est compromise en partie par certaines insuffisances que l’on constate. L’examen de la répartition des infrastructures révèle un déséquilibre entre les différentes zones du pays, sans que cela soit à tous points de vue à l’avantage des grandes métropoles » (El Hadj Omar Bongo, 1984, p.151). Les 6 centres de santé dont dispose le Ministère sont concentrés dans la seule ville de Libreville.
En dehors de l’Estuaire qui abrite le plus grand nombre d’unités de santé, le Moyen-Ogooué avec l’hôpital Schweitzer de Lambaréné, le Haut-Ogooué a vu son action se renforcer grâce à l’action de la COMUF et de la COMILOG, l’Ogooué-Maritime bénéficie du monopole de l’extraction pétrolière. La répartition des infrastructures sanitaires obéit plutôt aux intérêts politico-économiques qu’à ceux du social. Lorsque ces infrastructures existent d’autres difficultés apparaissent. Ces établissements « ne fonctionnent pas à plein régime en raison d’importants goulots d’étranglements qu’il est souhaitable de voir disparaître peu à peu : difficultés d’approvisionnements ; insuffisance de personnel qualifié etc. », Rapport annuel 1983 p.4..
Les malades graves des centres de santé de 2ème et 3ème zone sont acheminées vers les centres les mieux équipés ou vers Libreville.
Pour avoir une idée globale de la politique menée en matière de protection maternelle infantile, il serait indispensable d’étudier les actions pour l’amélioration de la santé des enfants.
2.2. La protection de l’enfant
La protection des enfants commence depuis la grossesse jusqu’à l’âge de cinq (5).
2.2.1. Pendant la colonisation
Les rapports des archives montrent que beaucoup d’enfants disparaissaient dans le milieu gabonais au cours des premières années et que le taux de mortalité infantile était très élevé.
En effet, dans la région du Woleu - Ntem, un des îlots du peuplement de la colonie du Gabon en 1943, on enregistre une population totale de 71 630, on enregistre une natalité de 1 142 soit un taux de natalité de 15, 9% et une mortalité de 1 590 soit 22,1% soit un excédent de mortalité de 448. C’est pour régresser cette mortalité ou è défaut, au moins égaliser le taux de cette mortalité à celui de la natalité que l’administration coloniale va mettre l’accent sur le rôle dévolu à la protection de l’enfant en luttant contre certaines grandes endémies.
La consultation des archives, cernée dans les correspondances, les rapports sanitaires des médecins des troupes coloniales, nous a permis de constater que de toutes les maladies auxquelles les enfants gabonais sont exposés, les plus redoutables sont la trypanosomiase et le paludisme qui constituaient une cause importante de la mortalité infantile ou infanto juvénile.
La trypanosomiase ou la maladie du sommeil : quelques enquêtes conduites par Aubert en A.E.F., ont montré l’impossibilité pour les femmes trypanosomées de mener leur grossesse à terme (A. Sicé, 1931, pp 5-24). Et, dans la plupart des cas, les enfants naissaient mort-nés ou mouraient quelques jours plus tard. La maladie avec une intensité croissante menaçait de faire tâche d’huile. Mais depuis 1917 la campagne méthodique entreprise contre la trypanosomiase par le médecin inspecteur Huot se poursuivit avec beaucoup de ténacité pendant toute la période.
Le paludisme ou malaria : Au Gabon, y compris à Libreville, l’endémie avait gardé une grande importance. Ce sont souvent les accès intermittents au P. vivax qui causaient le plus de dégâts et de décès, surtout parmi la population métisse.
Pour l’année 1943, la morbidité palustre fut de 5, 17% de la morbidité totale indigène du territoire. Outre les 11626 malades, 2669 étaient des enfants de 0 à 5 ans soit 22% (Archives Nationales du Gabon, 1943).
Dans certains départements, des index hématologiques avaient été pratiqués.
Le tableau suivant indique les index hématologiques par âge dans le département de l’Ogooué-Maritime en 1943.
Tableau n°9 : Index hématologiques par âge dans la province de l’Ogooué-Maritime en 1943
Source : Archives Nationales du Gabon (ANG), Fonds de la Présidence de la République, rapport annuel de 1943
Sur les 45 enfants de 4 à 5 ans examinés dans l’Ogooué-Maritime, 13, 3% étaient classés dans le groupe de « rate 1 » c’est-à-dire faiblement impaludés. Mais ce sont les enfants de 2 à 3 ans qui payèrent un lourd tribut au paludisme (Archives Nationales du Gabon, 1943). Les accès pernicieux, les fièvres bileuses hémoglobinuriques ayant une issue mortelle restaient plus fréquentes.
Pendant la colonisation, il était quasi-impossible de faire disparaître le paludisme du territoire du Gabon, mais il, était nécessaire de tout faire pour éviter les accès pernicieux graves, très souvent mortels chez les enfants en bas-âge et qui constituaient une cause importante de la mortalité. Dans ce cas, l’effort chimioprohylaxique anti-malarique s’était porté particulièrement sur la population enfantine de 0 à 10 ans avec la distribution de la nivaquine dans les postes fixes ( maternités, dispensaires) par les infirmiers itinérants des circuits de traitement.
Pour restreindre les causes de ces maladies chez les enfants, les autorités coloniales mirent en place un service de santé dans les milieux scolaires. Un livret médical scolaire de type uniforme avait été adopté et ce livret était destiné à suivre à suivre l’enfant dans toute sa scolarité. Il ne fut appliqué au Gabon qu’à la rentrée 1952-1953. L’inspection médicale scolaire avait pour but d’assurer : la visite médicale des élèves, le dépistage et le traitement des maladies endémo-épidémiques ou chroniques et l’enseignement pratique de l’hygiène individuelle et collective.
Les maladies transmissibles comme la variole, la rougeole… méritent aussi de retenir notre attention. En effet, en 1942, une épidémie de rougeole avait frappé le village d’Ilala situé à 17km de Ndendé (région sanitaire de la Ngounié) sur la route Mouila-Ndendé. Cette épidémie avait entraîné la mort de 14 personnes dont 6 enfants de 0 à 2 ans, 5 de 2à 5ans, 1 de 6 ans et 1 adulte (Archive Nationale du Gabon). Cette maladie était accompagnée d’une forte fièvre, d’une toux souvent importante et avait rapidement entraîné la mort.
2.2.2. Des indépendances aux années 1970
Dès les indépendances, l’enfant continue à mériter l’attention des autorités gouvernementales. L’accent va être mis sur la santé de celui-ci. Les autorités vont décider de « fructifier le capital humain » qui doit servir de base au développement du Gabon.
Au Gabon, « la mortalité dans la première enfance est située entre 15% et 35% jusqu’à 4 ans selon une estimation faite en 1964 en milieu hospitalier » (A. Mba Assoumou, 1981, p. 82).
Pendant la période post-coloniale, l’enfant reste toujours exposé aux différents fléaux de la nature. Les affections à l’origine de la mortalité infantile sont répertoriés dans le tableau suivant.
Tableau n°10: Les causes de décès chez les enfants de 0 à 4 ans
Source : Plan de développement économique 1966-1970, P 378
Dans ce tableau, la fréquence en pourcentage des maladies évolue dans l’ordre décroissant. Nous avons, en premier lieu les maladies les plus répandues : « le paludisme demeure l’affection la plus répandue et crée avec les poly parasitoses et la dénutrition, un complexe de moindre résistance de la population, complexe qui se manifeste dès le premier âge par sa responsabilité directe ou indirecte dans une mortalité infantile importante » (Plan de développement économique 1966-1970, p. 73), les maladies parasitaires constituent une menace sérieuse pour la jeune enfance : « la statistique générale signale une proportion de 18% de poly parasitoses, dont 8% d’ankylostomiase sur la totalité des consultants. Les renseignements d’ordre hospitalier recueillis à l’hôpital de Libreville indiquent chez l’enfant de 0 à 4ans :
-
Une proportion de 6,5% de poly parasité
-
4,5% atteints d’ankylostomiase
-
3,9% atteints d’amibiase »[1]. Tous les renseignements concordent pour donner aux poly parasitoses une place prioritaire dans la pathologie gabonaise.
La maladie qui fait plus de ravage est la gastro-entérite avec 24, 50% de fréquence et 4,5% de décès ; les diarrhées qu’elles occasionnent affaiblissent rapidement l’enfant et entraînent la mort.
Pour ce qui est du paludisme qui occupe la deuxième place avec 15% de fréquence et 7,28% de fréquence de décès, cette affection semble être plus grave au Gabon. « En fait, on a pu dire que tout gabonais a été, est ou sera impaludé ». Toutes les conditions géographiques, parasitaires et humaines facilitent sa propagation. Toutes les enquêtes, faites sur le paludisme au Gabon mettent en évidence l’hyper-endémicité dans sa forme la plus grave, le plasmodium falciparum à travers tout le territoire gabonais, et la permanence de l’infestation de la population » (Premier plan quinquennal, 1966, p. 374). Le tableau ci-dessus ne représente que les chiffres recueillis à Libreville pour les années 1963-1964. Etant donné l’importance de la maladie, les efforts doivent être doublés pour et mis en œuvre pour combattre cette maladie. L’accent doit être mis sur l’éducation, les mesures anti larvaires, la distribution d’antipalustres et surtout l’extension des mesures d’hygiène.
En ce qui concerne, les maladies à cycle épidémique, coqueluche, variole… Seule la rougeole à des conséquences mortelles. Sa fréquence et de 11% avec une fréquence de décès de 7, 70% et 11% sur le total des décès.
Les affections respiratoires ont une fréquence de 9,8% et 3,5% de décès et représente 4,5% par rapport au total des décès.
L’enfant est en fait, très dépendant du milieu qui l’entoure, aussi, c’est par les actions d’assainissement, par l’extension des vaccinations et de la chimio prophylaxie palustre… que l’on peut améliorer notamment l’état sanitaire de l’enfant.
Malgré la mortalité infantile importante, l’un des volets crucial de la protection de l’enfant est la prévention.
Elle reste jusque-là, le moyen le plus efficace pour garder les enfants en bonne santé. Et, la vaccination est l’un des moyens préventifs.
Les progrès faits dans le sanitaire sont importants : le nombre des maladies que l’on peut éviter augmente et les associations de vaccins de plus en plus efficaces viennent faciliter l’application. Les vaccins suivants sont inscrits dans tous les calendriers proposés : B.C.G, vaccinations contre la variole, la poliomyélite, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole et le vaccin contre la fièvre jaune. Ces vaccinations doivent être faites dès les premières années de la vie, faire les rappels nécessaires les années suivantes.
En 1966, le docteur Quenum, directeur de l’O.M.S. Afrique, en visite au Gabon a pu répertorier quelques chiffres durant le premier semestre de l’année en suivant les prévisions du plan de développement quinquennal :
-
7000 vaccinations contre la poliomyélite ont été exécutées,
-
7100 vaccinations contre le B.C.G. en prévision de la tuberculose.
Les vaccinations de masse effectuées par le service des grandes endémies touchent un grand nombre de la population et viennent compléter celles de la P.M.I.
La protection de l’enfant peut avoir lieu dans les quartiers à travers les équipes de vaccinations dites aussi groupes mobiles des assistantes sociales qui sillonnent les coins reculés en vue de recenser les mères et les enfants et surtout les sensibiliser mais c’est à la P.M.I. que le gros du travail se fait. Qu’il s’agisse de la protection néo-natale ou celle de la jeune enfance, la P.M.I., se charge de tout contrôler.
Il n’est guère facile de rendre objectivement compte de l’évolution de la Protection Maternelle infantile à cause de la fragilité des données officielles et des chiffres au cours de la période.
Dans les actions menées en faveur de la PMI, certaines mesures ont eu des répercussions évidentes : l’amélioration du système de santé, les opérations d’aménagement rural…
Le discours était souvent nataliste ainsi que certaines dispositions législatives : allocations familiales, maintien de la loi 64/69 interdisant l’avortement.
Le Gabon depuis la colonisation avait dégagé l’ambition de mettre en œuvre des politiques susceptibles de favoriser la natalité et de réduire la mortalité infantile.
Pays sous-peuplé, il cherchait des bras nécessaires pour amorcer son développement. Les moyens structurels en matière de santé et sociaux ont été déployés.
Aussi, dans le cadre du programme de la santé pour tous, initié par l’OMS, le gouvernement gabonais en adoption à ce programme, avait l’ambitieux projet prioritaire de protéger la santé de la mère et de l’enfant en vue de réduire les taux élevés de morbidité et de mortalité maternelles, périnatales, et infantiles sur l’étendue du territoire national.
Cette volonté va être renforcée par le constat fait lors du séminaire d’Oyem sur la population et le développement en novembre 1990, qui démontre que le Gabon et les villes de Libreville et de Port-Gentil en particulier présentaient des taux élevés de morbidité et de mortalité infantiles.
Depuis la période coloniale, le Gabon a initié des actions en faveur de la protection maternelle infantile mais sa population n’a pas vraiment augmentée malgré des progrès réalisés dans le domaine de la santé. Toutefois, un net recul du taux de mortalité infantile est observé grâce à l’apport des moyens préventifs et curatifs.
Dans le cadre de cet article, nous estimons que les pouvoirs publics doivent revisiter leur politique en matière de protection maternelle et infantile. Cette relecture permettrait dans un premier temps, l’octroi des moyens structurels, matériels et financiers importants.
Alors le gouvernement gabonais devrait adopter des lois qui prennent en compte les réalités des personnes dans le besoin et la détresse afin qu’elles trouvent satisfaction dans la politique sociale. Aussi bien, que les femmes fassent désormais partie en nombre croissant de la main d’œuvre rémunérée, elles affrontent de nombreuses formes de discriminations.
Les problèmes de santé en matière de procréation sont la cause majeure de décès et d’invalidité des femmes dans le monde entier. C’est dans cette optique que nous pensons que l’Etat gabonais doit améliorer la santé en matière de procréation. Il est vrai que l’on note des efforts considérables mais qui demeurent parcellaires et ne touchent pas l’ensemble des couches sociales.
Pour ce faire, il faut assurer à tous l’accès aux services de santé en matière de procréation. Ce serait un engagement et un impératif aux droits humains car, les femmes et les filles qui n’ont qu’un accès limité aux services de santé, doublé de leur pauvreté, sont plus vulnérables et ne peuvent pas affronter les conséquences qu’entraîne une mauvaise santé en matière de procréation : le coût des soins de santé ; la perte des contributions d’une femme à la survie de sa famille et l’impact du sida peuvent précipiter les familles pauvres dans le dénuement.
Alors les programmes mis en œuvre ne doivent pas être coercitifs ni discriminatoires mais incitatifs.
Conclusion
Conclusion
En suivant l’évolution de la protection maternelle et infantile au Gabon pendant la période coloniale et post- coloniale, nous retenons que la protection de la mère et de l’enfant occupe une place importante dans les orientations des politiques de santé. Néanmoins, il existe un décalage sur le terrain. Pendant la colonisation, ces populations cibles ont été prises en charge assez tardivement dans le cadre des enjeux économiques de la colonisation. Il a fallu attendre 1945 pour qu’on ait la première sage-femme affectée dans le territoire du Gabon. Les maternités sont ouvertes, mais il existe des insuffisances matérielles et en personnels qualifiés. Les femmes autochtones ont des préjugés sur la médecine occidentale. Celles qui y allaient étaient attirées par les présents qu’elles recevaient. Pendant la période post- coloniale, on note un renforcement de la politique maternelle à travers la multiplication des maternités, la formation du personnel africain.
En ce qui concerne la protection de l’enfant, les autorités coloniales ont mis en œuvre des tournées médicales sur l’ensemble du pays pour lutter contre la malaria et la trypanosomiase à l’origine de la forte mortalité infantile. L’évolution des recherches sur les maladies tropicales et la continuité dans les politiques de santé mises en œuvre depuis les indépendances ont permis d’améliorer la santé des jeunes enfants.
En revanche, malgré l’importance accordée au couple mère-enfant, le taux de mortalité maternelle et infantile reste toujours préoccupant pendant notre période d’étude. Malgré ces efforts, le tryptique gynécologue-pédiatre-sage-femme, demeure faible, car la faculté de médecine de Libreville ne forme que des généralistes et des sages-femmes. Les autres spécialités se font à l’étranger. Ce n’est qu’en 2016 que le Gabon s’est doté d’un Centre Hospitalier Universitaire (CHU Jeanne Ebori) spécialisé dans la santé de la mère et de l’enfant, avec une capacité d’accueil de deux cents (200) lits et d’un plateau technique à la pointe de la technologie.
Les problèmes de santé en matière de procréation sont la cause majeure de décès et d’invalidité des femmes dans le monde entier. C’est dans cette optique que nous pensons que l’Etat gabonais doit améliorer la santé en matière de procréation. Il est vrai que l’on note des efforts considérables mais qui demeurent parcellaires et ne touchent pas l’ensemble des couches sociales.
Pour ce faire, il faut assurer à tous, l’accès aux services de santé en matière de procréation. Ce serait un engagement et un impératif aux droits humains car, les femmes et les filles qui n’ont qu’un accès limité aux services de santé, doublé de leur pauvreté, sont plus vulnérables et ne peuvent pas affronter les conséquences qu’entraîne une mauvaise santé en matière de procréation. Le coût des soins de santé, la perte des contributions d’une femme à la survie de sa famille peuvent précipiter les familles pauvres dans le dénuement.
Alors, les programmes mis en œuvre ne doivent pas être coercitifs ni discriminatoires mais incitatifs. Il est peut-être temps que les pouvoirs publics prennent en compte les savoirs endogènes médicaux et les améliorent, pour suppléer la médecine moderne.
Au terme de cette étude, nous pensons que les pouvoirs publics doivent revisiter leur politique en matière de protection maternelle et infantile. Cette relecture permettrait dans un premier temps, l’octroi des moyens structurels, matériels et financiers plus importants.
Références
Références bibliographiques
ArRCHIVES NATIONALES DE BRAZAVILLE, ST, 1950-1955.
ARCHIVES NaATIONALES du GABON, Premier plan quinquennal de développement économique 1960-1970, p.73.
ASSEGONE MINKO Rose, 1984, La protection sanitaire : problème de la mère et de l’enfant en zone rurale, cas de Mitzic au Gabon, Mémoire d’histoire, Université Omar Bongo, Libreville.
BARBIERI Magalie, 1991, Politique de santé et population, Politique Africaine, numéro 31, pp. 51-65.
BARRET Gérard, 1981, La santé au Gabon : équipements, problèmes et perspectives, Revue Gabonaise d’Etudes politique, économique et juridique, numéro 13, pp. 25-30.
BEAUDIMENT Raymond, 1938, La protection de la maternité et de l’enfance dans les colonies françaises en 1938, Annuaire Médicale et de Pharmacie Coloniale, Paris pp 36-50.
BRAUDEL Fernand, 1969, Ecrits sur l’histoire, Tome 1, Paris, Flammarion.
CHOVET Annabelle, 1990, La protection maternelle et infantile en AEF, de 1910 à 1956, Mémoire d’histoire, Aix en Provence.
Direction des établissements sanitaires et de la médecine préventive, service des statistiques sanitaires, 1963, rapport annuel, chapitre V, Ministère de la Santé, Libreville, pp 20-35.
DURAND REVILLE Luc Maurice, 1958, « Les problèmes sanitaires et l’action du service de santé au Gabon » Académie des Sciences d’Outre-mer pp. 58-64.
LONGO Armande, 2007, La politique sanitaire de la France au Gabon de 1925 à 1958, Thèse de Doctorat, Université Charles De Gaulle, Lille (France).
MBA ASSOUMOU André, 1981, Approche des principaux problèmes de santé du Gabon.
Petit atlas du Gabon, 1958, Paris, Lafont.
OMAR BONGO El. Hadj, 1984, Le Gabon un homme, un pays, Dakar, Nouvelles éditions africaines.
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS), 2008, Stratégies de coopération de l’OMS avec les pays Gabon (2008-2013), OMS, Bureau Régional de l’Afrique, p. 9.
RAPPORT ANNUEL, 1984, service des statistiques sanitaires, Direction Générale des Statistique et des Etudes Economiques.
SARRAUT Albert, 1923, La mise en valeur des colonies françaises, Paris, Payot.
SICE Adolphe, 1931, « L’Institut Pasteur de Brazzaville et la trypanosomiase humaine » Bulletin de la Société de Pathologie Exotique, numéro 24, pp. 5-24.
VERRIERE Jacques, 1978, Les politiques de population, Paris, PUF.
Downloads
Publié
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
Copyright (c) 2023 LONGO Armande