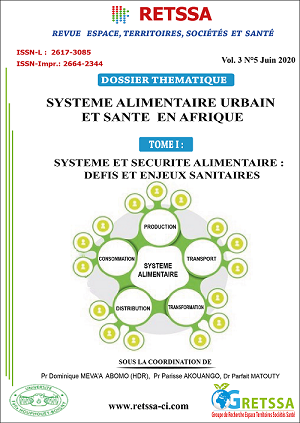2 |Santé maternelle, néonatale et infantile dans un contexte de gratuité des soins: état des lieux et enjeux sanitaires dans les districts sanitaires de Baskuy et Bogodogo (Ouagadougou)
Maternal, newborn and child health in a context of free healthcare: state of play and health issues in the health districts of Baskuy and Bogodogo (Ouagadougou)
Mots-clés:
Ouagadougou| santé maternelle| traite des enfants| néonatale| gratuité des soins| enjeux sanitaires|Résumé
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en dépit d’importants progrès accomplis pour améliorer la santé de la population, la mortalité maternelle et néonatale reste élevée en Afrique sub-saharienne. Le profil sanitaire du Burkina Faso reste préoccupant pour la mère et l’enfant : le ratio de mortalité maternelle en 2015 est de 371 pour 100.000 naissances vivantes et 88,6‰ pour la mortalité infantile. Face à cette situation, une politique de gratuité des soins maternels et infantiles a été adoptée par les autorités burkinabè et mise en œuvre depuis le 02 Avril 2016. Dans un contexte sanitaire peu reluisant, des interrogations interpellent. Quels sont l’état des lieux et les enjeux sanitaires de la mise en œuvre de la gratuité des soins dans les districts sanitaires de Baskuy et Bogodogo ? L’objectif de ce travail est d’analyser l’apport de la mise en œuvre de la gratuité des soins sur la santé maternelle, néonatale et infantile. La méthodologie porte sur un traitement de données socio-démographiques et sanitaires issues de revue de la littérature et de collecte d’informations primaires, dont les analyses ont été soutenues par une cartographie thématique. Les résultats montrent une amélioration de la santé maternelle, néonatale et infantile, mais accompagnée de nombreuses difficultés, parmi lesquels la démotivation du personnel soignant et le manque de matériels/équipements. De plus, cette politique est budgétivore. Il est à craindre que l’Etat ne soit essoufflé, entrainant du coup le revers de la médaille pour cette population vulnérable qui s’était affranchie des décisions concernant la santé.
Introduction
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dans sa Constitution de 1946, définit la santé comme « un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas en une absence de maladie ou d’infirmité ». La santé est une composante du développement durable. La littérature scientifique et institutionnelle aborde le lien entre l'amélioration de la santé et le développement. En effet, les relations entre le statut socio-économique, les conditions de vie et l'état de santé ont fait l’objet de plusieurs travaux et montrent que la précarité s'accompagne d'un risque accru de morbidité (L. Touré et al., 2012, p.1. ; C.W. Ruktanonchai & al., 2016, p. 2 ; A. Toure-Ecra et al., 2016, p. 2 ; L. Carvajal–Aguirre et al., 2017, p. 2).
Parmi les nombreux facteurs qui entravent le développement socioéconomique des pays de l’Afrique subsaharienne, les problèmes sanitaires sont devenus au cours de ces deux dernières décennies des plus préoccupants (Y. Kohoun 2009). Malgré une amélioration des indicateurs, liée à la réduction de la mortalité maternelle néonatale et infantile (OMS 2014, p.12 ; Andriantsimietry, S et al., 2015, p. 2), la plupart surviennent en Afrique Subsaharienne du fait de soins inadéquats. Dans les pays à ressources limités, les indicateurs de santé maternelle et infantile sont également concernés par la précarité (A. Toure-Ecra et al., 2016, p. 2). Le développement de l'Afrique dépend en partie de la capacité des pays à améliorer la santé de leurs mères et de leurs enfants, car étant des populations vulnérables, du fait de leur faible voire inexistant pouvoir d’achat et de prise de décision. Aussi le souci de développement des gouvernants africains, est-il d’assurer le bien-être des populations surtout sur le plan sanitaire. Ce souci est repris dans l’ODD 3 à travers une approche globale de santé « donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être à tous les âges ». Depuis une quinzaine d’année, la détérioration des économies ainsi que l’incapacité de nombreux gouvernements à assumer seuls le poids financier du système de santé, soulèvent des interrogations et entravent l’accès aux soins des populations les plus vulnérables. C’est le cas des pays en développement avec des économies tributaires de l’aide extérieure.
Pourtant, des progrès importants ont été accomplis en Afrique subsaharienne dans la même période pour améliorer la santé et le bien-être de la population (WHO, 2016). La mortalité maternelle et néonatale y reste élevée (OMS, 2015 ; GD, 2016). En dépit de l’importance et de la joie que revêtent la grossesse et l'accouchement pour les femmes et leurs familles, ces évènements représentent une période de vulnérabilité accrue pour les femmes et leurs enfants à naître (Okedo-Alex, 2019). Le décès maternel sur la vie entière touche une femme sur 36 en Afrique subsaharienne ; la mortalité touche un enfant sur huit dans les dix pays les moins classés. Dans 24 pays – plus fragiles et/ou touchés par un conflit – la mortalité maternelle est toujours classée comme élevée. Malheureusement, ces statistiques sont si familières qu’elles n’émeuvent pas toujours comme elles le devraient (OMS 2017, p.12)
Les Nations Unies estiment que chaque année, la quasi-totalité des décès maternels survenus dans le monde se comptabilisent dans les pays en développement, et majoritairement en Afrique Sub-Saharienne (ASS). En 2015, environ 99% des décès maternels survenus en raison de complications pendant la grossesse ou à l'accouchement, dont 66 % ont été enregistrés dans les pays de l’ASS (OMS, UNICEF, 2018). Pour l’année 2017, l’ASS rapportait 196 000 décès maternels et un taux de mortalité maternelle (TMM) global de 542 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes, soit une mortalité maternelle 50 fois plus élevée qu’en Europe et en Amérique du Nord, avec respectivement 10 et 18 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes dans ces deux régions (OMS, UNICEF, 2018). Dans les pays en développement, comme ceux de l’ASS, les femmes ont un nombre de grossesses plus élevé que dans les pays développés ; le risque de mourir du fait d’une grossesse au cours de leur vie est pour elles bien supérieur. Le risque de décès maternel sur la durée de la vie, c’est à dire la probabilité qu’une jeune femme décédera un jour d’une cause liée à la grossesse ou à l’accouchement est de 1 sur 4 900 dans les pays développés, contre 1 sur 180 dans les pays en développement (BASSABI, 2020, p.10).
Le Burkina Faso, pays aux ressources limitées, est caractérisé par une situation de pauvreté marquée par un faible accès aux services sociaux de base et par l’inexistence d’une couverture sanitaire universelle (Ministère de la santé, 2017, p.15). Malgré cette situation de précarité, le pays connait une amélioration de l’espérance de vie à la naissance qui est passée de 48,5 ans en 1985 à 56,7 ans en 2006 (RGPH, 2006). Avec une population projetée du RGPH 2006 à 20 millions d’habitants, le Burkina Faso a un taux de mortalité de 11,8 pour 1000 en 2018 avec des disparités entre les régions administratives et sanitaires contre 12 pour mille en 2006 (RGPH, 2006 ; MS, 2019). Malgré l’attention particulière portée sur la santé maternelle et infantile par les responsables sanitaires et politiques, nombreuses sont les femmes qui continuent à accoucher à domicile sans assistance de personnels qualifiés avec tout ce que cela peut comporter comme risque (Kohoun Y. 2009).
Le profil sanitaire du Burkina Faso reste une préoccupation, notamment celui de la mère et de l’enfant. Il fait partie des pays où l’on enregistre des taux de mortalité toujours élevés (11,8% EDS 2010). La mortalité des enfants de moins de cinq ans est 88,6 pour 1.000 (OMS 2015). Le rapport de mortalité maternelle estime à 341 pour 100 000 naissances vivantes en 2010 connait une relative baisse avec 33012 décès pour 100 000 naissances vivantes enregistré en 2015 (Ministère de la santé et OMS, 2017, p.16). Les femmes et les enfants constituent les couches de la population les plus vulnérables.
Face à cette situation, une politique de gratuité des soins maternels et infantiles a été adoptée par les autorités burkinabè et mise en œuvre depuis le 02 Avril 2016. Une phase pilote a été initiée dans trois régions sanitaires, le Centre, comportant Ouagadougou, la capitale, les Hauts-Bassins et le Sahel.
La gratuité des soins a été décidée et consignée dans le Journal officiel par un décret conjoint de la Présidence de la république du Faso, du Premier Ministère et des ministères techniques concernés par la santé en 2016. Le décret précise les modalités de la gratuité des soins au profit des enfants de moins de 5 ans (0 à 59 mois) et des femmes enceintes ; ainsi que le dépistage et la prise en charge des cancers du col de l’utérus et du sein (JO, 2016, p.1-2)
Les pathologies ciblées sont celles qui constituent les principales causes de décès en 2015 dans les formations sanitaires, à savoir le paludisme, les infections des nouveau-nés, la malnutrition (Ministère de la santé/OMS, 2017, p.17-18). Toutes les pathologies que présentent les cibles sont traitées gratuitement. Ces pathologies sont d’ordre infectieux, parasitaires et viraux (infections respiratoires aiguës, diarrhée persistante, paludisme simple et grave, la fièvre d’origine bactérienne, l’infection aigue et chronique de l’oreille, la malnutrition aigüe et sévère sans complication, etc.), sans oublier celles relevant des chirurgies (petite chirurgie et chirurgie d’urgence). La prise en charge concerne les accouchements par voie basse et les césariennes, les soins pendant la grossesse (soins préventifs et soins curatifs, le dépistage des lésions pré cancéreuses du col de l’utérus et le dépistage clinique des lésions du sein chez la femme.
La mise en œuvre de la mesure de gratuité des soins dans un contexte sanitaire peu reluisant suscite des interrogations. Quel est l’état des lieux de la mise en œuvre de la gratuité des soins dans la région sanitaire du Centre, précisément dans les deux districts sanitaires, de Baskuy et de Bogodogo distincts respectivement par leur superficie, la taille de leur population et leur position géographique au sein de la région sanitaire du Centre. Baskuy est située en zone urbaine tandis que Bogodogo est un district périurbain. Quelles sont les enjeux sanitaires de la mise en œuvre de la gratuité des soins en faveur des enfants de moins de cinq ans et des mères.
Nous formulons l’hypothèse selon laquelle la mise en œuvre de la gratuité des soins en faveur des enfants de moins de cinq ans et des mères, en dépit de difficultés diverses, constitue une avancée dans la réduction de la mortalité maternelle et infantile dans les districts sanitaires de Baskuy et de Bogodogo. L’objectif de ce travail est d’analyser l’apport de la mise en œuvre de la gratuité des soins sur la santé des enfants de moins de cinq ans et des mères en vue d’une meilleure application de la mesure.
Cet article s’articulera autour des points suivants : après la présentation de la méthodologie, nous présenterons les résultats qui feront après l’objet de discussion.
Méthodologie
1. Matériels et méthodes
1.1. Présentation de la zone d’étude
Le site d’étude est la ville de Ouagadougou. La raison fondamentale de ce choix est le fait que Ouagadougou, capitale de la région du centre fait partie des trois régions pilotes qui ont bénéficié de la mise en œuvre de la gratuité des soins des enfants de moins de cinq ans et des mères. La ville de Ouagadougou est située au cœur de la province du Kadiogo, elle-même située au Centre du Burkina Faso. Elle couvre une superficie de 518 km² et compte douze (12) arrondissements et cinquante-cinq (55) secteurs (Carte n°1). Le site est limité au Nord par les communes rurales de Pabré et de Loumbila, à l’Est par celle de Saaba, au Sud par celle de Koubri et Komsilga et enfin à l’Ouest par la commune rurale de Tanghin Dassouri.
Carte n°1: Structuration administrative de la ville de Ouagadougou
La région du centre (une des 13 régions administratives du Burkina Faso) compte cinq districts sanitaires couvrant les six communes rurales et la commune urbaine de Ouagadougou (Ministère de la santé, 2012). Les 5 districts sanitaires sont Boulmiougou, Nongre-Massom, Sig-Noghin, Baskuy et Bogodogo. La présente étude concerne les deux derniers districts qui présentent des situations opposées à plusieurs niveaux (Carte n°2).
Carte n° 2: Présentation de la zone d’étude
Le district sanitaire de Baskuy couvre une superficie de 33 km² avec une population estimée à 311 208 habitants en 2017 et 323 646 habitants en 2018 (Ministère de la santé, 2018, p. 8 ; 2019, p. 12). Il est composé de l’arrondissement administratif de Baskuy. Celui de Bogodogo couvre une superficie de 1.192 km² (Ministère de la santé, 2012, p. 23) et compte une population estimée à 828 114 habitants en 2017 et 861 209 habitants en 2018 (Ministère de la santé, 2018, p.8 ; 2019, p. 12). Y compris l’arrondissement périurbain de Bogodogo, le district est composé des formations sanitaires des communes rurales de Koubri, de Saaba.
1.2. Organisation du système national de santé
Le système de santé au Burkina se structure autour de deux formes : une organisation administrative et une organisation de l’offre de soins. La présentation du système sanitaire est déclinée dans le plan national sanitaire 2011 dont la mise à jour se fait régulièrement à travers les annuaires statistiques de santé.
La structuration administrative comprend les directions régionales de santé (DRS) couvrant les mêmes aires que les régions administratives. Il existe ainsi 13 DRS, découpées en entités opérationnelles que sont les districts sanitaires (DS). Depuis 2016, le système de santé est composé de 70 districts sanitaires. L’organisation de l’offre de soins concerne les structures publiques et privées de soins, hiérarchisées en trois niveaux pour dispenser aux populations, des soins primaires, secondaires et tertiaires (Figure n°1).
Figure n°1 : Organisation du système sanitaire au Burkina Faso
Source : Ministère de la santé, 2004
Le premier niveau correspond au district sanitaire qui comprend deux échelons : (i) le premier échelon de soins est le Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) au nombre de 1760 en 2016, 1839 en 2017 et 1896 en 2018 ; (ii) le Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA), centre de référence des CSPS constitue le second échelon. On dénombre 45 CMA depuis 2017. Le Centre hospitalier régional (CHR) est le second niveau de l’offre de soins, tandis que le Centre hospitalier universitaire constitue le troisième niveau, c’est-à-dire le niveau de référence le plus élevé.
Le pays compte également des structures privées de soins, concentrées dans les villes de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso ainsi qu’une offre de médecine traditionnelle. Cette dernière est encadrée par une loi et administrée par une direction technique.
1.3. La méthode de collecte et de traitement des données
Cette recherche combine les approches quantitative et qualitative, et alterne la compilation de données documentaires et d’enquêtes.
1.3.1. La recherché documentaire
Les données secondaires ont été identifiées par une revue de littérature à travers la diversification des sources d’information et des types de documents. Différents ouvrages académiques, institutionnels et des articles scientifiques ont été exploités. Ces données portent sur les aspects liés à la thématique d’étude.
1.3.2. Les enquêtes de terrain
L’annuaire statistique de la santé 2018 (Ministère de la santé 2019, p.41) a recensé huit centres médicaux (CM) et trois CSPS situés à Baskuy, contre quatre CM et 27 CSPS pour le district sanitaire. Les enquêtes ont été menées au sein des centres de santé choisis de façon aléatoire, par tirage au sort, d’une part entre les CM de Baskuy ; d’autre part entre les CSPS de Bogodogo. A Baskuy, il s’agit des formations sanitaires suivantes : Centre médical urbain du secteur 8, (CMU-08), CMU Gounghin. A Bogodogo les formations sanitaires concernées sont : CSPS de Wemtenga, CSPS du 30 « communément appelé Major », Hôpital du district de Bogodogo (Carte n°1). Le choix de l’hôpital du district s’explique par le fait que c’est une formation sanitaire de référence pour les quatre autres.
Ainsi 220 personnes cibles, patients des services de santé, et 25 personnels soignants ont été interrogés. Le tableau n°1 présente la répartition de l’échantillon démographique.
Tableau n°1: Personnes enquêtées dans les districts sanitaires de Baskuy et de Bogodogo
Source : Enquêtes terrain, 2018
Sur l’effectif de la population enquêtée, 55% l’ont été sur l’aire sanitaire du district de Bogodogo et 45% à Baskuy. Dans l’ensemble, les femmes étaient en nombre majoritaire, 194 sur 220 patients soit 88%.
Parmi les personnes enquêtées dans le district sanitaire de Baskuy, 40% ont atteint le niveau secondaire et 26% n’ont pas été scolarisées. Les autres cibles se répartissent entre le niveau supérieur et l’enseignement coranique. Dans le district sanitaire de Bogodogo, 23% ont le niveau secondaire, 22% des personnes sont non scolarisées. Les autres patients se répartissent entre le niveau primaire 28%, le niveau supérieur 25% et 20% des personnes enquêtées ont fréquenté l’école coranique (éducation non formelle).
1.3.3. Techniques et outils de collecte des données
Les techniques et les outils de collectes de données utilisées sont l’entretien direct (avec un questionnaire) auprès des patients des services de santé, l’entretien semi-direct auprès de 25 agents de santé (à l’aide d’un guide d’entretien) pour le personnel de santé et l’observation directe (avec une grille d’observation). Les questionnaires des utilisateurs ont porté sur les profils des utilisateurs, la connaissance de la gratuité, les prestations reçues, par les cibles et leurs appréciations sur ces prestations. Les statistiques sanitaires, la mise en œuvre de la gratuité et les difficultés y relatives, ainsi que des suggestions d’amélioration ont été les points majeurs des échanges avec le personnel de santé.
1.3.4. Traitement et analyse des données
Le traitement s’est fait à travers une catégorisation des données pour vérifier les hypothèses de recherche. Les difficultés et les suggestions ont permis d’étoffer la discussion, en confrontant ce travail avec des recherches antérieures. Le mapping de la zone d’étude résulte des informations des formations sanitaires, intégrées à une base de données géographiques à l’échelle de la ville de Ouagadougou, et gérée sous Système d’information géographique (SIG), à travers QGIS. Des cartes de présentation de la zone d’étude (découpage administratif et sanitaire de Ouagadougou)
Les résultats présentés associent les données primaires issues d’une enquête terrain et des données secondaires provenant de la recherche documentaire. Annuellement mises à jour, les statistiques du Ministère de la santé à travers sa Direction des Etudes et de la Planification, ont permis d’orienter la recherche sur le plan conceptuel et méthodologique. Les informations de base des formations sanitaires sont issues de l’annuaire statistique annuel du Ministère de la santé. Puis les entretiens ont aidé à préciser les informations de chaque entité sanitaire.
Résultats
2. Résultats
2.1. Une offre de soins assez importante dans la zone d’étude
-
Le district sanitaire de Baskuy
Avec 33 km² de superficie et une population de 323 646 habitants, le district sanitaire de Baskuy est le plus petit district de la région. La population se répartit comme suit : 7 244 nourrissons, 26 898 enfants de 0-4 ans, 63 708 de 5-14 ans, 195 120 hommes de plus de 15 ans et 30 676 femmes de 15 ans et plus. En 2018, le district sanitaire comptait 30 formations sanitaires publiques, un centre hospitalier universitaire (CHU), huit centres médicaux (CM), trois centres de santé et de promotion sociale (CSPS), un dispensaire isolé et 17 infirmeries/services de santé des travailleurs). Il existe 48 des formations sanitaires privées (polycliniques, cliniques, centres médicaux, cabinets de soins infirmiers et des cabinets dentaires).
Le Centre Hospitalier Universitaire National Yalgado Ouédraogo (CHUN-YO) est une structure de référence nationale qui dispose d’équipements de base et d’équipements de hauts niveaux tels que les systèmes pour oxygénation et les équipements de désintoxication. Le CHUN-YO compte 713 lits d’hospitalisation ou d’observation.
Le rayon moyen d’action théorique (RMAT) dans le district de Baskuy est de 0,5 km si l’on prend en compte les structures du privé. La totalité de la population se situe à moins de 4km d’une formation sanitaire (Ministère de la Santé, 2019, p.14).
Sur le plan des équipements, le district possède une seule ambulance pour l’évacuation des cas d’urgence des CSPS vers les formations sanitaires de référence. Les différentes formations sanitaires publiques du district de Baskuy ont tous accès à l’eau potable, sont équipées en électricité et disposent chacune d’une ligne téléphonique. On note un lit d’observation pour environ 1500 personnes.
-
Le district sanitaire de Bogodogo
Le district a une superficie de 1192 km² et une population de 861 209 habitants (dont 13% d’enfants de moins de 5 ans). Il compte 49 formations sanitaires publiques : deux CHU, quatre CM, 27 CSPS, un dispensaire isolé, et 15 infirmeries et 105 structures sanitaires privées dont un hôpital. Les CHU sont le CHU Pédiatrique Charles de Gaulle (CHU/CDG) et le CHU de Bogodogo. Le CHUP/CDG offre des prestations telles que les consultations ou traitements pour enfants malades, les consultations des nourrissons sains, la prise en charge des cas de malnutrition (aigue ou sévère), la transfusion sanguine, le traitement du paludisme, la prise en charge des cas de VIH/SIDA, la chirurgie, la traumatologie, l’hospitalisation. Le CHU/CDG dispose de 152 lits d’hospitalisation ou de mise en observation.
En tenant compte de l’ensemble des structures sanitaires, le rayon moyen d’action théorique dans le district sanitaire est 1,9 km. En termes d’accessibilité aux soins, 94% de la population se trouve à moins de 4 km d’une formation sanitaire, 2,7% entre 5 à 9 km et 2,5% à 10 km (Ministère de la Santé, 2019, p.14). En termes d’équipements le district de Bogodogo dispose de lits (un lit pour près de 1700 personnes), et de deux ambulances facilitant les évacuations ou les références vers le troisième niveau de soins.
2.2. Des ressources humaines sanitaires diversifiées mais insuffisantes
Le personnel soignant du district sanitaire de Baskuy se compose de deux médecins spécialistes, neuf médecins généralistes, 37 attachés de santé, 91 infirmiers d’Etat (IDE), 66 sages-femmes/maïeuticiens d’Etat (SFE/ME), 49 infirmiers brevetés (IB). Quant au district sanitaire de Bogodogo, il compte sept médecins spécialistes, 23 médecins généralistes, 45 attachés de santé, 138 IDE, 120 SFE/ME, 97 IB, etc. Dans les deux districts sanitaires, (tableau 2) tous les CSPS remplissent les normes minimales en personnel recommandés (Ministère de la Santé, 2019, p.33)
Tableau n°2 : Ratio personnel de santé par formation sanitaire
Source: Enquêtes terrain, 2018
De ce tableau, il ressort que les deux districts sanitaires de Bogodogo remplissent les normes de l’OMS en termes de ratio IDE+IB/habitants et SFE-ME/habitants. Ces ratios sont respectivement de l’ordre d’un IDE pour 4.659 habitants et un SFE/ME pour 6.587 habitants. Mais le ratio infirmier/habitants est en deçà de la moyenne nationale (1/2419), ce qui montre qu’il y a une amélioration à faire à ce niveau, dans les deux districts. Par contre on note un déficit énorme de médecins dans lesdits DS. En effet, il y a un médecin pour 35891 habitants à Baskuy et un pour 20.650 habitants à Bogodogo alors que l’OMS préconise un médecin pour 10.000 habitants.
Le personnel soignant du CHU/YO et du CHUP/CDG n’est pas pris en compte dans la présente étude car ces centres de soins sont des entités indépendantes, à gestion autonomes. Ils reçoivent les patients référés soit à l’échelle régionale, soit à l’échelle nationale.
2.3. Une mise en œuvre effective de la gratuité des soins de la mère et de l’enfant
Les populations vivant dans les deux districts sanitaires (98% des personnes enquêtées à Baskuy et 98,33% à Bogodogo) confirment la mise en œuvre de la politique de gratuité des soins en faveur des femmes enceintes et des enfants de moins de cinq ans. A Baskuy, 82% des personnes enquêtées ont déjà bénéficié de la gratuité des soins tandis qu’à Bogodogo, ce taux est de 87%. Cette mesure de gratuité des soins a levé les contraintes financières favorisant ainsi l’accès des femmes enceintes et des enfants de moins de cinq ans aux services de santé. C’est ainsi que dans le CSPS du secteur 30 du district sanitaire de Bogodogo, on a enregistré 1198 accouchements (Avril 2016 à Janvier 2017 inclus). Toujours dans le CSPS du 30, au cours de la même période, on a enregistrés 3807 contacts des enfants de 0-5 ans, et 3393 CPN. Dans le district sanitaire de Baskuy, le CM de Gounghin enregistre environ 20 consultations prénatales par jour. Cette gratuité des soins maternels et infantiles dans les districts sanitaires de Baskuy et de Bogodogo contribue à la réduction de la mortalité maternelle, infantile et néonatale. Une SFE du CSPS 30 (DS de Bogodogo) témoigne : « Depuis la mise en œuvre de la gratuité, il n’y a pas eu de cas de décès dans notre centre. C’est une mesure qui soulage beaucoup les populations les plus démunies dont l’accès aux soins était très limité faute de moyens financiers ».
Si la mesure est effective dans la zone d’étude, il faut signaler qu’il existe des insuffisances dans sa mise en œuvre. Une part d’insatisfaction est signalée par les personnes enquêtées (Graphique n°1.)
2.4. Des difficultés dans la mise en œuvre de la gratuité des soins dans les districts sanitaires de Baskuy et de Bogodogo
La gratuité des soins maternels et infantiles est une réalité dans la zone d’étude. Sur l’ensemble des personnes enquêtées, 98% avaient connaissance de la mesure ; toute chose qui pourrait participer à la fréquentation des formations sanitaires et constituer une avancée dans l’amélioration de la santé maternelle et infantile dans les districts sanitaires de Baskuy et de Bogodogo. Toutefois, la fréquentation des formations sanitaires contraste avec la satisfaction des services offerts. (Graphique n°1).
Graphique n°1 : Etat de satisfaction des bénéficiaires cibles
Source : Enquêtes de terrain 2018
Les deux districts présentent des taux de satisfaction relativement bas. Seulement 27% et 37% des bénéficiaires, respectivement à Baskuy et à Bogodogo affirment avoir été satisfaits de la mesure de gratuité. La satisfaction relève de l’accueil par le personnel de santé mais aussi des soins reçus. Mais les points d’insatisfaction participent des difficultés de mise en œuvre de la mesure, soulignées par les patients enquêtés et par le personnel de santé.
La mise en œuvre de la gratuité des soins au profit des femmes et des enfants rencontre des difficultés à plusieurs niveaux. La première difficulté concerne le matériel et l’équipement des laboratoires. On note l’insuffisance des consommables médicaux en occurrence les seringues, les fils de suture, les flacons, les gans, les masques pour la ventilation, les boites de chirurgie, les sondes urinaires. De nombreux équipements usuels tels que les thermomètres, les tensiomètres, les pèses bébés et adultes, les stéthoscopes, sont en mauvais état. C’est le cas aussi des lits d’hospitalisation, des matelas, des tables d’accouchement.
La deuxième difficulté se situe au niveau du personnel soignant, chargé d’appliquer la gratuité. Les forts taux de fréquentation des structures de santé dus à la gratuité, ont entrainé une augmentation de la charge de travail de ce personnel (quantités énormes de documents à remplir tels que les bulletins d’examen, les ordonnances médicales). De plus il y a des incompréhensions entre agents et patients en cas de rupture des produits médicaux. Ces derniers accusant souvent les premiers de détournements de produits. Des cas de menaces et d’agressions physiques d’agents de santé par certains patients ou accompagnants de malades ont été signalés dans les deux districts sanitaires d’étude. Cette situation engendre une démotivation des agents de santé, surtout qu’ils n’ont pas eu de formation préalable à la mise en œuvre de la gratuité. De plus le remboursement tardif des ressources financières allouées aux formations sanitaires perturbe leur fonctionnement et occasionne souvent les ruptures de médicaments.
La troisième difficulté inhérente à la mise en œuvre de la gratuité, porte sur les ruptures chroniques des produits dans les dépôts pharmaceutiques qui concernent tous les centres de santé enquêtés. Les personnes enquêtées affirment que la durée de ces ruptures varie d’un jour à une semaine, voire plus. Les ruptures de médicaments dans les dépôts pharmaceutiques sont souvent accentuées par les mauvais comportements de certains patients qui profitent de la mesure de gratuité pour constituer des dépôts de médicament à domicile.
Toutes ces difficultés énumérées n’entravent pas la fréquentation des centres de santé. En témoigne les longues files d’attente dans les centres de santé depuis la mise en œuvre de la gratuité. Cette situation a obligé certains centres de santé à instaurer des quotas de consultations dans la journée. Ainsi, dans l’hôpital du district de Bogodogo le service de pédiatrie consulte au maximum 10 enfants par jour. Au CSPS de Wemtenga, 15 à 30 enfants sont consultés par jour. Cette situation cause des désagréments et des frustrations au niveau de la population.
Conclusion
Conclusion
La santé maternelle et infantile constitue une priorité pour le Burkina Faso. La gratuité des soins figure parmi les différentes mesures adoptées par les autorités politiques et sanitaires pour favoriser l’accessibilité des soins aux populations les plus vulnérables. La pertinence de cette mesure réside dans le fait qu’elle permet le renforcement de la fréquentation des structures de santé pour une meilleure prise en charge des maladies.
L’analyse des résultats de cette étude permet de constater que la gratuité des soins maternels et infantiles constitue une avancée dans l’amélioration de la santé maternelle et infantile dans les districts sanitaires de Baskuy et de Bogodogo. Elle permet d’améliorer le recours et l’accès aux services de santé par les femmes enceintes et les enfants de moins de cinq ans. Toutefois, le personnel soignant et la population cibles ne sont pas satisfaits de la gratuité. En effet, d’énormes difficultés surviennent depuis la mise en œuvre de cette mesure, entrainant des conflits récurrents entre les cibles et les prestataires. Ces difficultés résultent de l’insuffisance en infrastructures et en équipements, des fréquentes ruptures en médicaments au niveau des deux districts sanitaires, de la faible voire absence de motivation du personnel.
En dépit de l’existence de ces difficultés, la gratuité des soins maternels et infantiles reste une mesure salutaire pour les femmes et les enfants. Il y a donc nécessité d’une meilleure organisation de ladite mesure, de l’engagement de tous les acteurs ainsi que du gouvernement pour soutenir cette politique dont la pérennité constitue un enjeu sanitaire à long terme.
Références
Références bibliographiques
ANDRIANTSIMIETRY Sandrine, RAKOTOVAO Jean Pierre, RAMIANDRISON Eliane, HAJA Andriamiharisoa, RAZAKARIASY Eric et FAVERO Rachel, 2015, « Evaluation de la disponibilité des personnels qualifiés en santé maternelle et néonatale à Madagascar », African Evaluation Journal 3(2), Art. #156, 8 pages. http://dx.doi.org/10.4102/ aej. v3i2.156
BASSABI Kodjo, 2020, Déterminants du recours précoce aux soins prénatals au Mali, ISPED/Bordeaux, 50p.
CARVAJAL–AGUIRRE Liliana, AMOUZOU Agbessi, MEHRA Vrinda, MENG Ziqi, NABILA Zaka et HOLLY Newby, 2017, «Gap between contact and content in maternal and newborn care: An analysis of data from 20 countries in sub–Saharan Africa», Journal of health global, Vol. 7 No. 2 • 020501; 8p, doi: 10.7189/jogh.07.020501
HADDAD Slim, NOUGTARA Adrien et RIDDE Valéry, 2004, « Les inégalités d’accès aux services de santé et leurs déterminants au Burkina Faso » Santé, Société et Solidarité, n°2, 2004. Inégalités sociales de santé. pp. 199-210 ; doi : https://doi.org/10.3406/oss.2004.1012 https://www.persee.fr/doc/oss_1634-8176_2004_num_3_2_1012
GLOBAL BURDEN OF DEASES CHILD MORTALITY COLLABORATORS, 2016, « Global, regional, national, and selected subnational levels of stillbirths, neonatal, infant, and under-5 mortality, 1980-2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015 », Lancet ; 388(10053):1725–74. 4.
JOURNAL OFFICIEL DU FASO, 2016, Décret 2016-311/PRES/PM/MS/MATDSI/MINEFI, 2p.
KOUASSI Konan, BRISSY Olga Adeline, APPIA Edith Adjo, SOUMAHORO Blondé, 2017, « L’état des lieux de l’abandon des consultations prénatales dans les espaces ruraux du District Sanitaire de Bouake Sud dans un contexte de gratuite ciblée des soins en Côte d’Ivoire », Journal de la Recherche Scientifique de l’Université de Lomé, Vol. 19 No. 3, p. 121-130.
MINISTERE DE LA SANTE, 2012, Cartographie de l’offre de services de santé 2010, Burkina Faso, 133 p.
MINISTERE DE LA SANTE et ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, 2017, Profil sanitaire complet du Burkina Faso, module 1, Burkina Faso, 50 p.
MINISTERE DE LA SANTE, 2018, Annuaire statistique de la santé 2017, DGISS, 386 p.
MINISTERE DE LA SANTE, 2019, Annuaire statistique de la santé 2018, DGISS, 502 p.
OKEDO-Alex IN, AKAMIKE IC, EZEANOSIKE OB, UNEKE CJ. 2019, « Determinants of antenatal care utilisation in sub-Saharan Africa: a systematic review », BMJ Open [Internet]. Oct7[cited2020Feb6];9(10). Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6797296/
OLIVIER DE SARDAN Jean Pierre et RIDDE Valéry, 2012, « L'exemption de paiement des soins au Burkina Faso, Mali et Niger. Les contradictions des politiques publiques », Afrique contemporaine, 3 n°243, pp 11-32
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE, 2017, Plus sain, plus juste, plus sûr : l’itinéraire de la santé dans le monde, 2007–2017, Genève. Licence : CC BY-NC-SA 3.0 IGO, 76p
RIDDE Valéry, 2011, Que sait-on en 2011 des nouvelles politiques de gratuité des soins au Mali? , URI : http://hdl.handle.net/10625/53574, 4 p.
RUKTANONCHAI Corrine, RUKTANONCHAI Nick, NOVE Andrea, LOPES Sofia, PEZZULO Carla, BOSCO Claudio, et al., 2016, « Equality in Maternal and Newborn Health: Modelling Geographic Disparities in Utilisation of Care in Five East African Countries », PLoS ONE 11(8): e0162006. doi: 10.1371/journal.pone.0162006, p. 1-17.
TOURE Lalla, WANE Defa, ALFORD Sylvia et TAYLOR Rachel, 2012, Santé maternelle et néonatale au Sénégal : succès et défis 2011, Ministère de la santé /Sénégal, 80p.
TOURE Laurence et ESCOT Fabrice., 2011, Les perceptions de la gratuité des soins au Mali, Programme Abolition du paiement. Note d’information n° 5, 4p.
TOURE-ECRA Ana, HORO Apollinaire, FANNY Mohamed et KONE Moussa, 2016, « Politique de gratuité des soins obstétricaux et indicateurs de santé maternelle et infantile : Résultats et impact dans une maternité de niveau tertiaire à Abidjan (Côte d’Ivoire) », DOI http://dx.doi.org/10.13070/rs.fr.3.1551; https://www.researchgate.net/publication/5420915, p. 1-5.
WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2016, WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience, Geneva: World Health Organization, 152 p.
WORLD HEALTH ORGANIZATION, Trends in maternal mortality: 1990 to 2015 [Internet]. WHO [cited 2020 Jan 24].Availablefrom: http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality2015/en
WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2015, State of inequality: Reproductive, maternal, newborn and child health, Available: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/164590/1/9789241564908_eng.pdf?ua= 1&ua=1
Downloads
Publié
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
Copyright (c) 2023 NIKIEMA Dayangnéwendé Edwige, ROUAMBA Jérémi et OUEDRAOGO François de Charles